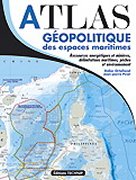- ACCUEIL
- HISTOIRE DU RENSEIGNEMENT (FR)
- Bref historique des Services français, depuis 1871
- La Communauté du Renseignement français ( 2008 )
- Le SR 14-18
- Le SR Terre 39-45
- Le SR Marine 39-45
- Le SR Air 39-45
- Les archives:
- Les archives de 2B - SR et SCR ( par J-C Petermann )
- Les archives Pierre Lyet - RHA 1948 ( très rare ), par J-C Petermann )
- Les archives : ENIGMA - La guerre des codes ( par J-C Petermann )
- Les archives : TR - Le contre espionnage camouflé ( par J-C Petermann )
- Les archives : TR -suite- Le Réseau des Fleurs ( par J-C Petermann )
- Les archives : Les écoutes ( Source K - S.S.C.) ( par J-C Petermann )
- Les archives : Les Postes SR ( par J-C Petermann )
- Les archives : Le Bureau de Sécurité Militaire de Paris ( par J-C Petermann )
- " L'Homme des Services secrets " ( Extrait vidéo A2 - Paul Paillole - 1995 )
- Le Renseignement militaire français 1939 -1945 ( vidéo par JCP/ JC )
- "Notre combat, de l'Armistice à la victoire" ( par Paul Paillole )
- Les biographies :
- AMICALE
- Le mot du Président
- La création de l'Amicale ( 1953 )
- Le Mémorial national AASSDN ( 1959 )
- Hommages à Buchenwald, avec le SFC - 65° anniv. libération des camps
- Les Parrainages / Patronages
- Les Congrès annuels récents ( depuis le 50° anniversaire de l'Amicale )
- Page introductive
- Congrès 2004 - Paris ( Assemblée nationale )
- Congrès 2005 - Strasbourg ( Parlement européen )
- Congrès 2006 - Tours ( Berceau de la France )
- Congrès 2007 - Paris ( Assemblée du Sénat )
- Congrès 2008 - Vittel-Xertigny ( Hommages au Col. A Sérot )
- Congrès 2009 - Ramatuelle( 50° Anniversaire Mémorial national )
- Congrès 2010 - Metz ( Bigade du Renseignement )
- Congrès 2011 - Paris ( Assemblée nationale )
- Les Membres
- Les archives Info-flash du Site ( Hommages récents )
- COMMUNIQUES
- Serment de Bon-Encontre
- Décès du dernier survivant de la mission secrète Pearl Harbour en Corse
- Guerre d'Algérie - une exigence de vérité (UNC)
- Avis à faire circuler
- Vient de sortir en librairie
- Voir à la TV ( Histoire des services secrets français )- France 5 / février 2011
- Voir à la TV ( La guerre en face )- France 2 / 3mars 2011
- Paulette DUHALDE marraine de la promotion des Inspecteurs de la DPSD 2011
- Qu'en est-il du printemps arabe ?
- EXTRAITS DE CONFERENCES
- PAGES D'HISTOIRE
- ETUDES & PERSPECTIVES
- BIBLIOGRAPHIE
- ACRONYMES / SIGLES
- LIENS INTERNET
- CONTACTEZ-NOUS
| BIBLIOGRAPHIE - ( page introductive - page sommaire du chapitre ) | ||||||||||||
| Atlas | ||||||||||||
|
||||||||||||
Tous droits réservés Enregistrer pour lecture hors connexion Lire l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. - Code non exclusif des autres Droits et dispositions légales.... L'Article L122-5 créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 autorise, lorsque l'oeuvre a été divulguée, les copies ou reproductions sous certaines conditions. ..., Pour récapitulatif tous ouvagres présentés, voir également la page Liste par Auteur(s)
|