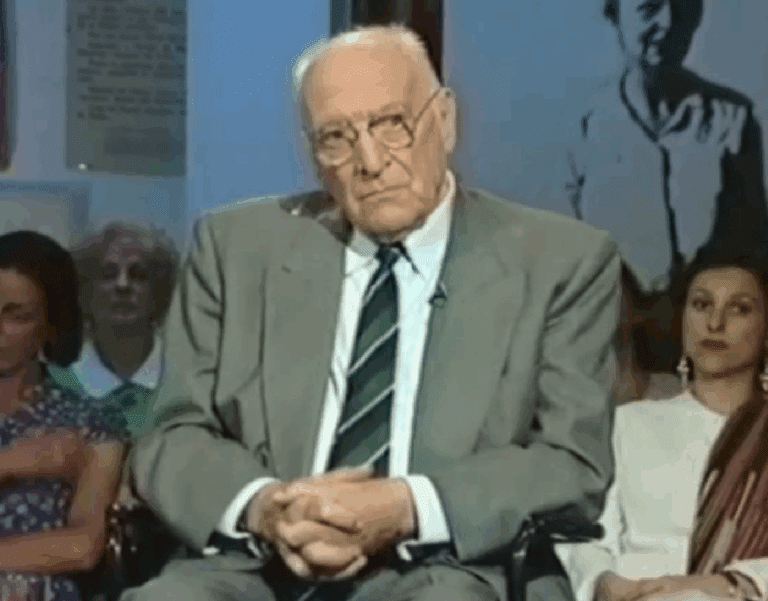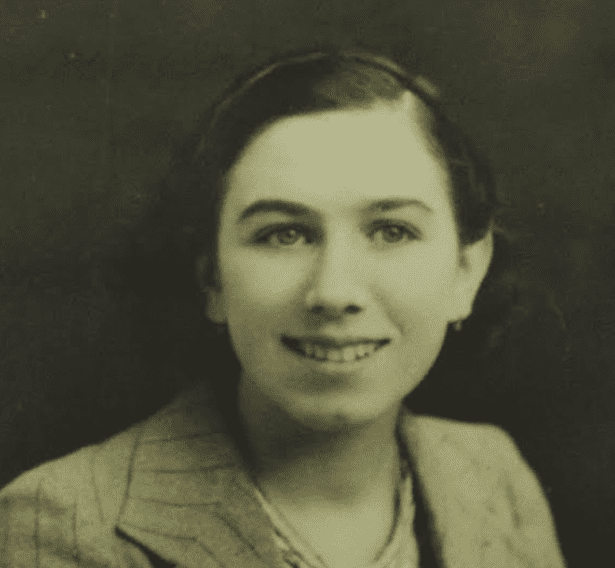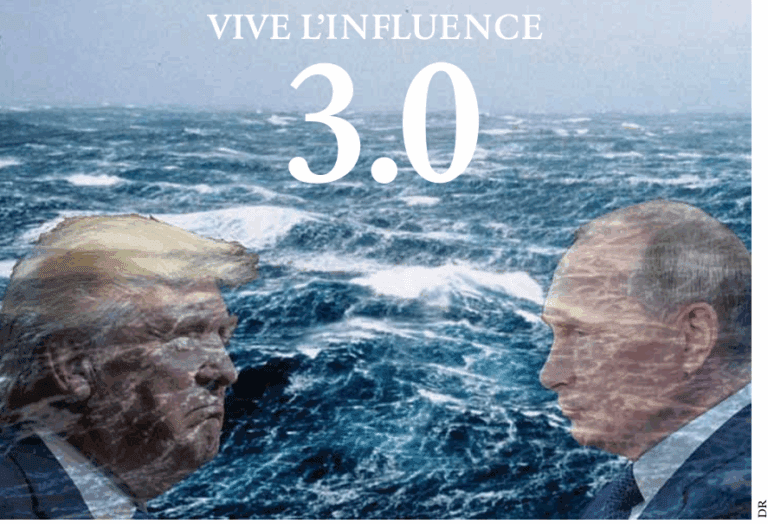Les agriculteurs se mobilisent à nouveau contre le projet d’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Derrière l’importation de produits étrangers aux normes contradictoires, c’est un modèle de vie qui est en jeu, explique notre chroniqueur Jean-Étienne Rime.
Pauvre poulet ! On le mange à toutes les sauces et sous toutes les formes : salade César, nuggets, filets et même jambon, rillettes ou saucisses de volailles. Il se trouve dans tous les supermarchés, présenté de mille façons. Il est à la carte des restaurants les plus huppés et des spécialistes de burgers qui l’accommode à coups de crèmes sucrées et autres condiments. Il a été la nourriture de base des athlètes et leurs accompagnants aux Jeux olympiques de l’an dernier, nourriture consensuelle s’il en est et appréciée de tous les continents, toutes les religions ou convictions à l’exception des végétariens, végétaliens et autres adeptes du renoncement à la viande animale.
Des normes exigeantes
D’où vient ce poulet ? Bonne question en effet ; une grande majorité de consommateurs ne font pas le lien entre ce morceau de viande emballé dans un film plastique ou enroulé dans une panure croustillante, et l’animal qui vit huit semaines — douze pour les poulets fermiers qui pourtant sort bien d’un élevage qualifié d’”industriel” par ses détracteurs. C’est vrai, ce système n’est pas idéal mais l’on ne peut guère revenir à ce qui se faisait autrefois avec le poulailler de la ferme et ses volailles qui mangeaient restes alimentaires et vers de terre, car notre gallinacé est omnivore.
Qui accepterait d’élever ainsi quelques volatiles et qui accepterait de payer trois ou quatre fois le prix pour être certain d’avoir un vrai poulet de ferme ? Personne. Les éleveurs se sont adaptés, ils ont créé des conditions d’élevage plus respectueuses de l’animal avec des parcours extérieurs par exemple, une limite du nombre d’animaux, mais pour une production qui reste à grande échelle. Les fermiers de notre temps sont attentifs à la santé et au bien-être de leurs animaux, condition essentielle pour que leur croissance se déroule bien. Ils sont aussi des investisseurs, ils nourrissent la vie locale : fournisseurs d’aliments, vétérinaires, installateurs de bâtiments et artisans de la maintenance. Ils produisent français, dans des normes infiniment plus exigeantes que celles pratiquées ailleurs et mettent dans nos assiettes des produits sains, sûrs et bons.
La folie du Mercosur
Oui, mais voilà. Si l’industrie française s’est externalisée à l’autre bout du monde au prétexte de la mondialisation, l’agriculture française et particulièrement l’élevage risquent de subir le même sort, pour tenter de sauver la construction aéronautique ou un autre pan de notre économie. Le poulet va venir du Brésil ou des pays d’Amérique du Sud, ceux qui déforestent pour semer du soja ou produire de l’huile de palme. Nous n’aurons plus aucune garantie sanitaire sauf celles décrétées par des administrations locales laxistes ; les questions de bien-être animal seront biffées d’un trait sans appel, l’écologie idem, sans parler des dépenses d’énergie liées aux transports longs, à la congélation, bref, tout ce qui ne fait pas le bien du consommateur.
Le poulet ne sera pas le seul élevage concerné ; bœuf et porc seront importés aussi de ces pays sans contrôle pour être vendus à bas prix en Europe. La folie du Mercosur est portée par des technocrates totalement déconnectés des réalités rurales, qui veulent réglementer, contraindre et faire plier plus encore une profession qui souffre alors qu’elle est essentielle et porte de si belles valeurs ancestrales et modernes à la fois. Ils annoncent des garanties, des volumes limités d’importation auxquels eux-mêmes ne croient pas. On a fait de même pour l’industrie et l’on voit le résultat.
Le terreau d’un style de vie
Nous avions la chance en France d’avoir une agriculture variée, d’une incroyable qualité et surtout excédentaire. Ce n’est plus le cas. Les paysans sont à la fois idéalisés et conspués, ils sont pourtant les tenants du conçu et produit et en France. Ils sont à l’amont d’emplois, non délocalisables et essentiels à nos campagnes. Ils sont les garants du goût, de la santé, de ce qui fait une richesse incomparable de notre pays, la gastronomie. Les agriculteurs ont manifesté ce 26 septembre, ils recommenceront dans une certaine indifférence. Nous sommes tous concernés. À travers ces mouvements, ce ne sont pas les seuls exploitants agricoles qui s’expriment mais toute la France attachée à un modèle rural, à une production variée qui se retrouve sur nos tables, celles du goût, celles de tous les jours à la cantine ou à l’hôpital, celle des fêtes et des rencontres de la famille et des amis. La production agricole française est le terreau d’un style de vie, préservons-là et mieux encourageons-là, soyons solidaires de ces paysans, ces éleveurs passionnés et passionnants, indispensables à notre pays.
Jean-Étienne RIME
Site : ALETEIA
29 septembre 2025