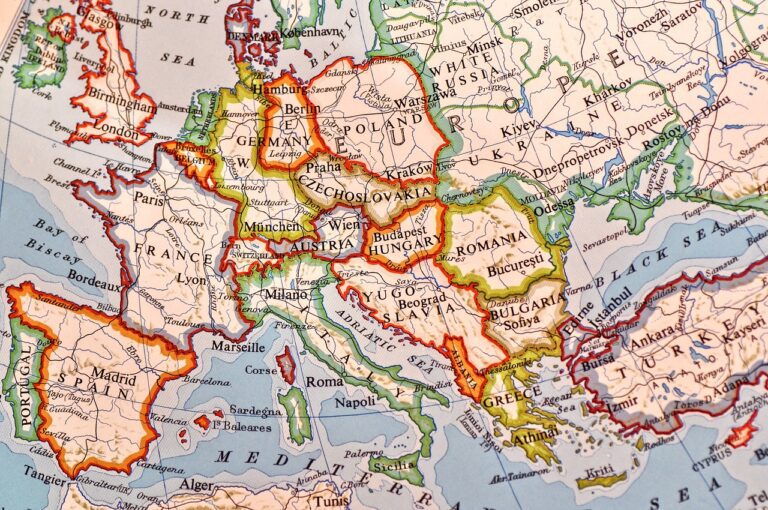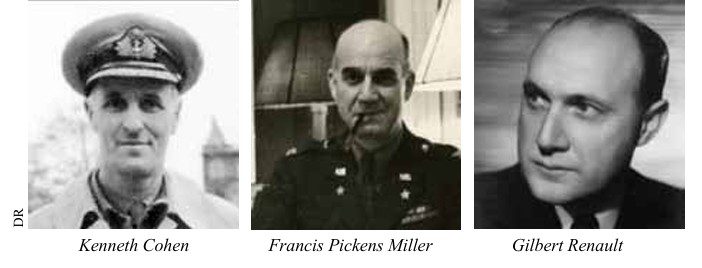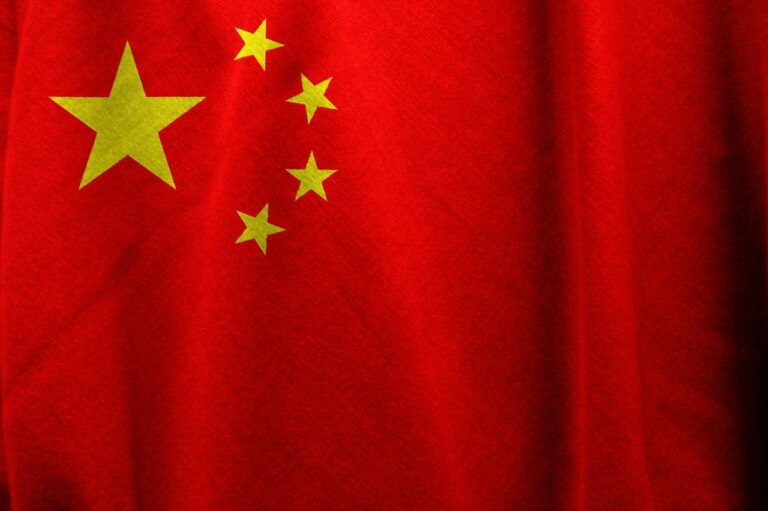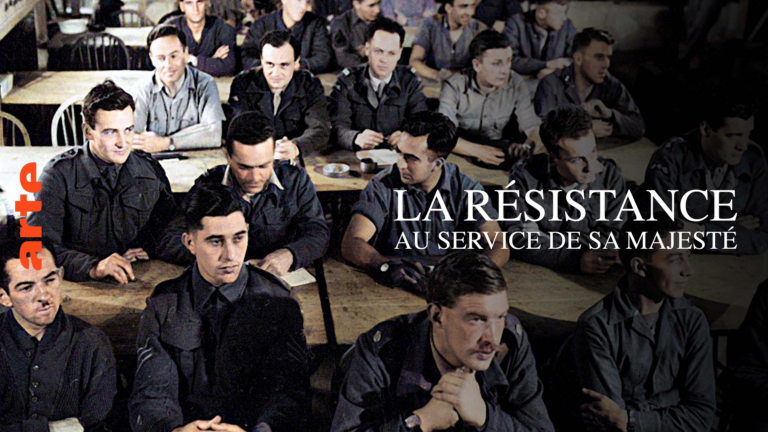Category: 2020-2030,Actualités,Désinformation,Géopolitique,Maghreb - Moyen Orient
Alain Chouet, ancien chef du Service de Renseignement à la DGSE, explique que la stratégie militaire d’Israël contre le Hamas montre des résultats mitigés : bien que les opérations aient sévèrement affaibli les capacités du groupe, elles risquent de se traduire par une victoire à la Pyrrhus, car le Hamas pourrait se régénérer grâce à la frustration et au désir de vengeance qu’elles engendrent. Par ailleurs, il distingue les éliminations ciblées des responsables du Hamas, qui sont une pratique bien rodée des services spéciaux israéliens, bénéficiant d’une large acceptation publique en Israël.
Commentaire AASSDN : Notre amicale estime particulièrement utile et pertinent de relayer cet article sur son site car les réponses apportées par l’ancien directeur du renseignement de la DGSE s’appuient sur une longue expérience au sein des Services spéciaux et une connaissance approfondie des pays du Moyen Orient. Ses propos corrigent les analyses souvent superficielles et parfois marquées par l’idéologie, de pseudo experts présents dans de nombreux médias. Cette interview participe donc à la lutte contre la désinformation; Cette menace insidieuse et croissante s’attaque fréquemment aux intérêts fondamentaux de la Nation dont la défense est au cœur des préoccupations de l’AASSDN .
Le Diplomate (LD) : Après 10 mois de guerre et qui ont suivi les massacres du 7 octobre, quel est, sur le plan strictement militaire, le bilan d’Israël à propos de sa stratégie d’« éradication » du Hamas ? Comment expliquer notamment l’efficacité notable des services spéciaux israéliens quant aux éliminations ciblées des responsables de l’organisation terroriste palestinienne ?
Alain Chouet (AC) : Ce sont deux problématiques différentes. Les éliminations ciblées sont une constante des services spéciaux israéliens depuis 1948. Le Mossad, l’Aman et le Shabak entretiennent en permanence des dossiers d’objectif sur toutes les structures ou personnes susceptibles de nuire à la sécurité du pays ou convaincues de lui avoir nui. Ils sont donc en mesure de passer à l’action à tout moment sur un court préavis ou en fonction des opportunités comme on l’a vu à de très nombreuses reprises, notamment depuis l’attentat contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. S’agissant pour Israël d’une question de vie ou de mort entretenue par une lourde mémoire collective, la méthode est admise par l’opinion et ne rencontre pas les réticences morales, éthiques ou politiques auxquelles sont soumis les autres services des démocraties, notamment en Europe.
La stratégie d’élimination du Hamas relève d’une autre logique qui est celle d’une intervention militaire massive, souvent indifférenciée et à visage découvert. Son bilan est beaucoup plus mitigé malgré les très lourds dégâts matériels et humains qu’elle entraîne. Certes la masse de manœuvre et les capacités de nuisance de la milice terroriste sont durement atteintes et nombre de ses éléments aguerris et de ses cadres ont été éliminés. Mais son affaiblissement risque de s’analyser en une victoire à la Pyrrhus. Le Hamas n’est que l’émanation palestinienne de la galaxie violente des Frères Musulmans soutenus par certaines pétromonarchies, une partie des opinions publiques du monde musulman et instrumentalisée à des fins stratégiques par l’Iran tandis qu’il se pose en martyr et se victimise auprès de nombre de sociétés du tiers monde et de naïfs occidentaux.
Il y a donc tout lieu de redouter qu’il renaisse de ses cendres dès que la pression armée d’Israël sur Gaza devra bien être levée. Cela prendra sans doute un peu de temps mais l’organisation n’aura aucun mal à assurer la relève des militants éliminés dans le vivier de souffrance, de frustration et de désir de vengeance provoqués par l’opération interminable mais finalement peu concluante de Tsahal dans l’enclave.
LD : Le Mossad a récemment réalisé des opérations ciblées en utilisant des technologies avancées, y compris l’IA et le contrôle à distance, pour éliminer des leaders ennemis en Iran. Selon vous, quelles pourraient être les prochaines cibles potentielles du Mossad, et comment pensez-vous que ces opérations pourraient évoluer en termes de stratégies et de technologies employées ?
AC : Je vous laisse la responsabilité de dire quelles technologies le Mossad a utilisées pour mener à bien ses dernières opérations en Iran. Je ne les connais évidemment pas et j’ignore quelles pourraient être ses prochaines cibles.
Ce que je sais en tant que professionnel c’est que dans ce domaine chaque cas est un cas d’espèce et que tout est affaire de circonstances et d’opportunités. Il n’y a pas de règle générale et on cherche toujours le moyen le plus simple d’arriver à ses fins sachant que plus la méthode employée est complexe et sophistiquée, plus les risques d’échec sont importants.
LD : À notre époque hautement technologique, on l’a vu, le renseignement humain a-t-il encore son importance ? Et si oui, comment Israël le développe et l’entretien dans des pays ou des zones hostiles comme en Syrie, en Iran voire à Gaza ou dans les territoires palestiniens de Cisjordanie ?
AC : Les progrès technologiques appliqués aux cannes à pêche et aux moulinets n’ont pas rendu la chasse inutile ou obsolète. Il n’y a guère de sens à opposer le renseignement technique au renseignement humain. Ils sont interdépendants et complémentaires. Le progrès technologique a décuplé, voire centuplé, les capacités d’observation et d’écoute des services de renseignement. Mais il a ses limites et des trous dans sa raquette. Quelle que soit la sophistication des moyens techniques employés, celui qui observe et écoute par ces moyens n’est pas maître de la manœuvre. Il ne peut voir et entendre que ce que sa cible veut bien dire ou montrer. Et si la cible sait qu’elle est observée et écoutée, la porte est ouverte à l’intoxication et à la désinformation. Enfin et surtout, si le renseignement d’origine technologique permet plus que jamais de connaître de façon précise et détaillée la nature et l’état des forces hostiles, il ne permet pas de connaître le secret des intentions de ceux qui les emploient. Cela suppose alors l’entretien d’un capital de sources humaines au sein du cercle des décideurs adverses ou dans leur environnement immédiat.
Les comptables et les ignorants aiment bien le renseignement technique. Il est cher mais il fournit des résultats immédiats, visibles, vérifiables et quantifiables. Il a aussi l’avantage d’être sans risque politique puisqu’il peut s’exercer depuis chez soi sans s’exposer. Le renseignement humain, se joue sur le temps long. Il présente le danger de se faire prendre la main dans le sac en territoire adverse. Il est empreint de subjectivité et est souvent difficilement vérifiable dans l’immédiat. C’est pourquoi, face à l’explosion des capacités technologiques, les responsables politiques et financiers de nos États ont eu tendance dans les quelques décennies passées à privilégier le renseignement technique aux dépens – contraintes financières obligent – du renseignement de source humaine.
Israël n’a pas échappé à cette dérive venue tout droit des États-Unis qui n’ont pas le danger d’être au contact physique direct de l’adversaire. Les capacités en renseignement humain du Shabak en Cisjordanie et à Gaza, de l’Aman dans les pays du front et du Mossad dans le monde entier en ont pâti. Il faut reconnaître que la tâche n’est pas facile dans le contexte régional, en particulier à Gaza, où les autorités de fait n’hésitent pas à torturer et assassiner leurs contemporains au moindre soupçon – même totalement infondé – de collusion avec Israël. Mais la situation n’est guère différente au Liban, en Syrie ou en Iran. Il n’empêche – et la tuerie du 7 octobre 2023 en est la preuve – qu’au-delà des capacités techniques de connaissance de l’état des forces adverses, Israël doit retrouver sa capacité de connaissance et d’évaluation de leurs intentions.
LD : La collaboration croissante entre Moscou et Téhéran semble redessiner les alliances au Moyen-Orient, avec des implications potentiellement déstabilisatrices. Dans ce contexte, pensez-vous que le FSB pourrait jouer un rôle actif dans cette dynamique, et si oui, comment pourraient-ils s’intégrer dans les stratégies conjointes avec l’Iran ? Et surtout au prisme de l’ancienne coopération qui était notable jusqu’ici entre Israéliens et Russes ?
AC : La Russie et l’Iran, tous deux en difficulté dans leur contexte régional et international respectif, se soutiennent l’un l’autre comme la corde soutient le pendu. Si cela permet de fabriquer quelques connivences diplomatiques, économiques, militaires et stratégiques, cela ne permet pas de déboucher sur des actions décisives et coordonnées. Ces limites sont particulièrement patentes dans le Caucase, face à l’Azerbaïdjan et la Turquie et même en Syrie où les deux « partenaires » se regardent en chiens de faïence. Très mobilisé par la situation en Ukraine et en Europe où il doit essayer de pallier certaines insuffisances de l’armée régulière, le FSB, qui a perdu beaucoup du potentiel ancien du KGB au Levant, n’a pas beaucoup de plus value à apporter aux Iraniens (Ministère du renseignement ou Pasdaran), dans la gestion des crises régionales. Pour l’instant, s’ils se rejoignent sur la redéfinition d’un ordre international hostile à l’Occident et aux États-Unis, leurs agendas ne sont pas vraiment convergents.
LD : Avec l’augmentation des cyberattaques imputées à l’Iran, comment les services de renseignement, notamment israéliens, se préparent-ils à contrer ces menaces, et quelle est votre analyse de l’implication croissante de la cybersécurité dans les conflits géopolitiques actuels ?
AC : La récente panne informatique mondiale imputable à une mise à jour de Microsoft, les pannes de la SNCF dues à des sabotages d’armoires informatiques, les paralysies récurrentes de services médicaux imputables à des cybercriminels montrent à quel point l’ensemble de nos activités civiles et militaires sont devenues totalement dépendantes d’un réseau informatique mondial mal maîtrisé et donc à quel point nos sociétés sont vulnérables et fragiles. Il suffit aujourd’hui à un hacker un peu doué d’appuyer sur un bouton « Enter » pour priver un pays entier, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, d’eau, d’électricité, de carburants, de transports, de transmissions, de services de soins et de secours. Ce que le grand public sait trop peu c’est que toute notre architecture informatique repose sur l’existence et le fonctionnement de quelques dizaines de « Data Center » dont le sabotage ou la destruction paralyserait totalement la vie du pays.
Il n’est donc pas étonnant que ces « goulots d’étranglement » et ces vulnérabilités soient devenus un objectif privilégié de nos adversaires et donc un axe prioritaire de nos préoccupations de défense nationale. C’est évidemment le cas pour Israël qui a tout de même pour atout d’avoir développé très tôt un secteur informatique parmi les plus performants du monde et, en conséquence, des capacités de cyberdéfense hors du commun et, en tout cas, très supérieures aux capacités offensives de l’Iran dans ce domaine.
LD : Les tensions entre Israël et l’Iran montent de plus en plus. Certains experts évoquent un risque accru de confrontation directe entre les deux nations. Quelle est votre évaluation de cette menace, et quelles mesures les services de renseignement peuvent-ils prendre pour prévenir une escalade nucléaire ? Et pourtant, comment expliquer qu’en dépit des déclarations belliqueuses iraniennes suite à l’élimination d’Ismaël Haniyeh le 31 juillet dernier en Iran, les représailles tant annoncées se font toujours attendre ?
AC : Les tensions entre Israël et l’Iran montent particulièrement dans les médias occidentaux et les chaînes de télévision en continu. Le risque de confrontation militaire directe entre les deux pays au delà de quelques gesticulations spectaculaires paraît plus qu’incertain. Ni l’un ni l’autre n’en a les moyens. On imagine mal l’armée iranienne traverser l’Irak et la Jordanie ou débarquer sur les plages méditerranéennes pour se colleter avec Tsahal…. De même on voit mal comment l’armée israélienne, déjà en limite de portage dans ses opérations à Gaza, pourrait aller affronter l’Iran au sol en débarquant sur les rives du Golfe Persique.
L’éventualité d’un affrontement aérien croisé en cas de dramatisation du conflit ne peut être exclu mais ne mènerait pas à grand-chose. L’armée de l’air iranienne ne dispose en pratique que de vieux appareils d’avant la révolution islamique incapables de se mesurer aux appareils de l’État hébreu. L’armée de l’air israélienne est en mesure d’opérer des missions de bombardement sur l’Iran… Mais sur quels objectifs ? Pour quel résultat sans possibilité d’exploitation au sol ? Pour quel coût financier et surtout politique ? Car cela nécessiterait de traverser l’espace aérien de pays arabes qui n’ont pas vraiment de raison de l’autoriser. Et cela donnerait à l’Iran l’occasion de fustiger la complicité des monarchies sunnites avec les « sionistes ».
L’hypothèse d’une attaque massive par missiles et drones est régulièrement évoquée et l’Iran s’est déjà livré sans conviction à l’exercice. Il pourrait être tenté de recommencer sachant que le « dôme de fer » israélien, secondé par la flotte aéronavale américaine en Méditerranée orientale est efficace, mais qu’aucun système de protection n’est fiable à 100%. La chute d’un seul missile sur un territoire aussi densément peuplé qu’Israël serait dévastatrice et aurait des conséquences politiques incalculables. Cela entraînerait certainement une lourde riposte israélienne mais le régime des mollahs est moins sensible que le pouvoir israélien aux pertes humaines parmi sa population. Et, au total, on resterait dans l’impasse.
Quant à l’hypothèse d’une « escalade nucléaire », elle relève pour l’instant du fantasme, du journalisme à sensation ou de l’ignorance de pseudo-experts. L’Iran veut être ce que l’on appelle un « pays du seuil », c’est-à-dire susceptible d’avoir la bombe dans un délai de quelques semaines à quelques mois, mais il n’y est pas encore. C’est ce que pressentait dès l’an 2000 le regretté Ephraïm Halévy, alors patron du Mossad, qui s’était fixé comme objectif de retarder par tous les moyens l’échéance qu’il considérait comme inéluctable. Le Mossad est effectivement parvenu à retarder l’échéance mais, sauf bouleversement majeur, celle-ci demeure inéluctable.
Il n’en reste pas moins que c’est un domaine où la doctrine iranienne rejoint la doctrine de dissuasion de plusieurs pays occidentaux : avoir la bombe pour ne pas avoir à s’en servir. D’ailleurs la motivation initiale de l’Iran dans sa course à l’armement nucléaire n’était pas de se confronter à Israël mais de dissuader les monarchies sunnites alliées à l’Occident de lui refaire le coup de la guerre Iran-Irak avec son million de morts, ses trois millions d’éclopés, ses veuves et orphelins de guerre.
Le régime des mollahs a tout fait pour s’assurer une carte palestinienne dans son jeu stratégique dans la perspective de règlement des conflits régionaux dont il ne veut pas être exclu et pour montrer son rôle de fer de lance de la cause islamique alors que les monarchies sunnites se soumettent à Israël et à l’Occident. Téhéran a clairement instrumentalisé le Hamas et n’a pas hésité à le sacrifier en l’incitant à l’atroce opération du 7 octobre pour casser durablement la dynamique des accords d’Abraham et du rapprochement entre Israël et les pays arabes sunnites. Les Iraniens ne pouvaient ignorer que la riposte israélienne serait impitoyable et détruirait leur instrument. Mais le jeu en valait la chandelle et, pour les théocrates chiites persans, faire massacrer des Arabes sunnites et Frères Musulmans ne constitue pas un bien grand dommage par rapport au bénéfice engrangé. C’est ce qui explique en grande partie la « retenue » du Hezbollah libanais et de l’Iran lui-même face au désastre des Palestiniens de Gaza et à l’assassinat des dirigeants du Hamas. Comme on ne peut quand même pas ne rien faire face au défi, les proxys de l’Iran – Hezbollah, groupes chiites syriens et irakiens, Houthis yéménites – s’exercent à d’habituelles frappes de missiles et roquettes mais se gardent bien de tout engagement direct.
LD : Dans un contexte où les conflits traditionnels cèdent de plus en plus de terrain aux guerres de l’ombre, notamment dans les domaines du cyberespace et du renseignement, comment évaluez-vous l’évolution de ces nouvelles formes de confrontation ? Les services de renseignement, tels que ceux d’Israël et de l’Iran, se préparent-ils à un avenir où la supériorité technologique et la maîtrise de l’information surpassent les moyens militaires conventionnels ?
AC : Le budget militaire annuel de la Russie est d’environ 80 milliards de dollars. Celui de la Chine de 240 milliards. Le budget militaire cumulé des États-Unis et des pays de l’OTAN est de 1200 milliards…. Face à un tel déséquilibre de moyens appuyés sur une supériorité matérielle et technologique pour l’instant insurpassable, il est parfaitement vain et suicidaire de vouloir s’opposer à l’Occident par des moyens armés conventionnels. Le dernier à ne pas l’avoir compris est Saddam Hussein qui a accepté en 2003 une confrontation conventionnelle directe. Il en a payé le prix. Ses voisins plus subtils comme l’Iran, la Syrie ou la Libye qui avaient fait dans les années 80 du terrorisme une arme ordinaire de leurs relations internationales l’avaient bien compris et en ont engrangé des bénéfices inespérés
Dans cette situation de déséquilibre conventionnel, il n’y a donc que deux options pour ceux qui ne veulent pas se soumettre à l’hégémonie atlantiste : posséder la capacité nucléaire (et les vecteurs nécessaires à sa mise en œuvre) ou avoir recours à des stratégies sournoises et indirectes du faible au fort reposant sur l’utilisation du terrorisme, de la criminalité transnationale organisée, de l’influence, de l’espionnage, de la désinformation, de la cybernuisance.
La Corée du Nord a opté pour une stratégie nucléaire exclusive que son Président met spectaculairement et régulièrement en scène. L’Iran et ses proxys s’appuient sur un cocktail des deux en mettant en œuvre à peu près toutes les manœuvres du faible au fort – sans évidemment en assumer la responsabilité – dans l’attente d’une accession à la capacité atomique.
C’est donc bien à cet état des choses mouvant et polymorphe que les forces armées et services occidentaux – y compris ceux d’Israël – doivent s’adapter. Il y faut pour certains une sorte de « révolution culturelle » pour admettre que le temps n’est plus à la force brute du déferlement d’unités blindées et mécanisées en rase campagne sous couvert de supériorité aérienne, mais aux coups bas, aux opérations clandestines, aux tactiques indirectes qui sont plutôt de la compétence des services d’action spécialisés que des grandes unités constituées autour de leur drapeau. En France, le budget de la DGSE représente à peu près un pour cent du budget de la défense. Ce qui signifie qu’en amputant la défense conventionnelle d’un pour cent de son budget il serait possible de doubler les moyens de la DGSE….
LD : Ainsi, les principes éthiques et les règles de guerre traditionnelles sont-ils encore pertinents ? Existe-t-il des normes ou des cadres internationaux qui régissent ces nouveaux terrains de conflit, ou sommes-nous dans une zone grise où tout est permis pour atteindre ses objectifs stratégiques ?
AC : L’histoire et l’expérience prouvent que les soi-disant « principes éthiques » et « règles de guerre traditionnelles » sont des notions à géométrie variable soumises à l’interprétation personnelle des belligérants et n’ont pratiquement jamais été respectés – y compris par ceux qui s’en réclamaient – au cours des conflits du XXe siècle : guerres mondiales, guerres régionales, guerres coloniales, conflits locaux en marge de la guerre froide, « guerres antiterroristes », etc.
Ce ne sont pas d’épouvantables tortionnaires méprisants des droits de l’homme qui ont légalisé la torture, vitrifié des villes entières sous de tapis de bombes incendiaires ou des bombes atomiques, répandu larga manu des produits chimiques toxiques, massacré et incendié des villages entiers, interné sans procédure et sans jugement des suspects adverses dans des cages en fer pendant des décennies…
Il va de soi que le passage des conflits armés conventionnels à des tactiques sournoises et clandestines du faible au fort fait entrer les protagonistes dans une zone grise de non droit où tous les coups sont permis puisque la clandestinité de l’action est censée mettre les auteurs à l’abri de toute sanction.
LD : Enfin, nous savons que les services de renseignement importants des pays arabes comme ceux de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, des Émirats et du Qatar par exemple sont très actifs depuis 10 mois dans les négociations, soit dans la libération des otages israéliens ou des divers cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Après tout ce temps quel est le bilan de ces services spéciaux, leurs relations plutôt bonnes jusqu’en octobre dernier avec les Israéliens sont-elles remises en cause définitivement et vont-ils jouer un rôle pour la fin de ce conflit et « l’après-Hamas » ?
AC : Les services de renseignement des pétromonarchies sont plutôt des services de protection et de sécurité des familles régnantes en place que des services de renseignement au sens où nous l’entendons.
D’une manière générale, les dirigeants arabes n’ont qu’une confiance limitée dans leur propre ministère des affaires étrangères dont ils ne maîtrisent pas le recrutement puisque la fonction nécessite une certaine technicité alors que les membres de leurs services de sécurité sont cooptés sur la base de connivences familiales, féodales ou tribales.
Et ils ont une confiance nulle dans les ministères des affaires étrangères des pays occidentaux qu’ils jugent majoritairement indiscrets, donneurs de leçons et hostiles. Ils leur préfèrent donc les relations de personne à personne ou les relations nouées de service de renseignement à service de renseignement.
Ils ont donc tendance à faire de leurs services un rouage essentiel de leur relation extérieure. D’ailleurs, dans les pays « bien tenus » – comme l’était la Libye de Kadhafi il était devenu d’usage que le chef des services spéciaux cumule ce poste avec celui de ministre des affaires étrangères comme le furent Ibrahim Bishari ou Moussa Koussa…. Et on voit bien que les négociations actuelles autour du sort des otages israéliens et de la tragédie gazaouie sont du ressort exclusif des chefs des services spéciaux, que ce soit du côté arabe ou du côté israélien ou américain.
La compétence des services qataris ou saoudiens en ce qui concerne les problématiques liées au Hamas est incontestable puisque ce sont ces mêmes services qui pendant de nombreuses années ont financé, favorisé, soutenu politiquement le mouvement terroriste islamiste et donné protection et asile à ses chefs qu’ils connaissent donc parfaitement. C’est sans doute un point qui mériterait réflexion quand l’urgent dossier du sort des otages aura pu être soldé…
Par souci de sécurité face à des voisins menaçants, les services qataris poursuivront à bas bruit leurs relations avec les services israéliens initiées depuis plus de vingt ans. De même les services saoudiens face au danger commun que représente l’Iran des mollahs. De même que les services égyptiens confrontés au même risque qu’Israël de la part des Frères Musulmans. Mais la dynamique politique des « Accords d’Abraham » par laquelle Benjamin Netanyahou pensait pouvoir normaliser les relations de l’État hébreu avec son environnement islamique sunnite est brisée sans doute pour longtemps. C’est une victoire dans la confrontation asymétrique qui oppose l’Iran à son environnement wahhabite, à Israël et à l’Occident.
Propos d’Alain CHOUET, Ancien directeur du renseignement de la DGSE
recueillis par Mathilde GEORGES pour Le Diplomate (19 août 2024)