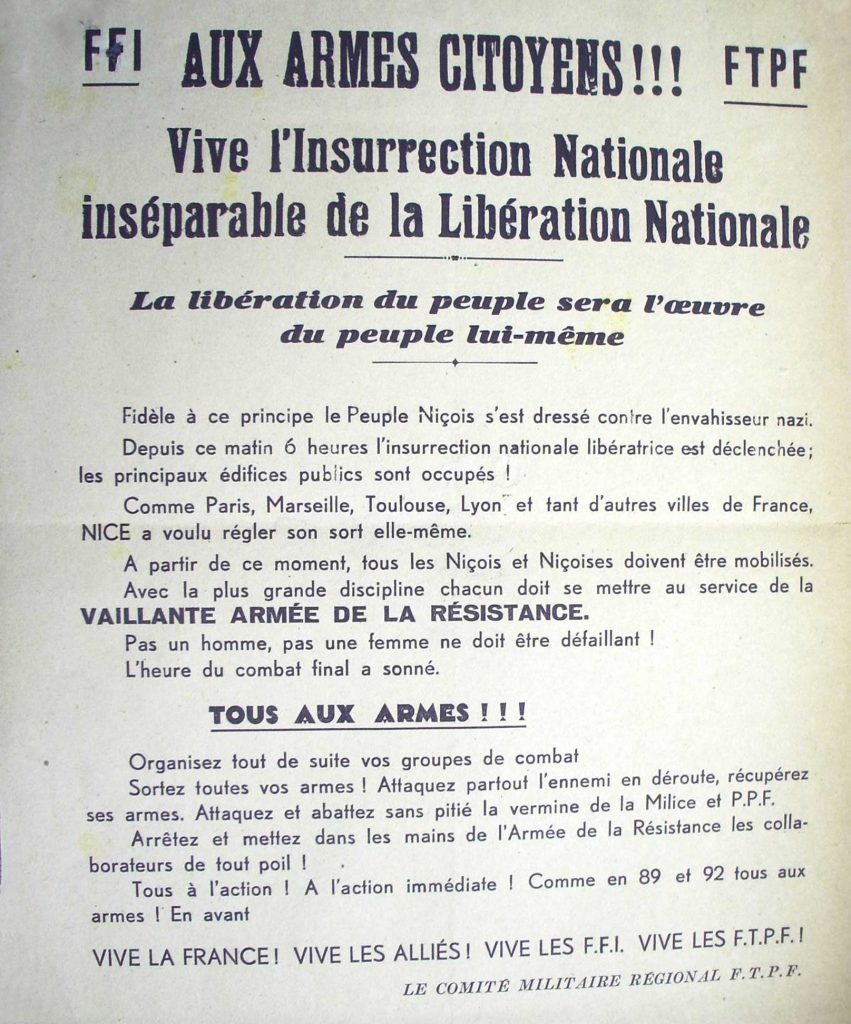Category: 1940-1944 : Résistances en France,2ème Guerre Mondiale (1939-1945),Colonel Paul Paillole,Europe de l'Ouest,Extraits de bulletin,Général Louis Rivet,Henri Frenay,L'action des services avant et après 1942,Les rapports avec les autres réseaux,Lieutenant Colonel Perruche,Où étaient les agents des Services spéciaux avant 1942 ?,Place des Services spéciaux dans la résistance de l’armée (ORA...),Pourquoi la résistance des Services spéciaux est-elle si mal connue ?,Quand a débuté la résistance des SR ?,Quels rapports des SR avec Vichy ?,Renseignement,Services allemands,Source MAD
CETTE SACRÉE VÉRITÉ…
Soucieux de dissiper bien des malentendus, des confusions et des jugements sommaires, hâtifs et souvent partiaux formulés à propos de l’action clandestine menée par les services spéciaux militaires de juin 1940 à la fin de l’année 1942, le Colonel Paillole nous livre ici le témoignage vivant de cette époque si contrastée, si controversée aussi et fait sortir de la nébuleuse des premières années de la résistance, le rôle joué par ses camarades et le sacrifice de nombre d’entre eux.
C’est encore et toujours la présentation inexacte, incomplète de l’opposition des militaires à l’oppression nazie de 1940 à 1942 qui m’incite à revenir sur un sujet que j’ai maintes fois traité. Je supporte mal l’image confuse qui est donnée de leur résistance et l’exploitation malveillante qui en résulte. Nous avons, moi le premier, notre part de responsabilité dans cet état de fait: trop de timidité, d’humilité, mais aussi et surtout, en face des exigences de l’HISTOIRE, une conception étriquée du devoir de réserve, pas toujours exempte de suffisance. Je serais satisfait si l’exposé qui va suivre limité au travail de nos réseaux clandestins et des Bureaux Menées Antinationales (B.M.A.) permettait une vue plus claire, une compréhension plus complète et juste de leurs rôles et actions respectives.
Les militaires dans la résistance de 1940 à 1942 N’en déplaise aux irréductibles détracteurs de l’armée et à leurs complices médiatiques, il est désormais établi que les premiers actes de résistance à l’occupant, fin 1940, sont pour la plupart d’initiatives militaires.
On peut les classer schématiquement en trois groupes: – L’opposition à l’ennemi mais aussi au pouvoir de Vichy. La plus salutaire pour la FRANCE fut celle du Général de Gaulle. Elle reste dans l’HISTOIRE, le symbole du patriotisme et de l’honneur. Il y en eut d’autres diversement développées, la plus marquante étant celle de mon ancien de Saint-Cyr et ami Henri Frenay.
– Les réseaux clandestins issus du 5e Bureau de l’E.M.A.. Ils vont poursuivre leurs missions de recherche et de contre-espionnage contre l’Axe en marge des autorités vichyssoises.
– La résistance de l’armée de l’armistice orientée par les premiers chefs, Weygand, Frère, Verneau, du Vigier, Baril, etc.. dans un esprit de revanche et la préparation en secret d’une participation aux opérations alliées de libération. Ainsi naquirent dans les zones libres (métropole et A.F.N.) des institutions plus ou moins confidentielles et éphémères : camouflage du matériel (C.D.M.), mobilisation clandestine, section secrète du 2e Bureau de l’E.M.A. et Bureau des Menées Antinationales (B.M.A.). Je n’oublie pas les tribunaux militaires qui surent réprimer de 1940 à 1942 les entreprises des services spéciaux de l’Axe et de leurs auxiliaires.
Naissance et caractéristiques des réseaux militaires clandestins
Le 26 juin 1940 à 18 heures, le Colonel Rivet et les cadres du 5e Bureau de l’E.M.A. dissous, font le serment à Bon Encontre (près d’Agen) de poursuivre en secret leur contrat. Le même jour à Brax (près de Toulouse) le personnel de ce 5e Bureau fait le même serment en présence du Colonel Malraison, adjoint du Colonel Rivet. Le 27 juin 1940, nous tirons les premières conséquences de cette résolution:
1 – La poursuite de la lutte est en opposition aux clauses de l’armistice. Elle exigera une organisation et des actions secrètes, hors des institutions officiel les. Elles seront indépendantes d’elles.
2 – Secret et sécurité imposent un cloisonnement rigoureux entre nos spécialistes: renseignement proprement dit, contre-espionnage, sécurité. C’est l’éclatement de nos services centralisés d’origine dans le 2e Bureau (S.R. – S.C.R.) et le 5e Bureau. C’est l’obligation de créer des réseaux indépendants.
3 – Des cadres volontaires de ces réseaux d’active ou de réserve, seront en dehors de l’armée, en congé d’armistice ou bénéficiaires de contrats spéciaux ménageant leur avenir.
4 – Les moyens financiers et matériels de l’ex 5e Bureau seront répartis entre les réseaux. La réserve de fonds secrets est importante et suffira largement aux besoins immédiats de l’ensemble clandestin.
5 – Chaque chef de réseau reprendra contact avec son homologue de l’I.S. La liaison centrale radio avec Londres sera rétablie au sud de Royat.
6 – Des contacts et des accords seront pris avec l’ambassade des États-Unis à Vichy et la légation du Canada, pour assurer la transmission aux alliés des informations recueillies par nos réseaux. Des liaisons seront établies par chaque réseau avec les représentants alliés en pays neutres: Berne, Madrid et Lisbonne.
Ainsi vont naître en juillet 1940 nos réseaux clandestins, homologués à la libération et à partir de cette date dans les Forces Françaises Combattantes (F.F.C.). KLÉBER : Lieutenant-Colonel Perruche – P.C. à Vichy et Royat sous la couverture d’un ” Office du Retour à la Terre “.
SSM/F/TR : Commandant Paillole – P.C. à Marseille, boulevard de la Plage sous la couverture de ” l’Entreprise des Travaux Ruraux “. (T.R. : appellation initiale du réseau).
S.R. Air: Colonel Ronin – P.C. à Cusset avec radio spécifique avec l’I.S. à Londres.
Naissance et caractéristiques des B.M.A.
L’organisation clandestine se substitue de la sorte à la défunte institution officielle de défense. Son caractère révolutionnaire ne nous échappe pas plus que ses conséquences et ses risques. Dès lors, nos réflexions se portent sur le devenir de l’armée et ce que nous devrions en attendre. La création d’une armée de l’armistice est dans l’air. Rivet qui a vécu l’occupation de l’Allemagne au lendemain du traité de Versailles, a suivi, pas à pas la création de la Reichswehr et la naissance de l’Abwehr.
Soutenu par Weygand, il va plaider pour une institution analogue au sein de l’armée de l’armistice. C’est la création d’un organisme de défense contre le communisme, l’espionnage, le sabotage et plus généralement contre “les Menées Antinationales “. Il en revendique la responsabilité, convaincu que nos réseaux clandestins y trouveront les appuis matériels et moraux dont ils auront besoin. Après deux mois de négociations, sa suggestion est entendue le 25 août 1940, la commission d’armistice de Wiesbaden autorise la création du” Service des Menées Antinationales “. Dans chaque Division Militaire Territoriale (en zone libre et en Afrique) seront installés des Bureaux des Menées Antinationales (B.M.A.).
Pour répondre au mieux aux motivations qui nous ont inspirés, cette institution nouvelle doit résoudre avant tout un problème de recrutement et d’encadrement. Rivet et d’Alès vont s’y employer pendant tout le mois de septembre 1940 en piochant dans les ressourcés des B.C.R. dissous en juin 1940.
Au Colonel d’Alès, technicien confirmé, va échoir la direction effective des B.M.A. Il prendra comme adjoint un officier de haute qualité, le Lieutenant-Colonel Bonoteaux. Déporté, Bonoteaux mourra à Dachau dans les bras d’Edmond Michelet. Le Colonel Rivet, placé ” en disponibilité fictive ” (sic) veillera sur l’ensemble officiel et clandestin. Le 1er octobre 1940, le dispositif d’action et de défense est en place et opérationnel. L’appareil défensif en marche de 1940 à 1942
Il était temps.
Depuis juillet 1940, le réseau T.R. clandestin de contre-espionnage que je dirige, a pris vigueur et réactivé la plupart de ses agents infiltrés dans l’Abwehr. Les informations recueillies s’accumulent. Elles sont de deux sortes:
1 – Les informations d’ordre général sur la constitution, les missions, les moyens des services spéciaux ennemis, notamment ceux installés dans notre pays occupé. Leur exploitation fera l’objet de synthèses dont les données seront expédiées en lieu sûr à Alger. Les renseignements susceptibles d’intéresser les alliés (par exemple les directives de recherches données à l’Abwehr par l’O.K.N. car elles traduisent les intentions de Hitler) leur seront transmis.
2 – Les informations d’ordre particulier concernant la France et son Empire. En ce début d’octobre 1940, elles sont alarmantes. Elles prouvent la volonté de l’ennemi de s’opposer brutalement à toutes formes de résistance, d’imposer sa propagande, de s’infiltrer largement en zone libre, dans l’Empire et surtout en A.F.N. Aux moyens spécifiques de l’ennemi: l’Abwehr, Geheimfeldpolizei, S.D., O.V.R.A., S.I.M., etc… s’ajoutent les complicités de mauvais français de tous bords.
Une action défensive, disposant de moyens répressifs de fortune, mais surtout officiels, est urgente. Il faut que les Français comprennent que l’occupant demeure l’ennemi, que travailler avec ou pour lui, c’est toujours trahir au sens de la loi sur l’espionnage, en vigueur dans les zones non occupées où la France demeure encore souveraine.
La répression officielle c’est l’affaire de la Police, de la Surveillance du Territoire et des Tribunaux militaires maintenus dans chaque Division Militaire Territoriale de l’armée de l’armistice en zone libre et en A.F.N.
Le réseau T.R. sera le pourvoyeur principal de cet appareil répressif, sous la couverture des B.M.A. à qui il appartiendra de le mettre en oeuvre sans révéler notre existence et nos sources.
Mission difficile pour ces B.M.A. car ils doivent protéger nos moyens et nos actions, animer des services officiels sous l’œil inquisiteur de l’occupant et la défiance d’autorités vichyssoises de plus en plus acquises à la politique de collaboration. Mission ambiguë, car les B.M.A. seront parfois saisis d’initiatives contraires à cette politique et devront, plus ou moins adroitement, en minimiser les conséquences. Il y aura des bavures.
Il y aura surtout une œuvre fondamentale de couverture de nos réseaux clandestins. L’ennemi ne s’y trompera pas et le ” fusible ” B.M.A. sautera en août 1942. D’Alès sera limogé sans ménagement. La plupart des chefs de B.M.A. seront poursuivis, arrêtés, déportés… Bonoteaux, Delmas, Roger, Proton, Heliot, Denaenne mourront dans les camps nazis Blattes, Jonglez de Ligne, de Bonneval (futur aide de camp du Général de Gaulle) en reviendront meurtris. J’en passe et m’en excuse, car de tels sacrifices consentis en toute connaissance de cause méritent mieux que l’indifférence, le sarcasme ou l’oubli.
T.R. – B.M.A. – Surveillance du Territoire – Justice militaire Pour conclure cet exposé, quelques cas concrets devraient aider à la compréhension du fonctionnement de cet appareil de défense. Au-delà de notre action secrète, nous avons voulu de 1940 à 1942 associer au maximum les forces encore vives de notre nation à notre lutte contre l’occupant. Pour si paradoxal que cela puisse apparaître à certains, nous pouvons nous enorgueillir de l’avoir tenté et souvent réussi. Ce qui suit tend à le démontrer.
Juillet 1940: Une commission d’armistice allemande s’installe à l’Hôtel du Roi René à Aix-en-Provence. Les écoutes installées par notre poste clandestin de Marseille (T.R. 115) révèlent la présence en son sein de membres de l’Abwehr soucieux de l’état d’esprit des militaires, des populations, de l’activité de la flotte, des camouflages d’armes, etc… C’est un jeu d’introduire dans cette commission plusieurs agents de pénétration.
En septembre 1940, T.R. 115 découvre qu’un couple d’origine allemande, réfugié israélite en France depuis 1938, a offert ses services aux nazis. Son activité est intense. Elle menace les entreprises clandestines de camouflage d’armes ainsi que certaines filières d’évasion par voies maritimes ou terrestres.
En décembre 1940, je décide d’y mettre fin. T.R. 115 s’en ouvre confidentiellement au commandant Jonglez de Ligne, chef du Bureau M.A. de la XV° Division Territoriale de Marseille. La surveillance du territoire est alertée. Herbert S. et Hélène G. sont arrêtés. Devant l’abondance des informations sur leurs activités, ils se résignent aux aveux non sans arrogance et la menace d’en appeler aux vainqueurs, leurs employeurs. Devant le” bruit “que cette affaire d’espionnage (la première depuis l’armistice) pourrait susciter en métropole, le Colonel d’Alès, patron des B.M.A. obtient de la Justice militaire que le couple soit discrètement transféré en A.F.N. Six mois plus tard le Tribunal militaire d’Oran condamne l’homme à mort et la femme à la prison sans qu’en aucune circonstance le réseau T.R. ait été mis en cause.
Septembre 1940: Un soldat britannique, Harold C., fait prisonnier en juin 1940, s’évade et se réfugie à Lille. En accord avec nos agents T.R., il organise au profit de l’I.S. un embryon de réseau de renseignements et surtout une chaîne d’évasion.
Nous établissons un relais à Paris avec l’aide du réseau Kléber et faisons aboutir cette chaîne à Marseille chez le correspondant de l’I.S., le Capitaine Garrow en rapport avec notre poste T.R. 115.
Imprudent et trop dispersé, C. est repéré par l’Abwehr et arrêté en mars 1941. Pour échapper à la répression, il accepte de poursuivre son activité sous le contrôle de l’ennemi. Ignorant de ce retournement, nos agents ne peuvent que constater les dégâts dans les réseaux de l’I.S. et en rechercher l’origine. Plusieurs indices font porter les soupçons sur C.
Le sentant brûlé dans le Nord, l’Abwehr décide de le transférer dans la région parisienne où, sous le nom de D., il devra pénétrer l’un des premiers et remarquable réseau de résistance: ” Le Musée de l’Homme “. Ce sera chose faite en juillet 1941. Les arrestations succèdent aux arrestations. Torturé à mort, le grand savant Holweck s’éteindra en février 1942.
Grisé par ses succès, D. a cru bon d’entretenir comme couverture vis-à-vis de l’I.S. et de T.R., la filière lilloise d’évasion et son relais parisien. Ce sera sa perte.
C’est André Postel-Vinay, du réseau Kléber, qui est l’habituel correspondant de C. à Paris. Leurs contacts se multiplient. C. découvre l’activité de Kléber. C’est la bonne affaire pour l’Abwehr. A partir de septembre 1941, ce sont les premières arrestations. Fin 1941, c’est le tour de Postel-Vinay, en 1942 se seront les chefs de poste du réseau.
Alerté, notre poste T.R. 113 de Paris (Michel Garder) a vite fait le rapprochement C.-D.. Un agent de pénétration est infiltré dans la filière avec mission de convaincre l’anglais de “ l’existence “d’une importante filière d’évasion vers la Suisse, basée à Lyon et où il pourrait être introduit. Fort intéressé, C. décide de se rendre en zone libre. Le Ier juin 1942, il arrive à Lyon et tombe dans la souricière organisée par le B.M.A. de la XIX° Division Militaire, alerté par T.R. La Surveillance du Territoire l’arrête et provoque ses aveux.
Devant l’abondance des preuves de ses activités criminelles à Lille et à Paris, il sera condamné à mort par le Tribunal militaire de Lyon quelques jours avant l’entrée de la Wehrmacht en zone libre, le 11 novembre 1942. Il échappera au peloton d’exécution et sous la pression des allemands, le maréchal Pétain accordera sa grâce.
Ce ne sera pas la chance du Français Henri D.. Ce traître qui a fait des ravages dans le réseau ” Combat ” d’Henri Frenay a été fusillé dans le fort de Montluc à Lyon le 16 avril 1942 par un peloton de l’armée de l’armistice.
Employé aux messageries Hachette de Paris, D. faisait chaque semaine depuis fin 1940, un voyage aller et retour à Lyon pour assurer les livraisons de cette entreprise entre les deux zones. Un ausweiss de complaisance permanent lui avait été accordé sur l’intervention de l’Abwehr qui contrôlait de la sorte le trafic des messageries Hachette et pouvait à l’occasion utiliser les services de D.
L’officier traitant de l’Abwehr est une vieille connaissance de nos services clandestins de C.E. Le Hauptmann Binder de l’Ast de Stuttgart est ” pénétré ” depuis 1938 par un agent de notre poste T.R. 114 de Lyon et pas grand chose ne nous échappe de son activité en France. En octobre 1941, ” Combat “qui a grand besoin d’assurer ses liaisons permanentes entre la zone Nord et la zone libre, a repéré à Paris les possibilités offertes par l’homme des messageries Hachette.
Pressenti, D. accepte (après réflexion et accord enthousiaste de Binder) de transporter dans sa camionnette le courrier de ” Combat ” de Paris à Lyon et vice versa.
Dès lors, l’Abwehr va contrôler l’activité de ce réseau. Les arrestations se multiplient. Binder exulte et fait quelques confidences à notre ” pénétrant “. Il parle d’une camionnette Hachette qui circule en permanence entre Paris et Lyon et dont le chargement l’intéresse.
Avec le concours de la gendarmerie de la ligne de démarcation, la camionnette est identifiée par T.R. 114. En janvier 1942, le B.M.A. de Lyon alerté, provoque l’arrestation de son conducteur. D. habilement interrogé par le commissaire Truffe de la Surveillance du Territoire passe aux aveux.
Le dossier de l’affaire est solide! Les dégâts sont graves. Frenay est menacé. Jean Moulin est identifié.
Descours, chef du B.M.A. de Lyon, fait signer par le Général Commandant la 14° Division Militaire un ordre d’informer pour atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat.
La taupe du réseau ” Combat “sera condamnée à mort par le Tribunal militaire. Son recours en grâce sera refusé. Il sera exécuté.
J’invite le lecteur à en méditer le motif officiel: ” Agent rétribué d’une organisation ennemie d’espionnage, Henri D. a recherché et livré des renseignements secrets intéressant la Défense Nationale “. Nous sommes en 1942.
En guise de conclusion J’aurais pu multiplier les cas concrets illustrant cette action répressive, stupéfiante pour certains esprits bornés. De fin 1940 à Novembre 1942, soit en deux ans, il a été procédé en métropole et en A.F.N. à 2.327 arrestations d’agents de l’Axe. Des dizaines furent passés par les armes.
Je me suis borné à trois cas significatifs mettant en cause un Allemand, un Anglais et un Français…(1) Le sort de ce dernier fut impitoyable. Laval, saisi par Abetz de cette ” grave atteinte à la politique de collaboration ” au moment où il revenait au pouvoir, le 18 avril 1942, deux jours après l’exécution de D., allait signifier à Rivet l’arrêt de mort des B.M.A. Mais nos réseaux clandestins étaient saufs.
(1) Les dossiers de ces 3 affaires sont aux Archives de la Justice Militaire au Blanc (36300), ouverts aux chercheurs. Annexe Extraits du rapport du 28 novembre 1942 de la section III de l’Abwehrstelle de Paris. …« Notre contre-espionnage a permis d’avoir les preuves certaines que les services secrets français ont continué au cours des années 1940 à 1942 et en violation des conventions d’armistice, à faire de l’espionnage contre l’Allemagne, notamment contre les troupes d’occupation en territoire français »…
Nota: Le document original trouvé à Berlin en 1945 a été traduit et communiqué au Colonel P. Paillole en 1946 par M. K. du S.D.E.C.E., chargé, dès la fin de 1944 par la D.S.M., de l’exploitation des archives allemandes saisies en France et en Allemagne à partir de juin 1944.