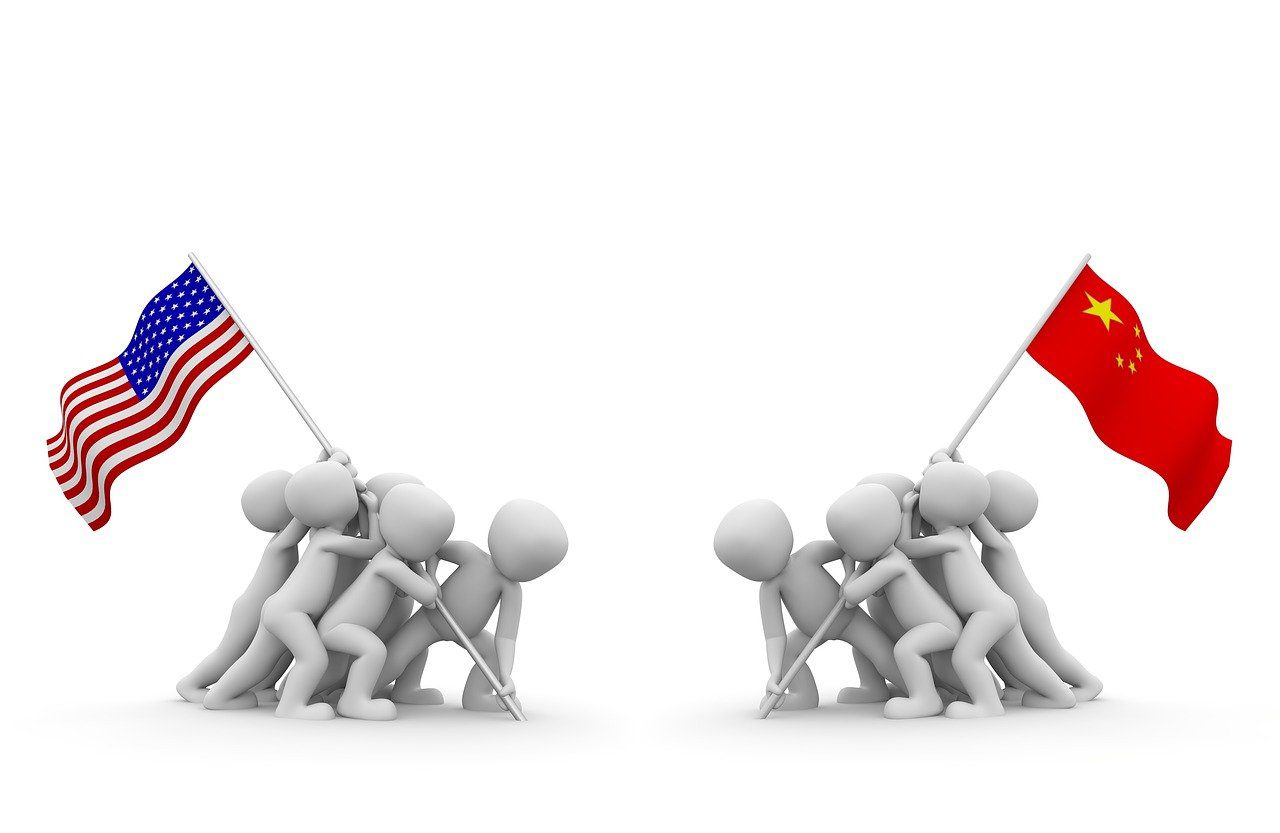Le 22 avril, dans le bureau ovale, D. Trump opérait un sérieux repli tactique sur les droits douane infligés à la Chine dont il a dit qu’ils seraient « réduits de manière substantielle ». Pour faire bonne mesure, il a aussi précisé qu’il s’abstiendrait désormais d’évoquer les origines de la pandémie de Covid-19 et serait « très gentil » à la table des négociations avec Pékin.
En Chine, où une perte de face publique pourrait détruire l’avenir politique de Xi Jinping, l’appareil politique a unanimement réagi par le sarcasme et la défiance.
La classe politique qui affiche une résilience bravache, n’ignore pas que la volte-face s’est produite après les secousses de la bourse et les rencontres du Président avec les PDG des géants de la grande distribution inquiets des conséquences économiques et financières de la hausse des droits de douane.
Wang Yiwei, Directeur de l’Institut des Affaires étrangères à l’Université de Pékin, estime qu’après des semaines de postures démonstratives et de messages contradictoires, la Direction chinoise se méfie de Trump. Pour l’instant, échaudée par ses incessants contrepieds, elle ne croit pas à son discours sur la baisse des taxes.
Elle n’a pas tort.
Alors que la plupart des banques d’investissement ont prévenu qu’une guerre généralisée des droits de douane entrainerait une récession planétaire, D.Trump n’a donné aucune information précise sur l’ampleur de son recul. L’estimation la moins vague est venue d’un officiel de la Maison Blanche qui, « au doigt mouillé » a avancé une plage « à peu près comprise en 50 et 65%. »
Depuis Fudan à Shanghai, Wu Xinbo, Directeur de l’Institut d’études américaines, affirme que la Chine « n’est pas pressée de négocier » et qu’elle serait en mesure de résister aux pressions économiques.
Le pays, dit-il en substance, aurait d’abord intérêt à accepter pour un temps les frictions d’un conflit. « Les négociations dans l’intérêt de la Chine n’en seront que plus faciles. » La réalité est qu’avec seulement 15% de son commerce extérieur lié aux États-Unis, dans ce bras de fer, Pékin dispose d’une marge de manœuvre.
Les déclarations publiques des universitaires sont en phase avec la Direction du régime qui depuis des mois s’applique à afficher la force et la sérénité d’un acteur stable garant de l’ordre international.
En même temps, Wang Yiwei, cité plus haut, estime que les déclarations sur la baisse des taxes ne suffiront pas à amener la Chine à la table des négociations. Selon lui qui prône la résilience et la fermeté, il y faudrait des gestes plus convaincants.
« Si les américains voulaient vraiment négocier, ils devraient commencer par supprimer tous les droits de douane récemment imposés. » (…) « Le moindre signe de faiblesse enverrait le signal que la stratégie des “méga-taxes” a fonctionné. Ce qui pourrait inciter Washington à les augmenter encore. »
Une dérision mêlée d’inquiétude.
Logiquement les réseaux sociaux se sont emparés du sujet sur un mode ultra-nationaliste. Le 23 avril, lendemain du rétropédalage de Trump, près de 200 millions d’internautes chinois échangeaient des messages peu amènes sur Trump. Certains étaient frontalement inflexibles : « On ne négociera pas tant que les taxes ne seront pas complètement supprimées ».
A côté des vindictes, le persiflage populaire avait beau jeu de reprendre la satire du New-York Times du 9 avril par Thomas L. Friedman « Si vous engagez des clowns, attendez-vous à un cirque. Et chers compatriotes, nous avons engagé une équipe de clowns ».
Ou celui de la chaine démocrate MSNBC : « Après avoir pris le système financier mondial en otage, pour, sous la panique, revenir en arrière, c’est par son inconsistance qu’a brillé la Maison-Blanche ». CNN ironisait « Nous connaissons désormais la limite de l’endurance politique de Donald Trump, à savoir une semaine ».
Dans la foulée, en Chine, sur Weibo, le « hashtag » « 特朗普退缩了 – Trump recule – » était vu 150 millions de fois.
*
Pour autant, depuis la Chine, les torses bombés de la Direction politique ne disent pas tout. En privé, certains intellectuels chinois doutent de la sagesse d’une confrontation prolongée avec Washington.
S’adressant à CNN sous couvert d’anonymat, un expert en politique étrangère s’est dit préoccupé par l’impact des droits de douane exorbitants sur l’économie entrée dans un processus de freinage.
« Les autorités chinoises ne disent pas la vérité. La réalité est que l’appareil s’angoisse d’un choc économique majeur. Si les droits de douane de 145 % restaient en vigueur, l’ensemble de notre commerce extérieur serait considérablement impacté, entraînant des pertes d’emplois massives et de probables troubles sociaux, mettant la légitimité du gouvernement en péril ».
Alors que ces vues contraires au discours officiel sont systématiquement censurées, l’exécutif a déjà fait un geste de souplesse en annulant l’embargo intenable pour les compagnies chinoises sur les pièces détachées aéronautiques.
Début avril, un chercheur de l’Académie des sciences sociales, publiait sur son compte WeChat personnel un message vite censuré, qualifiant les contre-mesures chinoises de « totalement erronées ». « L’augmentation des droits de douane par les États-Unis, revient pour eux à soulever une pierre qui leur retombera sur les pieds ; nous ne devrions pas les imiter au risque de nous heurter nous-mêmes. »
Plus largement alors que Donald Trump a été le premier à céder dans cette lutte d’égos et de postures, en Chine même, derrière l’affichage des fiers-à-bras, il existe une coterie politique consciente qu’en 2025, l’objectif de 5% de croissance fixé en mars par l’appareil, sera hors d’atteinte si les exportations restaient à ce point handicapées par les taxes américaines.
Pour l’instant, le moins qu’on puisse dire est que les déclarations ne s’accordent pas tout à fait.
D’un côté, Trump placé sous la pression d’une opposition interne a commencé à comprendre qu’il s’est peut-être engagé dans un combat qu’il ne peut pas gagner. De l’autre, inflexible, l’appareil chinois, moins dépendant de son opinion publique, reste uni sur une attitude de défiance, tandis que les réseaux sociaux sont envahis par les persiflages anti-américains, dont Trump est la tête de turc.
Aux déclarations de Washington laissant entendre que des négociations étaient en cours, l’appareil a opposé un démenti sans équivoque. Le 25 avril dernier, He Yadong le porte-parole du ministère chinois du commerce, a clarifié la situation vue de Pékin : « Toute affirmation sur les progrès des négociations économiques et commerciales sino-américaines est sans fondement et n’a aucune base factuelle. »
Le 28 avril, le porte-parole Guo Jiakun démentait formellement que les deux présidents s’étaient parlés au téléphone « À ma connaissance, il n’y a pas eu d’entretien téléphonique récent entre les deux chefs d’État », (…) « Je tiens à réitérer que la Chine et les États-Unis ne sont engagés ni dans desmconsultations ni dans des négociations sur la question des droits de douane. »
Dans ce contexte, tout indique que, pour l’instant, au moins en apparence, Pékin garde la main.
Sans ignorer les risques pour ses exportations liés aux sanctions, la Direction chinoise peut en effet encore actionner la menace de cesser sa coopération sur le Fentanyl, tout en faisant valoir l’avantage de contrôler 80 % des exportations de terres rares lourdes raffinées indispensables aux industries américaines de l’aéronautique et de la défense. (Voire l’annexe).
En haussant l’analyse d’un étage, constatons qu’à Pékin comme à Washington, flotte l’idée d’un retour nécessaire à la table des négociations. Mais, comme toujours à l’affut des opportunités, l’Appareil qui a pris soin de ne pas céder complètement à la tentation de l’escalade, compte bien tirer profit des hésitations de la Maison Blanche, pour élargir l’éventail du dialogue.
Alors que les injonctions incontournables de la « Face » règleront la rigidité des négociateurs chinois qui ne peuvent donner le sentiment de céder à l’Amérique, il faut s’attendre qu’à l’agenda d’une négociation commerciale s’ajoutent d’autres sujets.
D’abord, ceux touchant aux droits de l’homme revisités au caractéristiques chinoises, chacun dans sa sphère d’influence ; celui aussi du respect mutuel entre grandes puissances. Plus précisément, saisissant l’opportunité pragmatique d’un rapport de forces favorable, Pékin pourrait exiger l’amendement de l’embargo infligées à la Chine sur les hautes technologies.
[A ce sujet, lire nos articles de septembre 2019 : https://www.questionchine.net/la-guerre-mondiale-des-semi-conducteurs ; de décembre 2022 : https://www.questionchine.net/micro-puces-et-droit-de-propriete-la-violente-riposte-americaine-contre-la-chine-et et de septembre 2024 : https://www.questionchine.net/alerte-sur-la-puissance-d-innovation-chinoise ]Surtout, alors que D.Trump a récemment troublé la fermeté de l’alliance entre Washington et Taïwan, [Lire : https://www.questionchine.net/chine-usa-taiwan-les-ambiguites-du-pentagone ], Pékin pourrait saisir l’occasion pour exiger moins de proximité avec Taipei, par exemple sur le niveau politique des visites officielles américaines dans l’Île et sur les ventes d’armes.
Mise à jour le 2 mai.
Le 2 mai, les contrats a terme sur les actions européennes et asiatiques on repris de la vigueur après l’annonce de la Chine qu’elle étudiait la possibilité de négociations commerciales avec les États-Unis. L’optimisme est renforcé par le fait que le Japon s’attend à une accélération des négociations avec Washington et vise lui-même un accord en juin.
Parallèlement, le ministre japonais des Finances déclarait que les obligations américaines détenues par la Chine et le Japon pourraient constituer un atout dans les négociations.
Editorial de François DANJOU
Site : Question Chine
2 mai 2025
******
La suprématie chinoise dans le secteur des « Terres Rares. »
Le 4 avril dernier le ministère du commerce chinois a durci les conditions d’exportation d’aimants et de 7 éléments de « Terres rares lourdes » – samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutétium, scandium, yttrium – utilisées dans les secteurs de la défense, de l’énergie et de l’automation industrielle.
Officiellement la mesure qui n’est pas un embargo, se contente en plus de la limite des « quotas » d’exiger des exportateurs une licence spéciale d’exportation.
Les nouvelles dispositions auront trois conséquences :
1.- A court terme, un arrêt momentané des exportations pendant la mise en place par le gouvernement chinois du système de licences.
2.- Des perturbations d’approvisionnement pour certaines entreprises américaines, d’autant que 16 d’entre elles – dont 15 appartiennent au secteur de la défense – figurent déjà sur la liste chinoise de contrôle des exportations, qui leur interdit d’importer de Chine des biens à double usage.
3.- A moyen terme, la possibilité que la Chine parvienne à rallier contre l’Amérique des appuis soucieux de préserver leur approvisionnement en « Terres rares ».
Alors que la Chine n’a pas imposé de restrictions sur les « Terres rares légères », dont le traitement est assuré par un ensemble plus diversifié de pays, les États-Unis sont particulièrement vulnérables au durcissement chinois sur les « Terres rares lourdes » dont Pékin détient le monopole total d’exportation, depuis qu’en 2024, le fournisseur vietnamien a, à la suite d’un litige fiscal, mis la clef sous la porte.
Les « Terres rares lourdes », monopole chinois et retard occidental.
La sensibilité stratégique de la question se lit dans le fait que tous les équipements de pointe des armées américaines contiennent des « Terres rares lourdes ».
Exemples : le chasseur de combat F-35 en contient 400 kg ; Un destroyer DDG-51 de la classe Arleigh Burke, une des pièces maîtresses de la Flotte du Pacifique où elle rivalise avec la marine chinoise, plus de 2 tonnes ; Un sous-marin de la classe Virginia, plus de 4 tonnes. Il en va de même pour les missiles de croisière, les systèmes radar, les drones Predator et la série de bombes dites intelligentes « Joint Direct Attack Munition ».
Alors qu’aux États-Unis, le rythme de production de l’industrie de défense est cinq fois inférieur à celui de la Chine – notamment pour les équipements navals – [Lire : https://www.questionchine.net/la-marine-chinoise-lance-deux-destroyers-geants ] le durcissement chinois sur les Terres rares creuse inexorablement l’écart entre les capacités militaires des deux rivaux stratégiques.
En dépit des récents investissements américains – notamment près de 700 millions de $ entre 2020 et 2022 dans l’extraction et le traitement des terres rares sur le site de « Mountain Pass », (50 km au nord de Salt-Lake City – Utah – ) et à Fort Worth au Texas, avec pour objectif la capacité autonome de répondre à partir de 2027 aux besoins de la défense -, le décalage d’échelle avec les capacités chinoises est considérable.
En 2024, alors que le système de production américain était pleinement opérationnel, la société MP Materials au cœur de l’industrie des Terres rares aux États-Unis, n’a produit que 1300 tonnes d’aimants de qualité stratégique contre 300 000 tonnes produits par la Chine.
En bref, dans un avenir prévisible, les États-Unis seront irrémédiablement à la traîne par rapport à leur rival chinois.
Une tendance à l’œuvre depuis 2010.
L’actuelle situation où l’on voit la Chine valoriser sa domination du secteur des Terres rares était prévisible. En 2010, elle avait pour la première fois utilisé son monopole comme arme en interdisant leur exportation vers le Japon à la suite d’un litige concernant des chalutiers de pêche.
Entre 2023 et 2025, elle a imposé des restrictions à l’exportation de matériaux stratégiques vers les États-Unis, notamment le gallium, le germanium, l’antimoine, le graphite et le tungstène.
En 2023, aux États-Unis, le Comité spécial sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois publiait un rapport intitulé « Réinitialiser, prévenir et construire une stratégie pour remporter la bataille économique entre l’Amérique et le Parti communiste chinois ».
Il recommandait que « le Congrès encourage la production d’aimants qui constituent la principale utilisation finale des éléments de Terres rares utilisés dans les véhicules électriques, les éoliennes, les technologies sans fil et de nombreux autres produits. »
Plus précisément, il préconisait que le Congrès mette en place des incitations fiscales pour promouvoir l’industrie manufacturière américaine.
En décembre 2023, l’interdiction sur son sol des opérations d’extraction par la Chine qui détient le monopole des techniques d’extraction et de séparation des terres rares par solvant eut un impact direct sur les circuits d’approvisionnement hors de Chine, d’autant plus durable qu’en Occident le rattrapage capacitaire sera long.
Les solutions alternatives pour contourner le monopole chinois sont en cours en Australie, au Brésil, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, au Japon et au Vietnam. L’Australie est en pointe avec le site de Lynas à 700 km au Nord-Est de Perth, plus important gisement de Terres rares hors de Chine.
Pour l’instant cependant, le site fait encore procéder au raffinage en Chine qui détient toujours le monopole du traitement du minerai en aval. Les plus optimistes estiment que l’Australie ne maitrisera pas l’ensemble du processus avant 2026.
Depuis 2010, quand dans un bras de fer avec Tokyo sur les zones de pêche, Pékin avait usé du levier des Terres rares, le Japon sera à terme une autre source de contournement. Par son Institut de technologie de Muroran, il s’est en 2012 rapproché du Centre de recherche et de transfert de technologie sur les Terres rares de Hanoï au Vietnam.
Questions critiques par Gracelin BASKARAN et Meredith SCHWARTZ
Site : CSIS
14 avril 2025