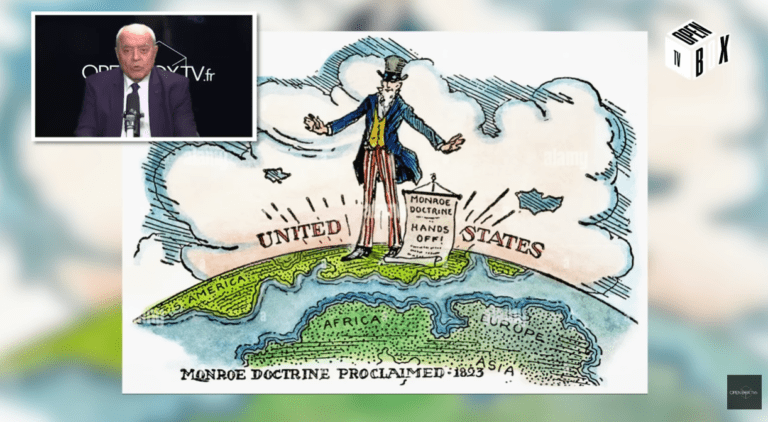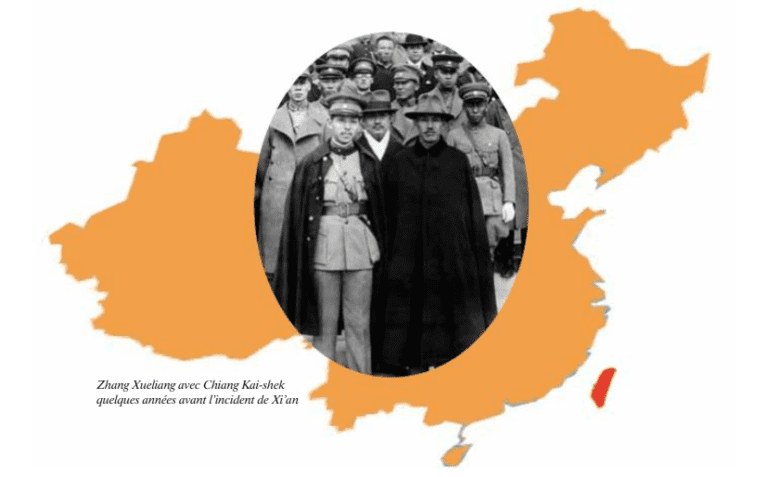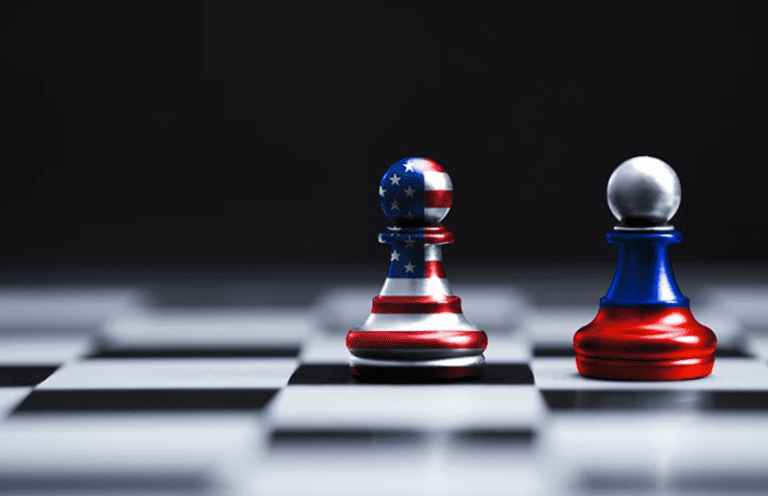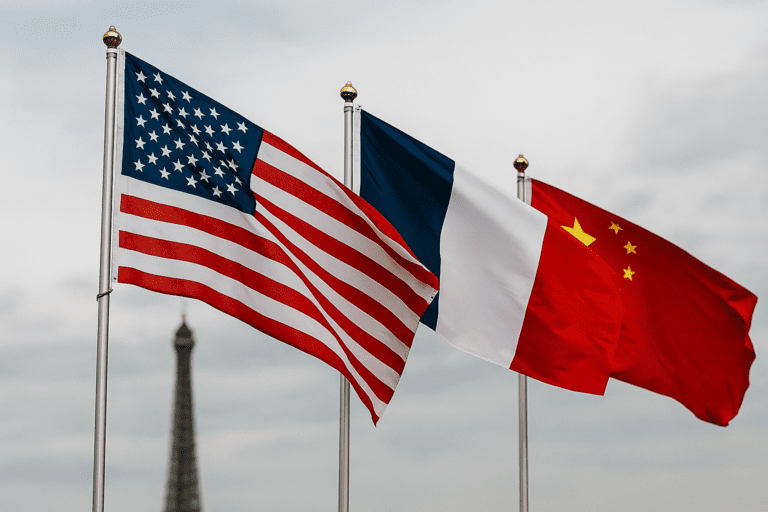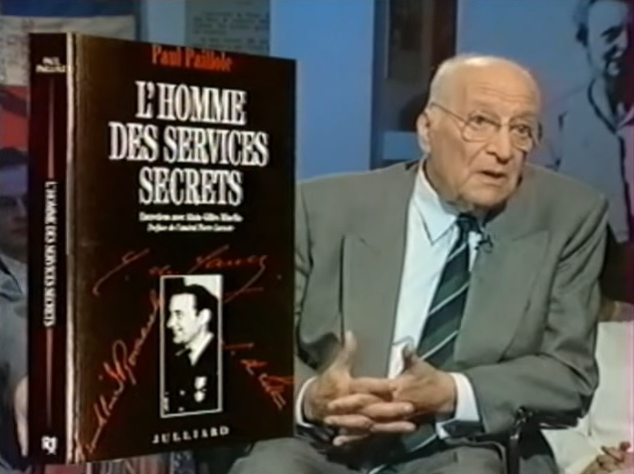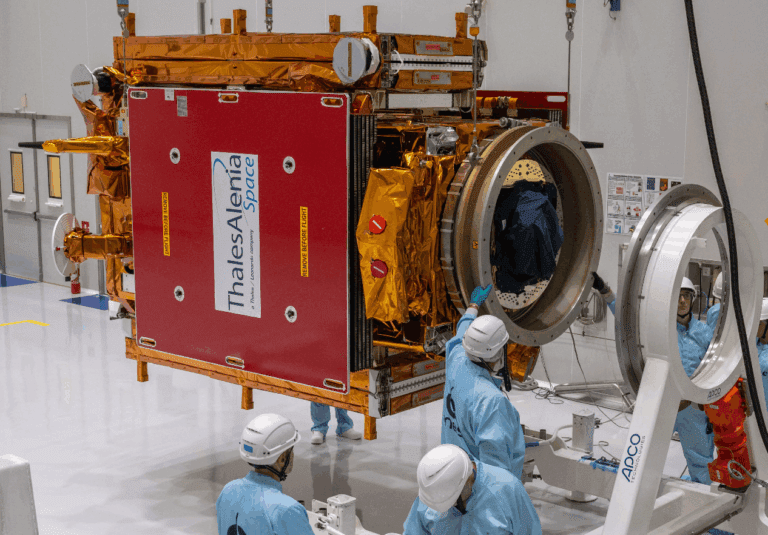Comprendre les stratégies des Etats-Unis et de la Chine.
Quelle stratégie d’influence et d’indépendance pour la France ?
Vous avez sans doute vu les cours de l’or qui poursuivent leur hausse à plus de 4 200 dollars l’once tandis que l’argent métal, lui aussi monte à n’en plus finir à plus de 53 dollars l’once. Ces deux métaux cherchent à nous dire des choses sur ce qui vient, et ce qui vient sera dévastateur pour les grands équilibres géopolitiques et donc pour les grands équilibres économiques, l’organisation de l’économie mondiale n’étant que l’intendance de la géopolitique.
Vous avez sans doute compris aussi que nous étions pris dans un combat de Titans pour la domination du monde entre trois blocs qui ne sont finalement pas si nouveau que cela.
La Russie et la Chine (avec quelques alliés de ces deux pays) forment le premier bloc. Le second bloc est celui des Etats-Unis et de ses alliés que l’on appellera le bloc atlantiste.
Enfin le troisième bloc est celui des pays non-alignés. Pour la petite histoire et la grande, à Bandoeng (conférence qui portera le nom de cette ville dans les manuels d’histoire) en 1955, l’Égyptien Nasser et l’Indien Nehru revendiquent leur « non-alignement », à égale distance des deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS…
Nous en sommes à nouveau là et une nouvelle guerre froide économique, numérique et technologique menace le monde.
Dans cette guerre hybride que se mènent les deux grands blocs Chine/Russie et Otan de l’autre, il y a une opposition intellectuelle qui sépare les deux camps et sur laquelle je souhaitais partager avec vous quelques considérations et réflexions pour enrichir les analyses de tous.
« L’art de la guerre » et « l’art du deal » sont deux approches stratégiques qui, à première vue, semblent totalement opposées dans leurs objectifs et leurs méthodes. Cependant, en les examinant de près, on découvre des analogies fascinantes qui permettent de mieux comprendre la manière dont la Chine, sous la direction de Xi Jinping, et Donald Trump, à travers ses écrits et sa pratique des relations et des négociations, abordent la politique, la domination et la gestion du temps long. Vous savez que cela fait des années maintenant que je vous conseille de lire Donald Trump dans le texte de même qu’il faut absolument lire l’ouvrage de JD Vance pour comprendre l’actuel Vice-président des USA qui est à mon avis le prochain président des États-Unis et certainement plus rapidement que l’on ne le pense.
D’un côté, l’art de la guerre : une approche indirecte et stratégique
En général il faut du temps et de la maturité pour comprendre « l’Art de la guerre » de Sun Tzu, écrit il y a environ 2 500 ans, qui est une œuvre majeure de la stratégie militaire chinoise et de ses extensions politiques. Il y a bien longtemps que la Chine a utilisé cet ouvrage pour élaborer une vision du pouvoir qui repose sur des principes subtils et indirects. La guerre, pour Sun Tzu, n’est pas une simple confrontation brute de forces, mais une série de manœuvres intellectuelles et psychologiques qui visent à déstabiliser l’adversaire avant même le début des hostilités. En réalité pour Sun Tzu le raffinement suprême est de réussir à vaincre l’adversaire sans même à avoir à tirer un coup de canon… ou de décocher une flèche puisqu’à l’époque il n’y avait pas encore de canon ou de missiles guidés laser !
Xi Jinping, en tant que leader de la Chine contemporaine dépositaire de l’héritage de ses prédécesseurs, incarne cette philosophie dans sa gestion de la politique internationale et de la puissance chinoise. La stratégie chinoise, sous son impulsion, se base sur une planification à long terme, un pragmatisme stratégique et une capacité à investir dans des « armes » douces comme l’économie (en devenant l’usine du monde et en créant des dépendances devenant des armes redoutables), la diplomatie et les alliances. Le temps joue un rôle clé dans la politique chinoise. Contrairement à l’agitation, à la rapidité des marchés boursiers occidentaux court-termiste sans oublier les processus politiques occidentaux souvent chaotiques, la Chine avance sur un rythme qui parfois peut sembler bien plus lent, mais extrêmement calculé, visant à dominer progressivement la scène internationale sans confrontation directe.
L’une des caractéristiques essentielles de l’approche chinoise est la patience. Tout comme dans l’Art de la guerre, où Sun Tzu préconise d’attendre le moment favorable pour attaquer, Xi Jinping, dans sa gestion des relations internationales, privilégie des étapes successives, parfois invisibles, pour atteindre ses objectifs. Cela se traduit, par exemple, par l’approfondissement des investissements dans des régions stratégiques à travers des initiatives comme la Nouvelle Route de la Soie. La Chine mène ainsi une guerre « sans arme » à l’échelle mondiale, préférant la stratégie du « soft power » pour étendre son influence sans provoquer une confrontation ouverte.
Aujourd’hui, pour Xi Jinping le moment de la confrontation est arrivé. La Chine construit un porte-avions par an. La Chine peut construire 20 millions de drones militaires par an. La Chine contrôle 95 % des terres rares du monde et vient de bloquer potentiellement avec sa nouvelle législation tout le complexe militaro-industriel occidental.
De l’autre, l’art du deal : une approche directe et audacieuse
L’ouvrage L’Art du Deal de Donald Trump, publié en 1987, a révélé sa manière de négocier dans le monde des affaires et si en France on aime à le faire passer au mieux pour un benêt simplet, au pire pour un imbécile fasciste d’extrême droite, en réalité très peu ont pris le temps de lire les différents ouvrages de Donald Trump et de comprendre sa personnalité et ses modes de fonctionnement assez peu conventionnels il est vrai. Trump y prône une approche bien plus directe, agressive et opportuniste que celle de Sun Tzu. Là où la stratégie chinoise consiste souvent à travailler dans l’ombre, Trump met en avant des tactiques de négociation très visibles, parfois brutales, qui visent à maximiser l’intérêt personnel à court terme, parfois au détriment des autres parties.
Dans l’ouvrage, Trump expose une vision du pouvoir et des relations humaines fondée sur l’affirmation de soi, le contrôle de la narration et la capacité à imposer des décisions sans concessions. Il n’hésite pas à utiliser la menace, l’intimidation et la manipulation, des techniques qu’il qualifie d’éléments essentiels pour parvenir à ses fins. Trump fait souvent appel à l’idée de « prendre le contrôle », et son approche du deal est marquée par la volonté de tout négocier au maximum, sans respecter forcément les règles de courtoisie ou les principes traditionnels de diplomatie.
C’est exactement ce qu’il vient de rappeler avec cette affaire de narco-trafiquants venant du Venezuela et dont il fait tout simplement bombarder les bateaux.
Cela peut sembler « bas du front » mais c’est simple, direct et efficace. Cela constitue évidemment une rupture majeure avec l’attitude policée en vigueur. Une attitude policée qui peut d’ailleurs définir la géopolitique chinoise en apparence.
L’un des aspects les plus frappants de cette manière de faire est donc le recours à l’élément de surprise et à la force, souvent au détriment de relations plus longues et construites dans la confiance. Trump, en tant que négociateur, privilégie une méthode de confrontation directe où l’objectif est d’obtenir des résultats tangibles immédiatement. Cette vision est particulièrement manifeste dans sa gestion des négociations commerciales, par exemple avec la Chine, ou lors de ses entretiens avec des leaders étrangers. Le tout est de maximiser l’intérêt économique immédiat, quitte à rompre des conventions ou à faire preuve d’un cynisme calculé. Enfin c’est ce que semble être perceptible dans une première grille de lecture pourtant nettement plus nuancée que cela !
Deux conceptions du temps long
L’une des différences fondamentales entre l’art de la guerre et l’art du deal réside dans leur rapport au temps.
Pour Sun Tzu, le temps est essentiel, mais il est vu à travers le prisme de la patience. Une victoire rapide n’est pas forcément synonyme de réussite : il s’agit de connaître le bon moment pour agir, de planifier avec une vision à long terme et de préparer l’adversaire à une défaite qui semblera presque inéluctable. Dans ce cadre, la durée de la confrontation est relative et peut être étendue pour épuiser l’ennemi ou le désorienter. Le temps est une ressource précieuse, car l’objectif final vise à atteindre un résultat sans confrontation ouverte.
Xi Jinping, dans cette logique, applique la même philosophie à la politique. Il cherche à projeter la Chine comme une puissance mondiale de manière progressive et systématique, en utilisant tous les leviers économiques, diplomatiques et militaires qui s’inscrivent dans des stratégies de « long terme » et non dans la précipitation. La montée en puissance chinoise, avec ses ambitions technologiques et sa présence accrue sur la scène internationale, est une démonstration manifeste de ce long travail de domination mondiale.
À l’opposé, Trump opère sur une temporalité qui semble beaucoup plus courte et plus agressive. Cette approche est assez logique. Xi Jinping est au pouvoir pour plusieurs décennies et n’a pas à se soucier de sa réélection au bout de 4 ans ce qui est le cas du président américain qui est au mieux là pour 4 ans ! Pour Trump il n’y aura pas de second mandat il est donc là au maximum pour 4 années. En réalité il ne lui en reste déjà plus que trois. Son approche du temps se caractérise donc par une forme d’impatience évidente à obtenir des résultats immédiats. Chaque deal ou négociation est un affrontement qui doit conduire à un bénéfice tangible sur le court terme. Pour autant Trump ne souffre pas d’une absence totale de vision à long terme.
Bien au contraire.
Tout ce que vous voyez Trump faire et mettre en place l’est pour le long terme et pour donner des chances à l’Amérique d’affronter la Chine dans leur guerre pour le leadership mondial. Son alliance incomprise avec tous les géants de la Silicon Valley va d’ailleurs dans ce sens. La fin du wokisme, le réarmement psychologique des Américains, l’idée de Make America Healthy Again et de rendre la santé physique à la population américaine devenue obèse, tout concourt à une stratégie de long terme.
Le mode de pensée rapide, réactif, opportuniste et souvent basé sur des calculs immédiats que l’on prête à Trump comme étant les seuls éléments définissant sa politique est une erreur d’analyse majeure.
La stratégie de l’Art du deal à la Trump doit se comprendre comme agissant sur plusieurs niveaux de temps. Il y a les effets immédiats et visibles, puis le moyen et le long terme. Trump maîtrise parfaitement les différents horizons de temporalité stratégique. Mais Trump, s’adresse à l’Américain moyen. Il parle simple. Il parle clair, il parle fort, il parle sans ambiguïté et sans langage d’énarque… mais ne vous y trompez pas, quand il parle ainsi ce n’est pas parce qu’il ne sait pas penser autrement et c’est valable aussi pour JD Vance qui pour un universitaire sait également parler simple et clair.
Différentes conceptions de la domination
Allons un peu plus loin.
Là où l’Art de la guerre de Sun Tzu voit la domination comme une conquête indirecte, réfléchie et mesurée, l’art du deal de Trump conçoit la domination comme une confrontation directe et une affirmation de sa propre volonté.
Xi Jinping, à travers la stratégie chinoise contemporaine, semble moins soucieux de l’affrontement direct que de l’emprise silencieuse sur l’échiquier mondial.
La Chine cherche à devenir une superpuissance non pas en renversant l’ordre mondial actuel, mais en l’adaptant à ses propres intérêts à travers des stratégies subtiles, comme les investissements à l’étranger, l’exploitation des failles économiques et la gestion de crises mondiales. Cette approche est beaucoup plus lente mais ne cesse de gagner en influence en créant spécifiquement des dépendances, car toute la stratégie de domination chinoise peut se résumer à un résultat et un objectif majeur: créer des dépendances pour créer la soumission et l’obéissance.
Trump, lui, envisage la domination comme un processus fait d’actions plus ponctuelles et plus brutales, il cherche à dicter les termes de chaque contrat, à marquer son territoire, et à imposer ses conditions. Que ce soit avec la Chine, l’Union Européenne ou d’autres acteurs mondiaux, sa stratégie de négociation repose sur la mise en avant d’un rapport de force où il occupe toujours la position de négociateur dominant.
Deux visions du monde, un combat de titans !
Les stratégies de Xi Jinping et de Donald Trump illustrent deux visions profondément différentes de la politique, de la domination et du temps. Alors que Xi Jinping incarne la patience, l’indirect, la stratégie long terme inspirée de Sun Tzu, Trump peut sembler représenter l’opportunisme, l’affrontement direct, et une vision de la négociation qui se base sur l’instantanéité et la maximisation des gains immédiats. Ces deux approches mettent en lumière des conceptions du pouvoir profondément différentes, et l’on peut se demander laquelle d’entre elles se révèlera la plus efficace dans le monde de demain.
La réponse est loin d’être évidente. Intuitivement on pourrait penser que la Chine avec son temps long est avantagée, mais il ne faut pas imaginer que les États-Unis ne raisonnent pas non plus à 30 ou 50 ans. Il ne faut pas imaginer que l’action de Trump se résume uniquement à ses saillies télévisées et scénarisées pour plaire à son électorat. Il ne faut pas non plus imaginer que seule la dimension temps rentre en compte. Il y a la capacité d’innovation, d’attraction des talents, l’idée de liberté et de promesses d’enrichissement, la croissance économique, les marchés financiers et encore de nombreux autres facteurs qui permettent d’articuler une stratégie cohérente, et ce qui est certain c’est que la Chine comme les États-Unis sont en train de déployer des stratégies complexes et d’une très grande cohérence pour s’affronter.
Un combat de titans dont nous ne serons non les héros mais les victimes, si nous aussi, les Français, en dehors même de l’Europe ne pensons pas non plus notre puissance et notre indépendance en remettant au cœur de notre stratégie la souveraineté du pays.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !
Charles SANNAT
INSOLENTIAE