Conflit armé longue durée : L’armée israélienne à l’épreuve du temps
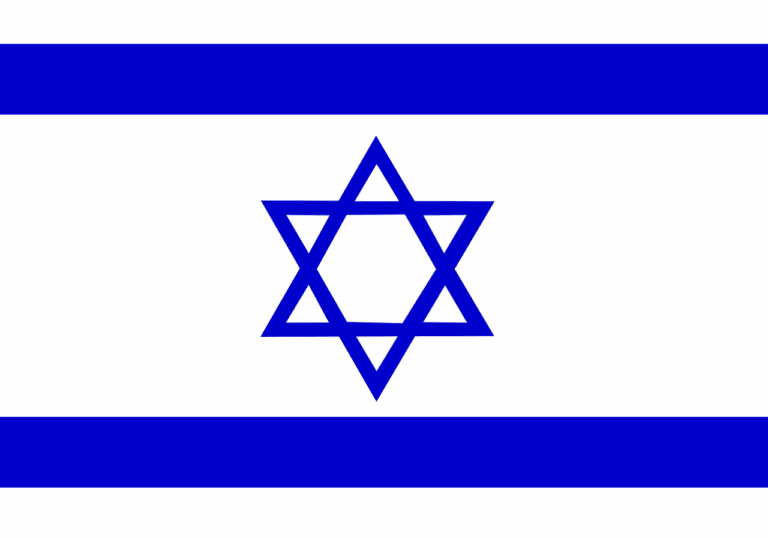
L’armée israélienne à l’épreuve du temps :
Enjeux et défis d’un conflit de longue durée
Face à une situation particulièrement complexe et dangereuse pour Israël, vient l’interrogation sur la capacité réelle dont il dispose pour mener un conflit prolongé. Peut-il encore soutenir un effort militaire aussi intense sur plusieurs théâtres d’opérations sans compromettre son modèle stratégique ? Ses forces armées, malgré leur supériorité technologique affichée et leur préparation revendiquée pour les conflits asymétriques, peuvent-elles faire face à une guerre d’usure imposée par un ensemble d’adversaires aux stratégies diversifiées et pas nécessairement coordonnées ?
Le 7 octobre 2023, le Hamas lance depuis Gaza une attaque massive et multidimensionnelle contre Israël — la plus meurtrière qu’il ait connu depuis sa création en 1948, avec environ 1200 morts et 251 personnes capturées. Outre le bilan humain, cet épisode marque également un point de non-retour pour la défense israélienne. Avec 3000 roquettes tirées en une journée, des incursions terrestres inédites (par les airs avec des parapentes motorisés, par la terre en franchissant les barrières de sécurité avec des explosifs et par la mer avec des commandos), une réactivité israélienne jugée a posteriori particulièrement lente, de flagrantes failles dans l’appareil sécuritaire de l’État hébreu ont fait surface.
Pis encore, Tel Aviv s’est depuis enlisé dans un conflit à plusieurs fronts, menaçant d’une part son modèle stratégique basé sur la supériorité technologique, la dissuasion (nucléaire) et l’anticipation, et d’autre part sa réputation d’armée la plus puissante du Moyen-Orient, suréquipée face à des voisins aux armements considérés comme obsolètes et peu menaçants. Tsahal mène une guerre de haute intensité dans la bande de Gaza, frôlant la destruction complète de cette zone d’un point de vue matériel, avec plus de 30 000 raids aériens et un contrôle terrestre prolongé visant à défaire le Hamas. Israël lutte aussi contre le Hezbollah libanais, tant sur son propre territoire que dans le Sud-Liban, ce dernier ayant tiré des milliers de roquettes et drones-suicides, forçant l’évacuation massive de localités israéliennes. En mer Rouge encore, les Houthis ciblent des navires qu’ils estiment affiliés à Israël et tentent de contrôler les flux maritimes. À l’est enfin, Israël voit l’Iran enfin répliquer par la force armée aux attaques israéliennes sur son territoire, à l’image de l’attaque de drones iraniens dans la nuit du 13 au 14 avril 2024, après les frappes israéliennes du 1er avril sur le consulat iranien de Damas (côté iranien, l’opération est appelée « Promesse honnête », va’deh-yé sâdeq en persan).
Sur le plan interne encore, ces crises et conflits attisent des tensions sociopolitiques déjà lourdes, mêlant contestations du gouvernement Netanyahou, interrogation sur ses objectifs stratégiques réels (récupération des Israéliens détenus par le Hamas ou destruction de ce dernier ?) et critiques de la réforme institutionnelle lancée par ledit gouvernement pour réduire les pouvoirs de contrôle de la Cour suprême. Du fait de ce projet de réforme, c’est non seulement une fracture de la société et de la cohésion nationale qui est engendrée, mais plus concrètement un risque pour la solidité de l’armée israélienne : des milliers de réservistes, notamment dans l’armée de l’air et dans les unités cybernétiques, menacent de ne plus servir. Par ailleurs, la mobilisation massive de plus de 360 000 réservistes — une première depuis la guerre du Kippour, un demi-siècle plus tôt — pressurise l’économie israélienne, qui a vu son PIB reculer de 20 % au quatrième trimestre 2023, sans évoquer la baisse drastique des investissements étrangers.
État de la défense israélienne : un appareil militaire sous pression
Depuis le 7 octobre 2023, la défense israélienne est mise à rude épreuve, contrainte de multiplier les fronts et les opérations. D’inattendues vulnérabilités sont apparues dans son système de sécurité, imposant une réévaluation stratégique, tant la pression continue sur plusieurs fronts : à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi en Iran et au Liban. Le budget israélien de défense, l’un des plus élevés au monde avec environ 30 milliards de dollars en 2024 (soit environ 5 % de son PIB), a été rehaussé pour financer l’effort de guerre. C’est une augmentation de quasiment 50 % (environ 55 milliards de shekels, soit 14 milliards de dollars) qui a été décidée en 2024, sans compter 14 autres milliards de dollars d’aide américaine comportant entre autres des livraisons accélérées de munitions et de systèmes d’interception. Malgré ce budget de guerre, c’est environ 250 millions de dollars qui sont quotidiennement consommés par Israël pour ce conflit, éreintant encore plus son économie déjà fragilisée par le ralentissement de sa croissance et la baisse des investissements directs étrangers. L’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant avait d’ailleurs évoqué que le prolongement de la guerre pourrait nécessiter des coupes budgétaires supplémentaires.
L’armée israélienne est par ailleurs autant mobilisée qu’elle subit une tension croissante. Tsahal dispose d’environ 169 500 soldats actifs et 465 000 réservistes, en faisant donc l’une des armées les plus militarisées du monde par rapport à sa population. Après l’attaque du Hamas, Israël a déployé près de 360 000 de ses réservistes, une mobilisation record ajoutant à la pression économique et sociale du pays. Après plus d’un an et demi de conflit enfin, la fatigue morale et physique se fait sentir chez les troupes israéliennes, particulièrement chez les unités sur le front, alors que les délais de rotation sont allongés, réduisant d’autant plus leur moral et leur efficacité opérationnelle. Le Dôme de fer, système israélien de défense antimissile ayant intercepté plus de 90 % des roquettes tirées depuis Gaza, a également été continuellement sollicité par l’intensité des attaques. Face aux frappes avérées et aux menaces balistiques grandissantes, Israël a également déployé la Fronde de David (système d’interception de missiles et roquettes, élaboré en partenariat avec l’entreprise américaine Raytheon) pour intercepter des missiles de plus longue portée, à laquelle se rajoute le système Arrow 3 contre les missiles balistiques iraniens, parachevant sa défense aérienne multicouches.
La réponse iranienne des 13 et 14 avril 2024, plutôt que de démontrer les capacités d’interception israéliennes, en expose plutôt les carences : avec une sommation iranienne de 48 heures avant l’attaque, l’annulation de tous les vols civils dans l’espace aérien israélien, l’assistance armée des États-Unis, de la France, de la Jordanie et du Royaume-Uni, « seulement » 90 % des drones et missiles ont été interceptés. Les 300 drones et missiles tirés par l’Iran à ce moment ne représentent qu’une partie minime de tout son arsenal, qui pourrait donc lourdement percer la défense israélienne en cas d’attaque massive sans sommation. L’industrie militaire israélienne est par ailleurs au cœur de l’effort de guerre, l’État hébreu étant un acteur incontournable en matière d’armement, avec des entreprises comme Elbit Systems, Israel Aerospace Industries et Rafael, ces dernières ayant augmenté leur production pour répondre à la demande. Cependant, les stocks de certaines munitions — notamment les obus de 155 mm et les missiles intercepteurs — s’amenuisent, aggravant la dépendance aux livraisons américaines et européennes. Si Tsahal reste technologiquement très avancé et possède des alliés occidentaux de poids, l’usure prolongée de son appareil militaire et les multiples fronts ouverts posent avec acuité la question de sa capacité à tenir un conflit de longue durée.
Forces de la défense israélienne : atouts stratégiques et militaires
Tsahal dispose d’indéniables atouts militaires et stratégiques lui permettant de maintenir une haute capacité opérationnelle, malgré le lourd conflit dans lequel il évolue. Son adaptabilité tactique, sa supériorité technologique, le soutien occidental, son renseignement avancé et sa réactivité militaire restent au cœur de sa puissance. Il possède un écosystème de défense en faisant l’une des armées les plus technologiquement avancées au monde, avec une combinaison d’armements de pointe, de cybercapacités (avec son Unité 8200 pour la cyberdéfense et la guerre électronique, qualifiée par Peter Roberts, chercheur au Royal United Services Institute de « meilleure agence de renseignement technique au monde, qui se situe au même niveau que la NSA à tout point de vue, sauf l’échelle ») et de systèmes de surveillance. Israël est usuellement considéré comme faisant partie des trois premières puissances mondiales en cybersécurité, avec la Chine et les États-Unis. Il peut ainsi neutraliser les communications adverses, infiltrer les réseaux ennemis et intercepter des données sensibles. L’objectif qu’il s’est fixé est de compenser sa faible profondeur stratégique (lié à son territoire restreint) par une haute capacité de renseignement et d’anticipation, en théorie. Ses moyens technologiques (SIGINT, écoutes, satellites d’observation Ofek) et son réseau d’espionnage lui octroient des informations capitales sur ses adversaires réels et potentiels. C’est avec de telles capacités de renseignement qu’Israël a pu mener des assassinats de hauts dirigeants du Hamas en 2024, à l’image de Saleh al-Arouri [le 2 janvier] à Beyrouth, Ismaël Haniyeh [le 31 juillet] à Téhéran ou encore Hassan Nasrallah [le 27 septembre], figure historique du Hezbollah libanais, à Beyrouth également.
Pour encore compenser son manque de profondeur stratégique, Tel Aviv peut compter sur la capacité de réaction quasi-immédiate de son armée et de sa réserve (après le 7 octobre 2023, il faut 48 heures pour mobiliser près de 300 000 réservistes) et sur le soutien des États-Unis. Avec le U.S.-Israel Memorandum of Understanding on Security Assistance du 14 septembre 2016, ce sont 38 milliards de dollars qui sont fournis sous forme d’aide militaire pour la période 2019-2028. Outre l’approvisionnement en munitions (obus de 155 mm, missiles pour son Dôme de fer notamment), Israël est entre autres le seul État du Moyen-Orient à posséder des chasseurs F-35 et peut compter sur des centaines de tonnes de matériel militaire expédiés par les États-Unis depuis le 7-Octobre, sans oublier le déploiement de leurs porte-avions en Méditerranée et autour du détroit de Bab el-Mandeb. En ajoutant à cela son expérience accrue des guerres conventionnelles ou non (avec plus de dix conflits majeurs depuis 1948), Tsahal sait combattre sur plusieurs fronts à la fois et en environnement urbain (l’armée israélienne a immédiatement développé des unités spécialisées en guerre souterraine et de nouveaux capteurs pour contrer les tunnels du Hamas). Sa capacité d’adaptation et sa doctrine militaire fournie restent des atouts majeurs en sa faveur.
Faiblesses et vulnérabilités israéliennes : les limites d’un modèle éprouvé
L’armée israélienne, bien que connue et reconnue pour son efficacité opérationnelle et sa technologie avancée, fait face à nombre de vulnérabilités et défaillances, menaçant son efficacité dans un conflit de longue durée. Ces faiblesses peuvent engendrer, outre un affaiblissement de la défense israélienne, un profond risque stratégique. La mobilisation prolongée des réservistes depuis octobre 2023 provoque un épuisement physique et psychologique, auquel se couple un plus que fragile équilibre social. Les crises politiques à répétition, les manifestations de masse, les tensions internes et critiques du modus operandi de Benyamin Netanyahou ainsi que la réforme judiciaire renforcent un sentiment de fracture sociale.
Outre l’épuisement des soldats et l’érosion de la cohésion nationale, se fait jour une réelle tension sur les stocks de missiles et de munitions guidées, suite aux frappes prolongées sur Gaza et le Sud-Liban. Les difficultés d’approvisionnement rencontrées concernant ces munitions essentielles pour le combat en milieu urbain constituent un facteur pouvant compromettre les futures opérations israéliennes. L’aide américaine envers Israël, à hauteur de 3,8 milliards de dollars, ne semble pas être pour le moment dans le viseur de Donald Trump et de sa politique récente de reconfiguration de l’échiquier international (coupes drastiques de l’aide à l’Ukraine, lourde incitation envers les membres de l’OTAN à rehausser leur budget de défense, retour de la guerre commerciale avec la Chine, etc.). Cependant, des ajustements pourraient survenir à moyen et long terme, et un changement d’administration pourrait avoir un impact si le conflit venait à s’enliser. L’aide militaire américaine constitue donc un facteur stratégique majeur et Israël pourrait se trouver dans une situation vulnérable en cas de cessation ou de diminution de celle-ci. Enfin le conflit multi-fronts dans lequel se trouve Israël (Gaza, Liban, Iran, Yémen) distend ses capacités humaines et matérielles autant que sa faculté de réaction rapide et de stratégie d’ensemble. En cas de prolongation et d’élargissement du conflit, ce sont bien des limitations opérationnelles qui pourraient alors apparaitre, contraignant Israël à prioriser certains fronts.
Israël pourra-t-il tenir un conflit destiné à durer ?
La résilience d’Israël est mise à l’épreuve depuis le 7 octobre 2023. Tsahal démontre certes une puissance militaire redoutable, mais plus dans des conflits courts et intenses que dans des combats persistants aux nombreux épicentres. De sérieuses interrogations sur son endurance stratégique émergent à l’heure où Tel Aviv fait face à ce dilemme : comment maintenir une pression militaire constante tout en évitant l’essoufflement de ses ressources ? Ses bombes guidées JDAM et ses munitions d’artillerie commencent à s’épuiser, son système de défense Dôme de fer se base sur des missiles couteux, le prix unitaire oscillant entre 40 000 et 100 000 dollars et la mobilisation des réservistes et de la société civile s’étiole. Parallèlement, bien que la capacité industrielle israélienne soit avancée, elle ne permet pas une production rapide et en masse de tous les équipements sophistiqués utilisés, à l’image des avions de combat F-35 nécessitant des pièces produites seulement aux États-Unis.
Cette guerre d’usure avantage en réalité les adversaires d’Israël, quand bien même ceux-ci ont pu connaitre des revers largement médiatisés par Tel Aviv, à l’image de l’assassinat de hauts dirigeants du Hamas et du Hezbollah. La guerre à Gaza s’éternise et le risque d’escalade avec le Liban et même l’Iran est un scénario plus que possible. Le Hamas maintient une capacité opérationnelle, alors qu’il était décrit comme éreinté après les premières représailles israéliennes fin 2023. L’incapacité de l’État hébreu à éradiquer le Hamas d’un point de vue matériel prélude d’autant plus au fait qu’il ne parviendra pas à vaincre le Hamas d’un point de vue moral et idéologique. Le Hezbollah libanais représente pour Israël une menace encore plus sérieuse, avec un arsenal estimé à plus de 150 000 roquettes et missiles, pouvant potentiellement saturer les systèmes de défense israéliens. Le Hezbollah est encore plus préparé que le Hamas à un conflit prolongé, du fait de ses ressources plus fournies, et une opération israélienne à son encontre serait bien plus couteuse pour Tel Aviv que la guerre en cours à Gaza. Enfin, une potentielle guerre directe et d’envergue avec l’Iran semble être un scénario catastrophe, les implications stratégiques et régionales étant difficilement discernables avec précision.
Le plus grand danger pour Israël semble finalement être l’opinion publique. À l’international d’abord, les opérations israéliennes à Gaza sont régulièrement qualifiées de génocide, tant les actions à Gaza semblent disproportionnées et viser les populations civiles plus que des cibles militaires. La procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël le 29 décembre 2023 devant la Cour internationale de Justice, cette première alléguant d’une violation par le second de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (dont Israël est signataire) n’en est que l’illustration la plus saillante. À l’échelle nationale ensuite et surtout, la population israélienne semble chaque jour plus divisée sur la stratégie à mener et sur le soutien, ou non, à Benyamin Netanyahou. Or nombre de conflits récents démontrent à quel point l’opinion publique nationale détermine l’issue d’une guerre. Qu’il s’agisse de la France durant la guerre d’Algérie (1954-1962) ou des États-Unis au Vietnam (1955-1975) ou en Afghanistan (2001-2021), des États largement plus puissants que leurs cobelligérants ont été défaits. Non pas sur le champ de bataille, mais au sein de leurs propres sociétés, celles-ci s’opposant à des conflits perçus comme étant trop longs et couteux d’un point de vue humain et financier. Un tel scénario pourra alors s’imposer à Israël : on peut gagner une guerre stratégiquement, et la perdre politiquement.
Kevan Gafaïti (*)
Aereion 24
(*) Enseignant du département Middle East Studies (Sciences Po Paris) et chercheur du Centre Thucydide de l’Université Paris-Panthéon-Assas.








