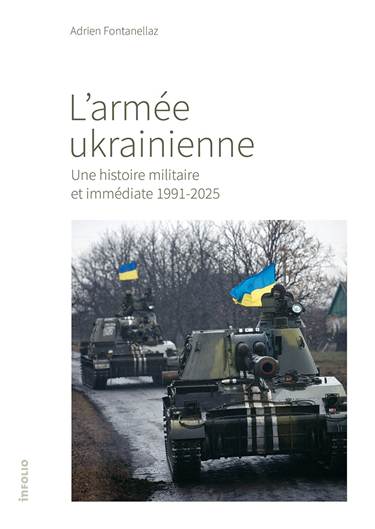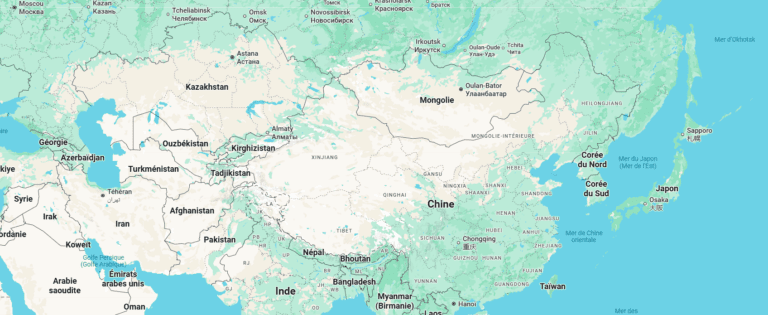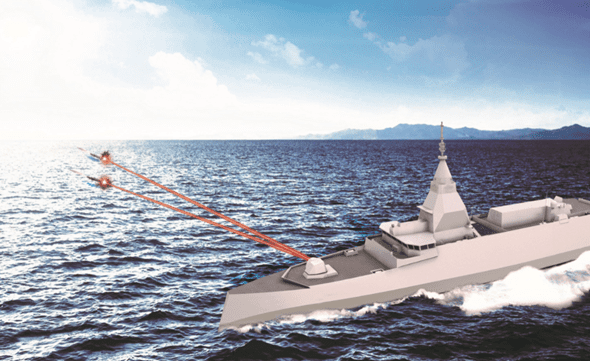Category: 2000-2020,2020-2030,2022-2025 : Guerre en Ukraine,Actualités,Armement,Souveraineté
Il n’est actuellement question que « d’accords de sécurité ». Le professeur américain Jeffrey Sachs dans un très intéressant article montre que «…cette expression familière confond deux notions très différentes : le besoin légitime des grandes puissances d’empêcher un encerclement hostile et la prétention illégitime des grandes puissances à s’ingérer dans les affaires intérieures d’États plus faibles. La première notion est mieux décrite comme une sphère de sécurité, la seconde comme une sphère d’influence. ».
Reconnaître cette distinction est plus qu’une question de sémantique. Cela permet de clarifier ce qui doit être accepté comme légitime dans la politique mondiale et ce à quoi il faut s’opposer. Elle aide également à réévaluer des doctrines historiques telles que la doctrine Monroe et sa réinterprétation ultérieure dans le corollaire Roosevelt, et elle éclaire les débats contemporains entre la Russie et la Chine d’un côté, et les États-Unis de l’autre concernant la sécurité nationale. Enfin, elle pointe vers la neutralité comme politique pratique pour les petits États pris entre les grandes puissances : la neutralité respecte les préoccupations sécuritaires de leurs puissants voisins sans se soumettre à leur domination ou à leur sphère d’influence.
En termes plus simples, il s’agit d’établir ou de rétablir la confiance : la rencontre Trump-Poutine peut être considérée comme allant dans le bon sens : on se parle. Traiter Poutine d’ogre ne sert pas à améliorer le climat.
Le conflit russo-ukrainien, pour le limiter au champ de bataille, semble être entré dans une phase terminale, sans pour autant que soit désigné un vainqueur et un vaincu. Les enjeux sont en effet beaucoup plus vastes que le seul terrain conquis. Un des aspects d’une éventuelle « victoire » ukrainienne serait d’y avoir gagné ce qu’on appelle des « garanties de sécurité ».
Mais une grande confusion règne à ce sujet. Fondamentalement, elles devraient assurer la paix dans cette partie de l’Europe. Mais la notion de « force de réassurance » inventée par le Président Macron augmente ces confusions et fait oublier, me semble-t-il, l’essentiel.
La première question à se poser est : qui a besoin de garanties de sécurité ?
Revenons brièvement sur les causes de la situation actuelle.
On notera en préambule que la Russie souhaite tout particulièrement régler le problème des causes qui l’ont amené à déclencher cette SMO (opération militaire spéciale).
Depuis la fin de la guerre froide, les USA, (et le clan « néocon » qui a pris le pouvoir au sein du département d’Etat) prônent une stratégie visant à tout faire pour protéger la suprématie, alors incontestable, des USA, en empêchant l’émergence de tout concurrent. Parmi les concurrents potentiels de l’époque (années 90), la Russie d’après Eltsine, l’Europe, et surtout la conjonction Europe-Russie.
On connaît les écrits et déclarations des conseillers successifs (Zbigniew Brezinski, Paul Wolfowitz, Richard Perle), et de la Rand Corporation et son scénario réaliste prévoyant des jours sombres pour l’Ukraine, etc. A la seule fin d’éliminer un concurrent potentiel, ces politiques ont mis en musique les mesures à prendre contre l’Europe et contre la Russie, à base de sanctions économiques, financières, énergétiques. Mais ces mesures se révélant inefficaces, c’est l’utilisation de l’Ukraine comme proxy contre la Russie qui a été l’option choisie. D’où le coup de force de Maïdan[1]
Cet évènement va de fil en aiguille envenimer les relations, but justement visé par les « néocons » américains. Tout cela est assez bien documenté pour ne pas en dire plus. Les dirigeants russes qui lisent les textes néocons comme tout le monde, assistant au renforcement de l’armée ukrainienne, n’ont eu de cesse de demander une réunion pour construire un cadre de sécurité en Europe, qui respecterait ce qu’ils estimaient nécessaire à leur sécurité et qu’ils croyaient conforme à ce qui avait été accordé « oralement ? » par diverses autorités occidentales dans le passé. Ces demandes n’ont pas reçu de réponse, voire ont été considérées avec mépris. C’est cette « négligence » et la protection des russophones de l’Est ukrainien, qui a amené les russes à déclencher l’Opération Militaire Spéciale, action, tout le monde le reconnaît, parfaitement contraire aux règles internationales.
Sans pour autant la justifier, Trump a même reconnu comprendre la réaction Russe.
On connaît la suite : les difficultés de l’armée russe à se mettre en ordre de bataille, avec de petits effectifs contre une armée plus nombreuse et bien armée, les objectifs définis par Poutine, démilitariser, et dénazifier l’Ukraine… Contrairement à ce qu’ont compris de nombreux observateurs occidentaux, il ne s’est jamais agi de conquérir toute l’Ukraine. L’armée russe n’a jamais eu pour mission de conquérir du terrain. Il s‘agissait, de détruire l’armée ukrainienne (attrition), et au fur et à mesure des progrès de l’installation de réseaux russes en Ukraine capables de désigner les objectifs, de détruire et rendre ainsi inutile l’aide occidentale, en appauvrissant les pays donateurs, eux-mêmes en difficulté.
L’observateur impartial ne peut que constater que, pour le moment, l’objectif visé au départ par l’administration néocon de Biden, qui était de s’en prendre à l’économie russe afin de mobiliser les foules en colère contre Poutine pour le renverser, n’a pas fonctionné (cf. Biden lors de son dernier voyage à Kiev). Considérant l’Ukraine comme un vrai proxy, que Biden a toujours refusé de vraiment armer, craignant une réaction trop vive de la Russie, la consigne donnée est : « Continuez à tuer du Russe ».
Pour la Russie, le problème de la fin de la phase actuelle, ne peut se régler qu’avec la nouvelle administration américaine, en reprenant le dialogue interrompu en février 2022, en vue de statuer sur le cadre de sécurité en Europe, la fin des sanctions et éventuellement la fin des opérations sur le terrain, celles-ci dictant le sort de l’Ukraine. Contrairement à ce que propose une propagande facile (il est plus facile de haïr un seul homme), Poutine n’est pas seul à décider : c’est l’Armée russe, ses chefs et le poids de l’état-major, qui décident de l’objectif final, qui est de laisser les armes sur le terrain décider de l’issue du conflit.
Les garanties pour la Russie
Pour la Russie encore, il est essentiel d’obtenir que les garanties accordées par la signature d’un accord, assurent sa sécurité contre ce qui pourrait être la poursuite d’une lutte hybride par des éléments incontrôlés, alimentés par des pays européens mécontents, ou par des réseaux néocons (CIA hors contrôle, Deep state attendant le départ de Trump, UE, cf. les déclarations de Kaja Kallas responsable de la politique étrangère de l’UE, Estonienne, qui demande encore et toujours le démembrement de la Russie, etc.).
Poutine a déclaré qu’il voulait la paix, pour permettre à la Russie de reprendre sa marche vers le progrès, etc., toute déclaration ne pouvant que nourrir la poursuite des objectifs initiaux des néocons toujours à l’affût. Car Trump, après des débuts tonitruants et sans doute peu efficaces se retrouve, peut-être malade (?), enlisé entre la crainte de perdre son électorat MAGA, de se faire doubler par des amis Républicains mal intentionnés (Lindsay Graham), et les propres contradictions de son programme (a-t-il d’ailleurs un programme cohérent ? Ainsi sa politique douanière vis-à vis de l’Inde qui vient de pousser ce pays, pourtant ami de l’Ouest, dans le camp rassemblé à Pékin). Ou bien, d’après certaines sources, enlisé par divers lobbies qui risquent de l’emmener et nous emmener dans des guerres qu’il ne veut pas (d’après des observateurs sérieux, le Mossad tiendrait Trump par des Kompromats fournis en son temps par son agent Epstein…) comme la reprise de la guerre contre l’Iran annoncée pour octobre (les médias ont parlé de rassemblement d’avions et de ravitailleurs US vers le Proche-Orient.)
Les garanties pour les Etats-Unis
Les USA (ou Trump) ont eux aussi besoin de garanties de sécurité : Trump a besoin de transformer la défaite de la stratégie de Biden en victoire pour lui-même: Steve Witkoff, envoyé spécial des EU au Moyen-Orient, aurait demandé lors de sa première rencontre avec les Russes à Ryad, de ne rien faire qui puisse accélérer la dédollarisation de l’économie mondiale entreprise par les BRICS. Au sein du camp atlantiste (néocons + européens de EU + 3 ), Trump doit s’assurer de ne pas être traité de traitre lorsqu’il devra mener la seule politique efficace pour mettre un terme à la tuerie : arrêter les livraisons d‘armes et d’argent, et retirer les conseillers de la CIA en poste dans l’armée ukrainienne. C’est ce qu’il comptait faire dès le début de son mandat, mais les Européens l’en ont empêché. Enfin avoir l’assurance que les fonds de pension US qui posséderaient déjà 20% des terres cultivables (en Ukraine) puissent continuer à assurer le financement des retraités qui ont voté MAGA .
Donald Trump, qui reste une énigme en tant que président, a besoin de sécurité pour rester en vie : un coup à la JFK est vite arrivé, une tentative a déjà été menée. Son grand projet géopolitique semble être de régler par des « deal», les relations avec la Russie et la Chine, ce qui apparait ni plus ni moins comme un partage des zones d’influence.
Des rumeurs – ou des fuites aux meilleures sources – toutes récentes, font état d’un projet d’une nouvelle stratégie de défense nationale qui placerait les missions nationales et régionales au-dessus de la lutte contre les adversaires traditionnels que constituent Pékin et Moscou.
Au-delà des rumeurs, il y a des faits : Au tout début du mois de septembre, des personnes proches du dossier ont révélé que des responsables du Pentagone ont informé les diplomates européens que les États-Unis ne financeraient plus les programmes de formation et d’équipement des armées des pays d’Europe de l’Est, qui se trouveraient en première ligne en cas de conflit avec la Russie. Par ailleurs, Trump a invité Poutine et Xi au prochain G20 qui se tiendra en 2026 aux USA. Au plan intérieur, il a lancé une initiative visant à placer les villes américaines en proie à la criminalité et au dysfonctionnement, sous la tutelle de l’armée et de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Cette disposition ne manquera pas de voir s’élever une très forte opposition de la part de l’Etat Profond, néocons bipartisans, CIA malgré la purge menée par Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national américain, mais aussi de la part des pays européens engagés dans une lutte contre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien. Pour le moment, pour calmer ces oppositions, il louvoie, entre les nouvelles sanctions ou menaces contre Poutine, ( – Père, gardez-vous à droite, – ), et des promesses vagues d’aide aux efforts européens ( – Père , gardez-vous gauche– ). L’interprétation de ces faits dépend de Trump : agit-il dans la plus grande improvisation, ou bien, avec ses outrances et ses foucades, se trace-t-il un chemin vers ce qui devrait être une Paix ? …évitant les provocations, fake-attaques,etc .. montées par ses amis et alliés pour l’empêcher de poursuivre ses propres objectifs.
Des garanties pour l’Ukraine
L’Ukraine, ou ce qu’il en restera, doit bien sûr obtenir toutes les garanties que peut recevoir une nation vaincue : on n’en est pas encore là. Des Ukrainiens vont encore se faire tuer (pas ceux qui vont profiter de la dernière autorisation de quitter librement le pays, Zelensky préférant voir sa jeunesse à l’étranger que manifester dans les rues contre le gouvernement).
Parmi les garanties à lui donner :
- Un système permettant de contrôler les groupes nationalistes qui pourraient vouloir continuer à jouer les proxy au profit des néocons US en lançant une guerre clandestine sur le territoire russe, ce qui pourrait provoquer des réactions de la Russie contre les bases de départ de ces raids ;
- Des garanties pour les populations restées en territoire occupé, soit pour rejoindre le territoire ukrainien, soit pour conserver leur culture, leur langue, etc.
- Dans le même esprit, autoriser les visites entre familles de part et d’autre de la nouvelle frontière (éviter les séparations qui ont été provoquées par le Mur de Berlin)
- Des garanties de recevoir l’énergie nécessaire à partir des centrales nucléaires en territoire occupé ou du gaz russe.
- Des garanties contre d’éventuelles incursions russes, garanties assurées par des commissions (d’armistice) du type de celles installées en France pendant la dernière guerre, commissions ukrainiennes installées près des plus importantes garnisons en Russie et commissions russes installées en Ukraine etc.
Des garanties pour l’Europe
Enfin, l’Europe doit recevoir aussi des garanties :
Celles-ci devraient lui assurer les conditions favorables à la résolution d’une part de la crise économique autrement qu’en développant une industrie d’armement et de préparation à la guerre, moyen historique pour les élites de résoudre les crises, et d’autre part de la crise structurelle qu’elle traverse, en reprenant dès que possible contact avec la Russie. A cette fin, il lui faudra sans doute changer une partie du personnel politique européen trop impliqué, non dans le soutien à l’Ukraine, mais dans la poursuite de la destruction de la Russie. Dans cet objectif, elle pourrait puiser dans son passé et prendre exemple sur l’instauration de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). Celle-ci, entrée en vigueur en juillet 1952 pour une durée de cinquante ans, avait créé les bases d’une démocratie européenne et le développement actuel de l’Union. Sur proposition du ministre des AE Robert Schuman, elle devait empêcher une nouvelle guerre entre la France et l’Allemagne, la guerre étant rendue « non seulement impensable mais aussi matériellement impossible ».
Ces garanties devraient lui assurer aussi de désinstaller tous les motifs de crises futures : référendum pour les minorités plus ou moins brimées, comme les Hongrois, les Polonais d’Ukraine, révision des mesures ayant mis fin à la crise des Balkans en particulier, et ayant engendré un certain nombre de problèmes, dont l’installation d’un islamisme radical, dont il faudrait neutraliser les têtes de pont.
Et l’OTAN ?
Reste le problème de l’OTAN, plus exactement de l’utilité de l’OTAN, une fois que les USA se seront retirés (partiellement) d’Europe. L’organisation pourrait avoir un réflexe de survie, et temporiser jusqu’au départ de Donald Trump, en attendant un chef sérieux qui trouvera bien le moyen de recréer une méga crise.
A ce stade, et pour répondre à la question du jour, posée récemment par Pierre Lellouche sur Europe 1, le président Macron propose de préparer, avec un certain nombre de partenaires qu’il a, semble-t-il, convaincus, une force qui serait déployée après un traité de paix.
Ce projet présente trois difficultés :
En premier lieu, un problème d’effectif : les forces européennes disponibles sont peu nombreuses : quelques milliers d’hommes, quinze à vingt mille au mieux, essentiellement Français et Britanniques. Mais surtout, il faudrait les protéger, car il est hors de question qu’un soldat d’Europe occidentale soit tué au cours de ce conflit en Europe orientale, lors d’une attaque russe. Ils ont donc besoin d’une couverture aérienne, qui ne peut être qu’américaine, du renseignement américain, le plus performant, et de la logistique américaine, la plus solide. Sur ce sujet, Donald Trump est très réticent. Il est d’une grande prudence et encore très vague dans ses intentions.
En deuxième lieu, l’inévitable opposition russe à ce projet : un des objectifs de cette malheureuse Opération militaire spéciale, était d’empêcher l’Ukraine de rejoindre l’Otan. Si on fait rentrer des soldats de pays de l’OTAN en Ukraine, on fait rentrer l’OTAN par la fenêtre. Les Russes n’en veulent donc évidemment pas.
Enfin, la division des Européens eux-mêmes est un réel handicap. En Allemagne, on souhaite que ce projet passe au Bundestag. Or les socialistes sont contre. Il n’y a pas de majorité pour aller en Ukraine. En Italie, Matteo Salvini, vice-président du conseil des ministres, est contre. Donc, Georgia Meloni enchaine : « Nous n’irons pas au sol en Ukraine ». Les Polonais, pourtant voisins, s’y refusent également. Ne restent que les Français et les Britanniques. On notera aussi que le secrétaire de général de l’OTAN, Mark Rutte, ancien Premier ministre néerlandais, très allant, voudrait qu’on envoie tout de suite des forces en Ukraine, et donc qu’on participe directement à la guerre….
Dans cette grande confusion, au milieu de tant d’incertitudes, les armées européennes ne sont ni prêtes, ni près à se déployer en Ukraine.
Cet environnement donne au président Macron l’occasion de multiplier les sommets, de faire oublier la profonde crise politique et économique que traverse la France, en particulier : l’incapacité de l’Assemblée à voter un budget, entrainant la démission du Premier ministre, faute de majorité de soutien. La presse étrangère (Financial Times) évoque l’inconscience[2] [1] du Président Macron ou la recherche d’une diversion politique.
On peut imaginer que tous ces grands chefs sont mal renseignés, prenant leurs sources chez les Ukrainiens (pour eux les Russes ne savent pas se battre, les valeureux Ukrainiens mènent l’offensive, la victoire est possible, la chute de Poutine, « encore une minute Monsieur le bourreau … »). Cette hypothèse est (elle) réaliste ?
Ou bien tout le monde sait que la messe est dite, et on se comporte comme sur le Titanic, on multiplie les réunions, les repas, les embrassades avec tapes dans le dos du grand héros, ce qui permet à chacun de ces chefs d’Etat à mauvaise côte de popularité de durer, en attendant eux-aussi que Trump se casse ou soit cassé, pour reprendre le train-train ou marcher vers « enfin une vraie guerre sans empêcheur de faire la paix en rond ».
On pourrait en dire beaucoup plus, mais je pense que ce qui précède démontre que la « guerre » contre la Russie est tout aussi fantaisiste que les autres exemples de folie symbolique décrits ci-dessus. La difficulté, et peut-être le danger, vient du fait que les gouvernements ont effectivement le pouvoir de lancer des opérations de ce type, ou du moins d’essayer, et peuvent se persuader, par désespoir, qu’ils pourraient réussir. M. Macron a montré des signes inquiétants de ce type de réflexion ces dernières semaines, et le gouvernement français semble désormais préparer les hôpitaux à accueillir des centaines de milliers de victimes d’une future guerre. Nous avons besoin des hommes en blouse blanche.
Patrick FERRANT
Guerre en Ukraine : Les garanties de sécurité, opinion
Administrateur honoraire de l’AASSDN
[1] A ce sujet, Andriy Paroubiy, chef nationaliste et chef des snippers qui avaient tiré, lors de la Révolution de Maïdan sur la foule et sur la police, vient d’être abattu d’une balle dans la nuque à Lvov, par un Ukrainien mécontent .
[2] 2025 09 03 Blog Aurélien La guerre à notre époque