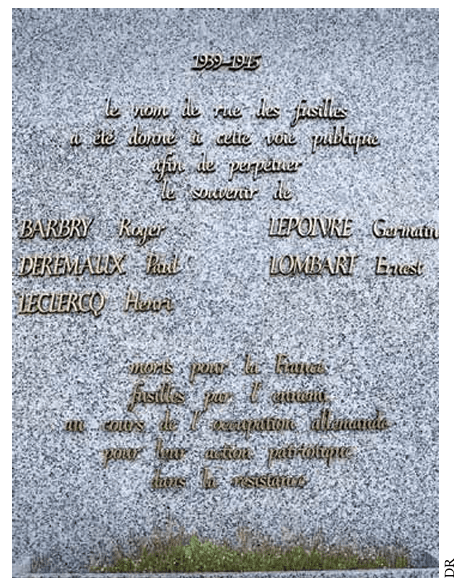La guerre d’indépendance algérienne se déroula également en métropole, y provoquant des milliers de morts. Pour la période du 1er janvier 1956 au 23 janvier 1962, 10 223 attentats y furent ainsi commis par le FLN. Pour le seul département de la Seine, entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1962, 1 433 Algériens opposés au FLN furent tués et 1 726 autres blessés (Valat, 2007:27-28). Au total, de janvier 1955 au 1er juillet 1962, en Métropole, le FLN assassina 6 000 Algériens et en blessa 9 000 autres.
Face à ces actes de terrorisme visant à prendre le contrôle de la population algérienne vivant en France, le 5 octobre 1961, un couvre-feu fut imposé à cette dernière afin de gêner les communications des réseaux du FLN et l’acheminement des armes vers les dépôts clandestins.
En réaction, le 17 octobre 1961, le FLN décida alors de manifester. Assaillis de toutes parts, les 1 658 hommes des forces de l’ordre rassemblés en urgence, et non les 7000 comme cela est encore trop souvent écrit, sont, sous la plume de militants auto-baptisés « historiens », accusés d’avoir massacré 300 manifestants, d’en avoir jeté des dizaines à la Seine et d’en avoir blessé 2 300. (Voir :Lugan, B., (2017) « 17 octobre 1961, un massacre imaginaire ». Chapitre IX du livre « Algérie l’Histoire à l’endroit ».
La fabrication d’un massacre
L’histoire officielle du « massacre » du 17 octobre 1961 à Paris repose sur trois livres :
1) Celui d’Ali Haroun publié en 1986. Il s’agit d’un recueil de souvenirs rédigés par d’anciens responsables de la fédération du FLN en France sous forme d’un plaidoyer militant et valorisant.
2) Celui de Jean-Luc Einaudi publié en 1991 porte sur la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. L’auteur, un militant marxiste, ancien maoïste, n’avait pas de formation historique, ce qui explique ses nombreuses errances méthodologiques.
3) S’appuyant sur Haroun et Einaudi, deux universitaires britanniques, House et MacMaster publièrent en 2008 un livre passant totalement sous silence la guerre FLN-MNA et attribuant aux forces de police la totalité des Nord-Africains tués en France[1].
Des auteurs de second rang paraphrasèrent ensuite ces trois ouvrages, répétant les mêmes arguments pourtant réduits à néant par les travaux historiques.
Dans ces publications, l’on retrouve en effet les mêmes chiffres, les mêmes cadavres inventés et une constante inflation du nombre de morts (jusqu’à 325 manifestants tués), des dizaines jetés à la Seine et noyés, près de 12 000 arrêtés etc.
Les auteurs de ces livres jouent sur les dates car ils ajoutent aux morts « avérés » du 17 octobre, ceux des jours précédents, ce qui n’a aucun rapport avec la manifestation et sa répression. Ces auteurs additionnent ainsi les décès postérieurs au 17 octobre, sans chercher à voir s’ils sont la conséquence de blessures reçues ce jour-là ou d’autres causes.
Pour eux, tout Algérien mort de mort violente durant le mois d’octobre est une victime de la répression policière. Ils parlent aussi de cimetières clandestins et de charniers dont nulle trace n’a jamais été retrouvée[2].
Autre élément du dossier, les « noyades »[3] dans la Seine dont nous savons qu’elles furent « inventées » postérieurement à la manifestation, le 31 octobre, dans un tract du FLN repris et popularisé par le parti communiste qui en fit une « vérité » devenue histoire officielle.
Tout repose en effet sur des chiffres gonflés ou manipulés et sur des cadavres inventés. Dans une inflation du nombre des morts, les amis du FLN algérien et les « porteurs de valises » communistes ont ainsi joué sur les dates, additionnant les morts antérieurs et postérieurs au 17 octobre. Pour eux, tout Nord Africain mort de mort violente durant le mois d’octobre 1961 est forcément une victime de la répression policière…Même les victimes des accidents de la circulation, comme un certain Abdelkader Benhamar…
Il est possible d’affirmer cela sans crainte d’être démenti car :
– En 1998, le Premier ministre de l’époque, le socialiste Lionel Jospin, constitua une commission présidée par le conseiller d’Etat Dieudonné Mandelkern qu’il chargea de faire la lumière sur ces évènements. Fondé sur l’ouverture d’archives jusque là fermées, le rapport remis par cette commission fit litière des accusations portées contre la police française[4]. Or, ce rapport consultable sur le net n’a visiblement pas été lu par ceux qui continuent à accuser la police française.
– En 1999, Jean-Paul Brunet, universitaire spécialiste de la période, publia un livre extrêmement documenté qui démontait la thèse du « massacre » du 17 octobre (Brunet, J-P., Police contre FLN. Le drame d’octobre 1961. Paris).
– En 2003, le même Jean-Paul Brunet publia un nouveau livre ( Charonne, lumière sur une tragédie. Paris) dans lequel il démontrait que le prétendu « rapport de police » faisant état de 140 morts le 17 octobre, document qui sert de point de départ à J.L Einaudi, auteur du livre sur lequel repose toute la manipulation (Octobre 1961, un massacre à Paris), n’a jamais existé.
Reprenant la liste des morts donnée par Einaudi, il montre également que la majorité des décès remonte à des dates antérieures à la manifestation du 17 octobre et il prouve que ce dernier a manipulé les chiffres, additionnant les cadavres non identifiés reçus à l’Institut Médico-Légal au nombre des disparus et même (!!!) à celui des Algériens transférés administrativement en Algérie après qu’ils eurent été arrêtés le 17 octobre. Il montre enfin qu’Einaudi a compté plusieurs fois les mêmes individus dont il orthographie différemment les noms…
Quel est donc le vrai bilan de cette manifestation ?
– Le 17 octobre 1961, alors que se déroulait dans Paris un soi-disant massacre, l’Institut Médico-Légal (la Morgue), n’a enregistré aucune entrée de corps de « NA » (NA= Nord-Africain dans la terminologie de l’époque).
– Le 17 octobre 1961, de 19h30 à 23 heures, il n’y eut qu’une seule victime dans le périmètre de la manifestation et ce ne fut pas un Algérien, mais un Français nommé Guy Chevallier, tué vers 21h devant le cinéma REX, crâne fracassé. Par qui ?
– En dehors du périmètre de la manifestation, « seuls » 2 morts furent à déplorer, Abdelkader Déroues tué par balle et retrouvé à Puteaux et Lamara Achenoune tué par balle et étranglé, gisant dans une camionnette, également à Puteaux. Rien ne permet de dire qu’ils furent tués par les forces de l’ordre.
Le 18 octobre, à 04 heures du matin, le bilan qui parvint à Maurice Legay le directeur général de la police parisienne fut donc de 3 morts. Nous sommes donc loin des dizaines de morts et de « noyés » auxquels l’actuel occupant de l’Elysée a rendu hommage !!!
Certes, nous dit-on, mais les cadavres ont été déposés à la morgue les jours suivants. Faux, car ce n’est pas ce qu’indiquent les archives de l’Institut Médico-Légal de Paris puisque, entre le 18 et le 21 octobre, « seuls » 4 cadavres de « NA » furent admis à la Morgue :
– Le 18 octobre, Achour Belkacem tué par un policier invoquant la légitime défense et Abdelkader Benhamar mort dans un accident de la circulation à Colombes.
– Le 20 octobre, Amar Malek tué par balles par un gendarme.
– Le 21 octobre Ramdane Mehani, mort dans des circonstances inconnues.
Nous voilà donc bien loin des 100, 200 ou même 300 morts « victimes de la répression » avancés par certains et pour lesquels M. François Hollande a en son temps reconnu la responsabilité de la France.
D’autant plus que le « Graphique des entrées de corps « N.A » (Nord-africains) par jour. Octobre 1961 », nous apprend que du 1er au 30 octobre 1961, sur les 90 corps de « NA », sont entrés à l’Institut Médico-Légal, la plupart étaient des victimes du FLN.
Plus encore, pour toute l’année 1961, 308 cadavres de « N.A » entrèrent à l’IML. Or, la plupart étaient des victimes de la guerre inexpiable que le FLN menait contre ses opposants partisans de l’Algérie française ou du MNA de Messali Hadj. Ainsi, au mois d’octobre 1961, sur les 34 cadavres de « N.A » retirés de la Seine ou de la Marne, notamment aux barrages de Suresnes et de Bezons puis conduits à l’IML, la quasi-totalité étaient des victimes du FLN (harkis, partisans de la France, membres du MNA) dont une des méthodes d’assassinat consistait à noyer ses opposants. La police française n’est pour rien dans ces noyades.
Les « massacres » du 17 octobre 1961 seront étudiés dans l’avenir comme un cas exemplaire de fabrication d’un mythe ; comme Katyn et le massacre des officiers polonais attribué aux Allemands et en réalité perpétré par les Soviétiques, Timosoara en Roumanie, les « couveuses » au Koweit ou encore comme les « armes de destruction massive » en Irak.
Bernard LUGAN
L’Afrique Réelle
19 octobre 2025
.
Pour en savoir plus :
– Brunet, J-P., (1999 ) Police contre FLN. Le drame d’octobre 1961.Paris.
– Brunet, J-P., (2002) « Enquête sur la nuit du 17 octobre 1961 ». Les Collections de l’Histoire, hors série n°15, mars 2002.
– Brunet, J-P., (2003) Charonne, lumière sur une tragédie. Paris.
– Brunet, J-P., (2008) « Sur la méthodologie et la déontologie de l’historien. Retour sur le 17 octobre 1961 ». Commentaire, vol 31, n°122, été 2008.
– Brunet, J-P., (2011) « Combien y a-t-il eu de morts lors du drame du 17 octobre 1961 ? ». Atlantico, 17 octobre 2011.
– Einaudi, J-L., (1991) La Bataille de Paris :17 octobre 1961.
– Einaudi, J.-L (2001) Octobre 1961, un massacre à Paris. Paris
– House, J et MacMaster,N., (2008) Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire.
– Lugan, B., (2017) « 17 octobre 1961, un massacre imaginaire ». Chapitre IX du livre « Algérie l’Histoire à l’endroit ». Chez l’auteur www.bernard-lugan.com.
– Valat, R., (2007) Les Calots bleus. Histoire d’une police auxiliaire pendant la Guerre d’Algérie. Paris.
– Valat, R., (2009) « La force police auxiliaire : une historiographie sous influence ? Réponse de l’auteur aux critiques formulées contre son ouvrage Les Calots bleus et la bataille de Paris. Une force police auxiliaire pendant la guerre d’Algérie. En ligne, 13 pages.
– Valette, J., (2001) La guerre d’Algérie des messalistes. Paris.
[1] Comme l’a montré Jean-Luc Brunet (2008) rarement un livre à prétention scientifique et écrit par des universitaires aura à ce point dérogé aux règles élémentaires de la déontologie historique.
[2] Des insinuations assassines sont faites à la manière de Benjamin Stora dans un entretien au Nouvel Observateur (Grand reporters.com janvier 2003) quand il cite Omar Boudaoud, un des responsables de la manifestation du 17 octobre 1961 qui parle de « pendaisons dans le Bois de Vincennes et (d’) une Seine remplie de cadavres ». Benjamin Stora ne fait certes que reprendre des déclarations qu’il n’assume pas, mais qu’il ne rectifie pas non plus…
3] Du 1° au 31 octobre 1961, sur 90 cadavres de « N.A » (Nord-africains selon la terminologie de l’époque), conduits à l’Institut Médico Légal, 34 furent retirés de la Seine ou de la Marne, notamment aux barrages de Suresnes et de Bezons. Les enquêtes policières ont montré qu’il s’agissait pour la plupart de meurtres commis par le FLN.
[4] « Rapport sur les archives de la Préfecture de police relatives à la manifestation organisée par le FLN le 17 octobre 1961 ». Rapport établi à la demande du Premier ministre, M. Lionel Jospin et remis au mois de janvier 1998 par M. Dieudonné Mandelkern président de section au Conseil d’Etat, président ; M. André Wiehn, Inspecteur général de l’administration ; Mme Mireille Jean, Conservateur aux Archives nationales ; M. Werner Gagneron, Inspecteur de l’administration. En ligne.