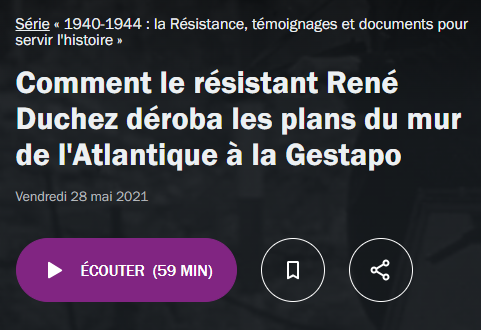Category: 1962-1989,Asie Pacifique,Extraits de bulletin,Guerre froide (1945-1989),Services de l’Est
Article du Colonel Michel Garder en 1983 :
Le 1er septembre 1983 à 06 h 26 – heure locale, un chasseur « Soukhoï 15 » de la P.V.O. (1) soviétique abattait à quelque 67 km au sud-ouest de l’île Sakhaline un Boeing 747 de l’Aviation Civile sud-coréenne, avec à son bord 269 passagers. Deux fusées « air-air » tirées au but par le pilote – un commandant des Forces aériennes soviétiques, avaient frappé à mort le gros avion civil dont l’agonie allait durer quelque douze minutes jusqu’à son immersion dans les flots de la Mer du Japon.
Le 2 septembre 1983, la presse soviétique publiait un communiqué laconique selon lequel « un avion de nationalité non établie » avait par deux fois violé l’espace aérien soviétique. Se déplaçant sans feux de circulation aérienne, cet avion n’avait à aucun moment répondu aux demandes d’identification, ni pris contact avec le service de guidage aérien au sol. Les chasseurs soviétiques « avaient tenté de le guider en vue d’un atterrissage sur l’aérodrome le plus proche », mais « l’avion violeur » n’avait pas réagi à leurs signaux et avait poursuivi sa route en direction de la Mer du Japon ». Dans le communiqué de l’Agence Tass il n’était nullement question de la destruction de « l’avion violeur » et sans la mise au point des services spécialisés américains et japonais parue le même jour dans les pays du Monde Libre, il est certain que les citoyens de l’Empire communiste n’en auraient jamais rien su.
Cette mise au point entraîne une première réaction de l’Agence Tass répétant, pour commencer, la version initiale complétée toutefois par les détails suivants :
– l’avion non identifié a survolé le territoire soviétique pendant plus de deux heures ;
– la chasse soviétique lui avait tiré plusieurs salves de semonce d’obus traçants ;
– finalement on avait perdu la trace de cet avion qui avait quitté l’espace aérien soviétique.
Toutefois ce communiqué comportait une conclusion pour le moins étonnante dans laquelle on accusait les États-unis d’avoir expédié « à des fins d’espionnage » cet avion non identifié dans l’espace aérien soviétique et de porter l’entière responsabilité dans une inexplicable perte de vies humaines – dans la mesure où il n’était pas fait mention dans le communiqué de la destruction du Boeing coréen.
Toujours ce même 2 septembre, le Conseil de Sécurité de l’O.N.U. saisi par les États-unis et la Corée du Sud examinait l’affaire à la lueur des preuves indiscutables – sous la forme des enregistrements américains et japonais, tant des derniers moments du Boeing que des liaisons air-sol de la chasse soviétique. Mis au pied du mur, l’ambassadeur soviétique à l’O.N.U, eut l’aplomb de nier toute responsabilité soviétique dans la destruction de l’avion et de qualifier cette session du Conseil de Sécurité de « spectacle de propagande » destiné à ternir l’image de l’U.R.S.S.
Le 3 septembre, Tass, toujours sans mentionner la destruction de l’avion dont les passagers avaient néanmoins mystérieusement péri, s’attaquait personnellement au Président Reagan et à sa « haine hystérique de l’U.R.S.S. ».
Il faut attendre le 4 septembre pour que paraisse un article dans la Pravda sous la plume du Général Romanov, chef d’état-major du Commandement en Chef de la P.V.O., disant entre autre que les chasseurs soviétiques ne pouvaient pas savoir qu’il s’agissait d’un avion civil, cela d’autant plus que le Boeing incriminé ressemblait à l’appareil de reconnaissance américain RC 135.
Une telle énormité de la part de ce haut responsable de la Défense aérienne soviétique eût mérité à elle seule pas mal de commentaires. Mais non content de cela, le général écrivait que l’avion non identifié se déplaçait tous feux éteints – oubliant probablement que même avec un éclairage de nuit les dizaines de hublots d’un Boeing 747 doivent se voir de loin.
Ceci dit, le Chef d’Etat-Major de la P.V.O., bien que mentionnant on ne sait trop pourquoi « de nombreuses victimes », ne daignait pas expliquer le sort de l’avion. Les arguments de cette « haute autorité » devaient être repris le 5 septembre.
Le 6 septembre, la Pravda s’indignait encore des mensonges grossiers de la propagande occidentale selon laquelle « l’avion coréen aurait commis une erreur de parcours et aurait été abattu par la chasse soviétique ». Pourquoi la Chasse, s’étonnait le rédacteur de l’article, alors que la P.V.O. soviétique dispose de fusées sol-air ?»
Toutefois le lendemain, la même Pravda publiait sans le moindre mot d’excuse à l’intention de ses lecteurs un communiqué du gouvernement soviétique annonçant que le vol de l’avion civil sud-coréen qui effectuait une mission d’espionnage dans l’espace aérien soviétique avait été « interrompu » (sic) par un avion de combat soviétique.
Le 9 septembre, on eut droit à Moscou à un spectacle unique en son genre : une conférence de presse du Maréchal Ogarkov – Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées et Premier Suppléant du Ministre de la Défense, flanqué des « camarades » Zamiatine – Chef du Département Etranger du Comité Central, et Kornienko, Suppléant du Ministre des Affaires Etrangères.
Enfin le 11 septembre, la version officielle se trouvait enrichie de par la grâce d’un Maréchal de l’Air d’un développement rocambolesque, à savoir que le Boeing sud-coréen « espionnait » en liaison avec un satellite américain d’observation, lequel survolait la zone de Sakhaline toutes les deux heures.
Entre-temps, des journalistes britanniques avaient pu recueillir de la bouche du Directeur de la Pravda lui-même et de deux autres représentants de l’intelligentsia soviétique des jugements critiques sur les militaires de leur pays (2).
« On finira bien par oublier cette histoire », devait de son côté déclarer Gromyko, lors de son passage en France. Et il est vrai qu’on en prend le chemin !
Toutefois, nous estimons, quant à nous, que ce crime doit – à défaut de châtiment – être rappelé périodiquement et que de plus il mérite d’être commenté.
UN SCÉNARIO PROBABLE
Le seul point demeuré mystérieux dans le drame du 1er septembre 1983 est l’erreur de navigation commise par l’équipage du Boeing sud-coréen. On sait néanmoins que lors de l’escale d’Anchorage l’inspection de l’appareil avait permis de déceler quelques anomalies dans son système de navigation et que des techniciens s’étaient employés à y remédier.
Mais quelles que soient les causes de l’écart de près de 200 kilomètres commis par le KE 007, son entrée dans l’espace aérien soviétique vers 04 h 30 dans la région de la presqu’île de Kamtchatka va coïncider avec un vol de reconnaissance d’un RC 135 américain (version militaire du Boeing 707) non détecté par les radars soviétiques.
Il est possible d’ailleurs que ce dernier appareil ait été rendu « indétectable », grâce à un procédé révolutionnaire actuellement essayé par les Américains. En même temps on peut supposer que le RC 135 se trouvait périodiquement en liaison avec un satellite d’observation et que ce trafic a été détecté par les services soviétiques et mis sur le compte du Boeing sud-coréen.
Peu avant 05 h 00, la chasse soviétique du Kamtchatka tente vainement d’intercepter le Boeing sud-coréen, lequel poursuit son vol en direction de l’île de Sakhaline.
La Région Anti-aérienne d’Extrême-Orient rend compte des faits à Moscou, c’est-à-dire au Commandement en Chef de la P.V.O. dont le Général Romanov cité plus haut est le Chef d’État-major. Le Commandant en Chef, le Maréchal Toloubko – voire tout simplement Romarrov lui-même, prend la décision de faire abattre l’« avion violeur » sans en référer plus haut. D’où l’air gêné du Maréchal Ogarkov lorsque pendant la conférence de presse du 9 septembre un journaliste américain lui demandera a quel niveau la décision a été prise.
L’ordre parvient en Extrême-Orient au moment ou la chasse de Sakhaline a déjà pris l’air et faute de disposer du système IFF – dont les avions de combat soviétiques ne sont plus dotés depuis la désertion du lieutenant Belenko en 1975 à bord d’un MIG 25, les Soukhoï 15 ne peuvent pas entrer en contact avec le Boeing sud-coréen.
Le P.C. au sol donne l’ordre à 06 h 21 à l’un de ces Soukhoi 15 d’abattre l’appareil civil, et cela alors même que le pilote signale que sa « cible » navigue avec des feux d’identification.
A 06 h 25, le pilote signale que sa « cible » ralentit sa vitesse de vol mais se voit confirmer l’ordre d’attaque, ce qu’il exécute à 06 h 26′ 20″ et annonce la destruction de sa « cible » 1 seconde plus tard.
Il est fort possible que le Commandement en Chef de la P.V.O. (auquel celui de la Région P.V.O. d’Extrême-Orient a dû rendre compte immédiatement de l’exécution de son ordre, soit vers 07 h 00 heure locale, ce qui fait 01 h 00 à Moscou) ait attendu la matinée du 1er septembre pour en référer à l’État-major Général – Direction Principale des opérations : Maréchal Akhromiev. Ce dernier a dû attendre quelque peu avant d’aller en parler à son chef Ogarkov, lequel a peut-être mis une sage lenteur pour en informer le Ministre Oustinov. Quant a Youri Andropov, il ne l’a peut-être appris dans sa version « édulcorée » que dans l’après-midi du 1er, et son Cabinet a pu ainsi dicter à l’Agence Tass le texte du premier communiqué.
A noter que le Numéro Un soviétique n’évoquera cette affaire que près d’un mois après, ulcéré qu’il était d’avoir été court-circuité par les militaires de la sbiro-strato-partocratie soviétique.
LES ENSEIGNEMENTS DU CRIME DU 1er SEPTEMBRE
Le crime odieux et stupide commis par la P.V.O. soviétique le 1er septembre 1983 comporte de nombreux enseignements. Nous retiendrons en ce qui nous concerne les suivants :
– Contrairement aux rêveurs libéraux ou aux aveugles politiques qui prolifèrent dans les classes dirigeantes du monde occidental, les oligarques civils ou militaires lénino-marxistes raisonnent en fonction du conflit permanent qu’ils mènent contre nous. Ce conflit étant inexpiable, ils agissent en conséquence et, de même qu’ils massacrent sans le moindre scrupule les civils afghans – en en rejetant la responsabilité sur les Américains ou les Chinois, de même ont-ils agi avec le Boeing sud-coréen.
– Cette affaire illustre par ailleurs les « failles » du système anti-aérien soviétique, failles que le Haut Commandement connaît depuis la victoire israélienne au Liban au cours de l’été 1982 sur les forces aériennes syriennes équipées par Moscou. La chasse soviétique n’a pas pu intercepter le Boeing 747 au-dessus du Kamtchatka cependant que les moyens de détection le confondaient avec un RC 135. C’est certainement la peur de se voir accuser qui a poussé le Commandement en Chef de la P.V.O. (ou son chef d’Etat-Major) à donner directement l’ordre d’abattre « l’avion-violeur ».
Le scénario que nous avons donné – et qui selon nous cerne très près la vérité – éclaire, si besoin était, les changements intervenus depuis 1976 dans le fonctionnement du système soviétique. Tchékistes et militaires se sont en partie affranchis de la tutelle de l’Appareil du Parti (d’où l’expression de sbiro-strato-partocratie). Jamais, même sous Khrouchtchev et au cours de la première décennie du règne de Brejnev, des militaires ne se seraient permis de prendre seule une telle décision.
Ce dernier point fait, enfin, frémir ; car il souligne les dangers que le monde court actuellement du fait de la stupidité et de l’inconscience de responsables militaires soviétiques. Supposons que le Boeing 747 ait appartenu à la Panam ou même aux British Airways, c’est-à-dire que sa destruction ait été ressentie aux États-unis ou en Grande-Bretagne comme un crime contre l’un ou l’autre de ces pays !
UN CRIME SANS CHÂTIMENT
En attendant, les 269 victimes du Boeing ne sont plus pleurées que par leurs proches, oubliées qu’elles sont par le reste du monde. On continue à donner du « Monsieur » au sieur Andropov et à se mettre au garde à vous devant les pattes d’épaules dorées et étoilées des maréchaux soviétiques. Il est vrai que tout ce joli monde possède sur les condamnés du procès de Nuremberg un avantage certain dans la mesure où ils sont – avec une certaine ostentation, des « criminels de paix » et non « de guerre ».