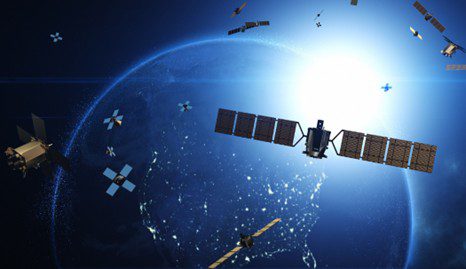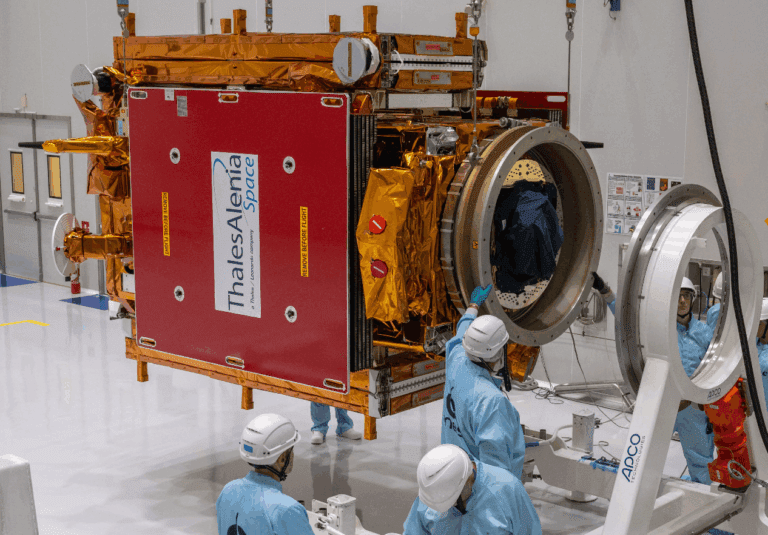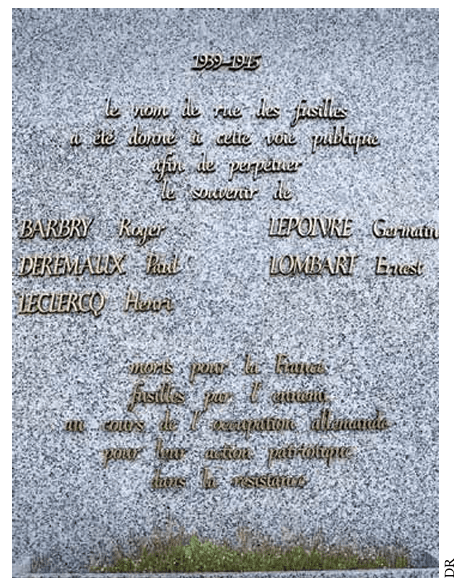L’accord franco-algérien de 1968 coûterait 2 milliards € par an à la France

Ce rapport est explosif parce qu’à sa lecture, on découvre un véritable maquis d’informations et de statistiques éparses, disséminées entre plusieurs administrations: Intérieur, Affaires sociales, Santé, hôpitaux de Lyon ou de Marseille, Affaires étrangères. À chaque étage, c’est la distribution continue des privilèges. Même les observateurs les plus aguerris — dont l’auteur de ces lignes — restent stupéfaits devant l’ampleur des largesses accumulées, année après année, au profit des ressortissants algériens.
Il faut lire, ou au moins parcourir le rapport parlementaire rédigé par les deux députés Charles Rodwell et Matthieu Lefebvre, consacré à l’accord franco-algérien de 1968.
C’est, en fait, un rapport explosif et riche d’enseignements. Explosif par ce qu’il décrit. Explosif car les deux parlementaires se plaignent de la mauvaise volonté des administrations pour leur envoyer des statistiques, informations ou données chiffrées concernant l’immigration algérienne en France, comme si elles craignaient la transparence.
Explosif parce qu’à sa lecture, on découvre un véritable maquis d’informations et de statistiques éparses, disséminées entre plusieurs administrations: Intérieur, Affaires sociales, Santé, hôpitaux de Lyon ou de Marseille, Affaires étrangères. C’est à un véritable labyrinthe, voire à un jeu de piste, que les deux députés se sont retrouvés confrontés.
Explosif par la somme d’informations accumulées: ce rapport est une «bible» pour tous ceux, historiens, journalistes, politiques qui s’intéressent à cette question de l’immigration algérienne en France. Il est certain que l’Algérie, comme ses soutiens en France, protestera, critiquera et expliquera que tout ceci est à mettre sur le compte de l’extrême droite.
Explosif enfin, parce que justement, les deux députés sont des parlementaires macronistes «pur jus» du groupe Renaissance, le parti dirigé par Gabriel Attal. Justement! Si le rapport avait été rédigé par des députés «de droite» pour simplifier, du groupe RN ou Républicain, les commentateurs n’auraient pas manqué de dire qu’on ne pouvait pas attendre autre chose de députés de droite. C’est là toute la force de ce rapport: un document exhaustif, complet, argumenté, non politique mais objectif sur le coût de l’immigration algérienne en France.
Ce rapport porte en effet sur le coût de l’immigration algérienne en France. Son titre officiel est «Rapport d’information de la Commission des Finances (et non pas d’une commission spécialisée sur l’immigration) sur les implications juridiques et budgétaires des accords bilatéraux conclus en matière de circulation, de séjour, de santé et d’emploi, l’exemple de l’Algérie».
Le rapport chiffre le coût de l’immigration algérienne en France à environ 2 milliards d’euros par an, sans compter les coûts indirects (logement, emploi, coût juridique, encombrement des tribunaux, etc.).
«Les Algériens bénéficient d’un dispositif exceptionnel et dérogatoire à toutes les étapes du parcours migratoire.»
En effet, Charles Rodwell critique d’emblée le statut dérogatoire dont bénéficient les Algériens à chaque étape du processus. Trois éléments, précise-t-il, sont venus au fil du temps consolider et pérenniser ce régime d’exception:
1/ les avenants à l’accord de 1968,
2/ la folle jurisprudence du Conseil d’État qui a renforcé les privilèges des Algériens
3/ et enfin, la combinaison de l’Accord de 1968 et de la Convention de Sécurité sociale de 1980.
Pour être clair, les Algériens bénéficient d’un dispositif exceptionnel et dérogatoire à toutes les étapes du parcours migratoire: la combinaison de ces textes (Accord de 1968, convention de Sécurité sociale et jurisprudence) leur permet d’être gagnants à tous les coups :
- Entrée sur le territoire français grâce à un seul visa de court séjour et non un visa long séjour;
- Un Certificat de résidence «vie privée et familiale» est accordé de plein droit sans même l’exigence d’une entrée régulière en France;
- L’accès au regroupement familial est facilité en termes de délais comme de ressources prises en compte; le conjoint de Français a droit à un titre de séjour sans avoir obtenu un visa de long séjour. Le juge ne peut exiger ni vérifier l’effectivité de la vie commune des conjoints… ce qui facilite les «mariages blancs». Le titre de séjour ne peut être retiré pour polygamie…!
- Accès aux prestations sociales: aucune condition de durée de résidence n’est nécessaire pour obtenir le revenu minimum (RSA) ou le minimum vieillesse (APSA), même sans avoir jamais cotisé alors que les autres étrangers doivent justifier d’un délai minimum de 5 ou 10 ans pour bénéficier de ces prestations.
- Autre exemple, les Algériens sont la seule nationalité à ne pas devoir souscrire à l’engagement de respecter les «valeurs de la République» ou à avoir une connaissance minimale du français.
- La dette hospitalière algérienne croît d’année en année, faute de remboursement des soins par l’Algérie à la partie française;
- Les étudiants algériens obtiennent automatiquement un titre de séjour au titre de «commerçant» ou d’entrepreneur, sans avoir à prouver l’existence réelle de l’entreprise.
- La kafala est reconnue expressément et consacrée par le droit français, source de nombreuses dérives comme j’ai pu constater à Alger.
À chaque étage, c’est la distribution continue des privilèges. Même les observateurs les plus aguerris — dont l’auteur de ces lignes — restent stupéfaits devant l’ampleur des largesses accumulées, année après année, au profit des ressortissants algériens. La «perle» que j’ignorais est celle-ci: l’Algérie refusant de payer leurs pensions de retraite aux Algériens qui ne vivent pas en Algérie (par hypothèse, ils vivent en France), c’est la France qui, sans aucune obligation juridique ou internationale, prend à sa charge les pensions de retraite des dits Algériens… Les députés chiffrent à 1 milliard d’euros le montant des retraites versées aux Algériens résidant en Algérie.
Un mot doit être mentionné sur la responsabilité écrasante (je pèse mes mots) du juge administratif dans ce dossier, en particulier le Conseil d’État.
Le rapport mentionne régulièrement ce qu’il faut bien appeler la «dérive jurisprudentielle» de la Haute Assemblée ou la «folle jurisprudence» du Conseil d’État qui a systématiquement interprété dans un sens ultra-favorable aux Algériens les dispositions de l’accord de 1968. Le Conseil d’État et les juges administratifs portent une responsabilité écrasante qu’il ne faut pas sous-estimer. Ainsi le Conseil d’État estime qu’aucun texte ne s’oppose à une mesure de régularisation en faveur d’un Algérien qui ne satisfait pas à l’accord de 1968, ce qui revient à appliquer aux Algériens «l’admission exceptionnelle au séjour», non prévue par l’accord. Par ailleurs, l’administration ne peut jamais retirer un titre de séjour à un Algérien, puisque ceci n’est pas mentionné dans l’accord de 1968. En un mot, les avantages de l’accord de 1968 sont «bétonnés» par le juge et les avantages du droit commun des étrangers sont ajoutés à ceux qui découlent de l’accord de 1968. Même un Algérien qui constitue une menace pour l’ordre public ne peut se voir retirer son titre de séjour! Même remarque pour un Algérien polygame! Décidément, le juge administratif français est hors sol.
Les auteurs du document concluent à l’absolue nécessité de dénoncer les accords avec l’Algérie, tant ils privilégient une immigration qui profite des avantages accordés au fil des ans. Le tableau qu’ils dressent des caractéristiques de l’immigration algérienne en France est, à cet égard, édifiant: communauté mal intégrée, qui bénéficie de multiples dérogations et avantages, vivant de prestations sociales françaises. Le plus comique sans doute est l’interview donnée dans le journal l’Opinion par le Président Tebboune en début d’année: il expliquait que cet accord était totalement dépassé et devenu inutile pour les Algériens! Que la France le dénonce donc, ajoutait-il. Manifestement, il ne connaissait pas le sujet dont il parlait.
Xavier DRIENCOURT
21 octobre 2025