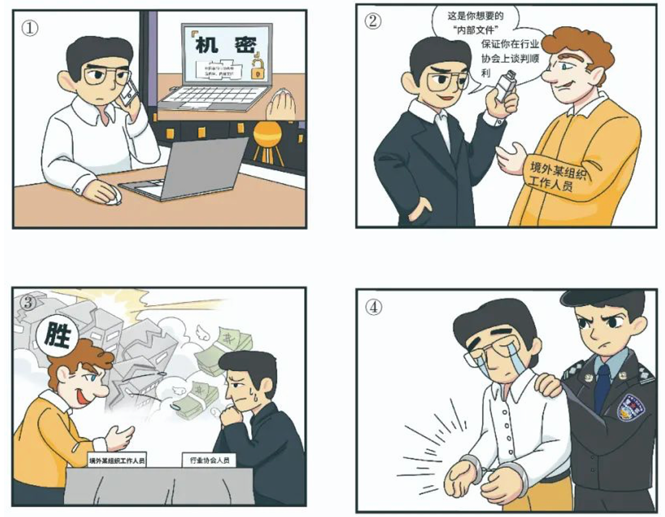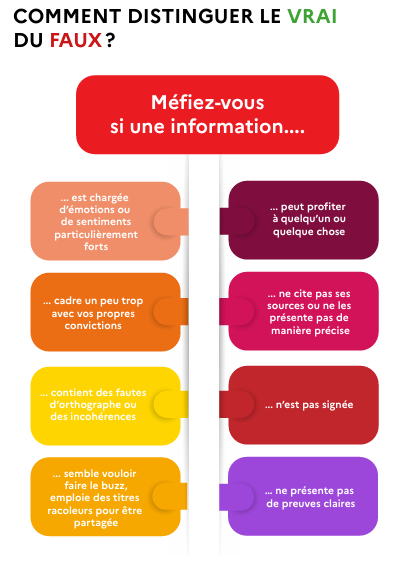Category: 1942-1945,1944 : Débarquements en France,2ème Guerre Mondiale (1939-1945),Actualités
Cet article explore les enjeux politiques autour de la Libération de Paris en août 1944, mettant en lumière le rôle crucial du Général De Gaulle dans l’installation de son gouvernement à Paris. Il souligne les rivalités avec le CNR et les communistes, ainsi que l’importance de la stratégie militaire alliée pour libérer la capitale. De Gaulle parvint à marginaliser les contre-pouvoirs, consolidant ainsi son autorité politique et préparant la transition vers une France libérée.
“Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l’appui et le concours de la France tout entière, c’est-à-dire de la France qui se bat, c’est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle !” – Général De Gaulle, Discours à l’Hôtel de Ville le 25 août 1944 soir.
En ce 80e anniversaire de la Libération de Paris, il n’est peut-être pas indispensable de rapporter une nouvelle fois l’histoire factuelle de cet évènement majeur de l’Histoire de France, d’autant plus, qu’à cette occasion, le film de René Clément « Paris brûle-t-il ? », sorti sur les écrans en 1966, va sûrement se trouver être une nouvelle fois programmé par les grandes chaînes de télévision nationale. En revanche, au-delà de la matérialité des faits, il apparaît opportun de rappeler les enjeux politiques de cet évènement, car, la nature et la forme des pouvoirs publics qui allaient exercer le pouvoir en France à la Libération dépendraient beaucoup de la façon dont Paris allait être libéré.
Il y a donc lieu d’exposer comme point de départ les grandes forces politiques, ainsi que les acteurs qui les composent, et qui vont parfois s’affronter durant une semaine, entre le 18 et le 25 août 1944 à Paris, ainsi que les acteurs militaires, français comme alliés de cet évènement.
Au niveau politique, bien évidemment, en premier lieu, il s’agit du Général De Gaulle, qui cherche à installer et asseoir son gouvernement dans la capitale, d’une façon telle qu’il ne soit l’otage d’aucune faction, toute légitime fût-elle. Si son charisme personnel lui a permis de définitivement faire reconnaître sa légitimité par les Alliés, son plus farouche adversaire politique, Roosevelt, l’a reçu officiellement à la Maison Blanche en juillet, il doit maintenant installer son gouvernement « dans ses murs », à Paris. Il s’agit là de l’aboutissement d’un processus complexe qu’il a déroulé point par point, depuis son arrivée à Alger, le 30 mai 1943, et qui s’est fortement accéléré depuis le Débarquement : la transformation du Comité français de libération nationale (CFLN) en Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) le 3 juin, d’abord, suivie de l’installation de François Coulet comme commissaire de la république pour la Normandie et Raymond Triboulet comme sous-préfet de Bayeux, premier chef-lieu d’arrondissement libéré, et sa reconnaissance par la population, le 14 juin, une grosse semaine après le Débarquement. Cet évènement lui a permis de s’imposer aux alliés américains qui avaient froidement imaginé une administration militaire américaine (AMGOT), comme si la France pouvait ainsi passer lors de la Libération, d’une occupation allemande à une occupation américaine. Pour incarner la légitimité de son gouvernement, au fur et mesure de la libération des chefs-lieux des départements concernés, Pierre de Chevigné, nommé commandant militaire des régions libérées, y installe les préfets désignés par une commission présidée par Michel Debré et dont les personnalités avaient été agréées par De Gaulle. De la sorte, la Libération ne s’accompagnait d’aucune vacance de pouvoir.
S’agissant de Paris, où il savait que son autorité risquait d’être confrontée à des contre-pouvoirs, De Gaulle disposait de deux atouts : d’une part, la Délégation générale du Gouvernement, entre les mains d’Alexandre Parodi qui était chargé d’encadrer toute insurrection potentielle et de mettre en place les secrétaires généraux dans les ministères, et d’autre part, Jacques Chaban-Delmas, délégué militaire national, qui devait également encadrer toute insurrection « spontanée » de la part des FFI.
En effet, l’exercice du pouvoir par De Gaulle, s’il n’était contesté sur le fond par personne, pouvait néanmoins se trouver limité dans sa forme, essentiellement par le CNR, et son président, Georges Bidault. On trouve ici un exemple illustratif de la lutte souterraine, mais classique, qui oppose souvent une résistance intérieure à l’organisation extérieure de la même résistance. Les premiers, agissant sur le territoire, prennent et assument tous les risques, sous la menace permanente de la répression implacable de l’ennemi, tandis que les seconds, exilés dans une capitale étrangère ou outre-mer, visent à l’exercice du pouvoir, le moment venu. Bidault va donc se trouver sous la surveillance – discrète mais ferme – de Parodi.
Et, il y a les communistes, qui sont parvenus à fortement noyauter la Résistance et ses différents organismes, notamment le COMAC, le comité d’action militaire, destiné à encadrer l’action des FFI, et passé sous le contrôle du CNR. Au mois de mai, un mois avant le débarquement, les communistes ont réussi un coup de maître en faisant nommer l’un des leurs, Henri Rol-Tanguy, aux fonctions de commandant les FFI d’Ile de France. La question se pose de savoir si les communistes voulaient réellement s’emparer du pouvoir, au bénéfice d’une insurrection parisienne qu’ils auraient alors noyautée, contrôlée, puis dirigée. Il semble bien que non, même si cette perspective n’était pas faite pour leur déplaire. En réalité, d’une part, le rapport de force politique ne jouait pas en leur faveur, et, d’autre part, en pleine guerre, le commandement allié n’aurait certainement pas admis un tel coup de force. En revanche, que les communistes aient cherché à obtenir le maximum de gages pour l’avenir pour obtenir des responsabilités leur permettant de peser lourdement sur les décisions, c’est certain.
Et enfin, la Libération de Paris ayant lieu par la force des choses en pleine guerre, il ne faut pas oublier le commandement militaire allié, exercé par le général Eisenhower. Celui-ci n’était aucunement hostile à De Gaulle et, au moment du Débarquement, pragmatique, il a sciemment ignoré les directives qui étaient les siennes de mettre en place une administration militaire en France, se rendant aux arguments de De Gaulle. Ceci écrit, il n’avait aucune intention de se laisser détourner de ses impératifs stratégiques de commandant d’une coalition militaire interalliée par des contraintes relevant du jeu politique français. Paris ne constituait pas un objectif militaire, et, la Seine ayant été franchie en aval et en amont de la capitale, la progression alliée pouvait se poursuivre et Paris tomberait, le moment venu, comme un fruit mûr. Néanmoins, avant le débarquement, Eisenhower avait assuré à De Gaulle qu’il pourrait disposer de la 2e DB, sous contrôle opérationnel national, pour libérer la capitale.
Du côté ennemi, le commandant allemand du « Gross Paris » n’exerçait qu’un commandement territorial, et savait qu’il n’avait que peu de possibilités de se faire renforcer par des moyens relevant du Groupe d’armées « B », le commandement opérationnel. En effet, à partir du moment où la Seine était franchie par les Alliés en amont et en aval de Paris, l’intérêt pour la Wehrmacht de conserver Paris qui possédait les seuls ponts intacts sur la Seine avait disparu, puisqu’il n’y aurait plus d’opérations conduites au sud du fleuve.
Telles étaient les parties en présence, aux alentours du 15 août 1944, lorsque la situation militaire en France permettait d’envisager à court terme, la possibilité d’une libération de la capitale. Comment le général De Gaulle et ses représentants parisiens vont-t-ils manœuvrer pour arriver à leurs fins, à savoir, l’installation de son gouvernement à Paris ?
La police parisienne (qui avait beaucoup à se faire pardonner pour son rôle sous l’Occupation) se met en grève le 16 août et, le 18, prenant tout le monde de court, le CNR s’empare de la Préfecture de Police et des commissariats d’arrondissement. Par le réseau de communications de la Police parisienne, l’insurrection dispose d’emblée d’un système de liaisons sécurisé couvrant toute la capitale. Parodi réagit immédiatement et installe Charles Luizet, préfet de police désigné, dans ses murs. Ainsi, le premier acte insurrectionnel de la Libération de Paris est coiffé par la légalité du Gouvernement provisoire. Rol-Tanguy réagit également et lance immédiatement un mot d’ordre d’insurrection générale à Paris.
Dès le 20 août, De Gaulle se pose en avion près de Cherbourg, accompagné de Juin, chef d’état-major de la Défense nationale qui va jouer un rôle majeur dans les relations avec Eisenhower. Dès son arrivée, De Gaulle va d’ailleurs rencontrer le commandant suprême allié, à qui il demande la mise à disposition de la Division Leclerc, conformément à leur accord. Eisenhower élude au prétexte que les opérations ne sont pas achevées en Normandie, mais il se rend bien compte qu’il va devoir dorénavant, et à très court terme, devoir tenir compte de la présence du chef du Gouvernement provisoire sur ses arrières.
Ensuite De Gaulle va, jusqu’au 24, mener un périple, qui va le conduire de Rennes à Rambouillet, en passant par Laval, Le Mans et Chartres. À chaque fois, le rite est immuable : il déambule dans la principale artère de la ville où il se fait acclamer, il se rend à la Préfecture où le préfet lui présente ses principaux collaborateurs, il prononce ensuite un discours, et participe enfin à un Te Deum à la cathédrale. Il rôde en province, au niveau local, ce qui sera son triomphe national à Paris sur les Champs Elysées, le 26 août.
Pendant ce temps, à Paris, la situation évolue et la « trêve » voulue par Parodi et Chaban est finalement rompue par Rol-Tanguy. La ville se couvre de barricades et les Allemands se retranchent dans quelques points forts, l’École militaire, le Palais Bourbon, le Luxembourg ou le quartier des Célestins, place de la République. Le PC du général Von Choltitz, installé à l’hôtel Meurice rue de Rivoli, bénéficie de la sûreté rapprochée d’un escadron de chars déployé dans le jardin des Tuileries. La situation est bloquée, les Allemands sont dans l’impossibilité de réduire les barricades et les insurgés dans celle de faire tomber les réduits allemands.
Parallèlement, dans un souci de légalité républicaine, Parodi fait s’emparer de l’Hôtel Matignon, et, le 21, y préside la première réunion des secrétaires généraux des ministères, présents à Paris. La légalité reprend ses droits, même en pleine insurrection.
Mais, surtout, dès le 22 août, Eisenhower fait volte-face et décide que Paris serait libéré militairement et, dans ce but, place la 2e D.B à la disposition de De Gaulle, ce qui crée des incompréhensions entre Leclerc et son commandant de corps d’armée, le général L. T. Gerow, qui a beaucoup de mal à admettre cette situation. Mais Leclerc avait anticipé et envoyé, dès avant l’officialisation de la décision, un sous-groupement commandé par le lieutenant-colonel de Guillebon avec pour mission, d’aller reconnaître le dispositif allemand couvrant Paris depuis l’ouest et le sud.
Le 23 en fin d’après-midi, sa division étant regroupée dans la région de Rambouillet où réside De Gaulle, fort des renseignements recueillis par Guillebon, Leclerc diffuse son ordre célèbre : « Intention : S’emparer de Paris ». Chargé de l’effort, le groupement Billotte est orienté vers la porte d’Orléans depuis Arpajon, couvert sur sa droite par Dio qui vise la Porte d’Italie, et à sa gauche, Langlade, depuis Versailles, doit entrer dans la capitale par le Pont de Sèvres. Le 24 matin, la 2e D.B. débouche sur ses trois axes en direction de Paris, mais la résistance allemande est plus solide que prévue et, en début de soirée, aucun élément de la division n’est encore entré dans la capitale. Leclerc prend alors une double décision : larguer un message lesté dans la cour de la Préfecture de Police (« Tenez bon, nous arrivons ! ») et, surtout, faire infiltrer une compagnie du RMT renforcée de chars (la Nueve du capitaine Raymond Dronne) pour atteindre l’Hôtel de Ville avant minuit, ce qui est réalisé.
Dès le lendemain matin, les dernières résistances allemandes en banlieue Sud sont, soit réduites, soit manœuvrées et les groupements de la division pénètrent dans la capitale conformément à l’ordre reçu. Von Choltitz fait savoir qu’il ne capitulera pas, mais qu’il est prêt à cesser le feu à l’issue d’un baroud d’honneur. Leclerc reçoit sa reddition à la Préfecture, puis retourne attendre De Gaulle à son PC de Montparnasse où ce dernier arrive dans l’après-midi. D’emblée De Gaulle fait preuve d’une grande intransigeance politique, en reprochant amèrement à Leclerc de voir la signature du chef FFI Rol-Tanguy aux côtés de la sienne sur l’acte de reddition allemand.
La soirée du 25, dans une capitale en liesse est un moment de grande politique. Se sachant attendu à l’Hôtel de Ville par le CNR au grand complet, De Gaulle rejoint d’abord le ministère de la Guerre qu’il avait quitté le 10 juin 1940 avec Paul Reynaud et où il compte s’installer, en lieu et place de Matignon. Il écrira dans ses Mémoires « Rien ne manque excepté l’État. Il m’appartient de l’y remettre. Aussi, m’y suis-je d’abord installé ». Ce n’est que plus tard dans la soirée que De Gaulle condescendra à se rendre à l’Hôtel de Ville. Mais, seulement après avoir été saluer le Préfet Luizet à la Préfecture, l’hommage à l’institution préfectorale primant dans son esprit sur celui d’un Comité, fût-ce le CNR. À l’Hôtel de Ville, son célèbre discours (dont le passage le plus connu est cité en exergue de cette tribune) est certainement un morceau d’anthologie oratoire, mais également un modèle politique. Non seulement, De Gaulle ne fait aucune référence aux Alliés (pourtant il en aura besoin, on va le voir), mais il ne dit pas un mot, pas un seul ! sur l’action de la Résistance. Exit les FFI. Qui plus est, lorsque Bidault lui proposera de proclamer la République du haut du balcon de l’Hôtel de Ville, De Gaulle refuse avec hauteur au prétexte que la République n’avait jamais cessé d’exister depuis juin 1940 et qu’il l’avait incarnée.
Les jeux politiques sont faits. De Gaulle a gagné, les éventuels contre-pouvoirs qui auraient pu entraver son action, le CNR ou les FFI communistes sont marginalisés. Avant la fin août, c’est-à-dire en moins d’une semaine, les milices patriotiques sont dissoutes, et ses membres sommés de rejoindre l’armée régulière. Les FFI communistes, regroupés autour de Pierre Georges dit colonel Fabien, formeront le 151e Régiment d’Infanterie, qui rejoindra la Première Armée (son commandant en second sera Rol-Tanguy). Lors du défilé glorieux sur les Champs Elysées, le 26 août après midi, il est très intéressant de remarquer le respect de l’ordre protocolaire, dans une ambiance qui ne devait peut-être pas toujours s’y prêter : Parodi, son Délégué national avec rang de ministre descend les Champs Elysées à la droite de De Gaulle, alors que Bidault, président du CNR doit se contenter de défiler à sa gauche, les deux, un pas en arrière de De Gaulle.
Ceci écrit, De Gaulle savait qu’il devait se méfier d’un éventuel sursaut de mécontentement du monde résistant ou communiste. Aussi, le 28 août, jour même où il signe la dissolution des milices patriotiques, De Gaulle demande à Eisenhower de faire défiler « du monde » à Paris, de manière à produire une image de force destinée à étouffer dans l’œuf toute velléité de révolte. Avec un grand sens politique, Eisenhower propose, ce qui est accepté, de faire transiter par Paris et à pied deux divisions qui doivent rejoindre leur zone d’engagement au nord de la Seine. L’effet est saisissant : ce ne sont pas moins de 30 000 hommes qui défilent à Paris, en tenue de combat et casque lourd, fusil à la bretelle. Sur les Champs Elysées, ils défilent en rangs serrés ! Auparavant, De Gaulle avait demandé au commandement américain de conserver la 2e D.B. à Paris jusque début septembre.
En conclusion, rencontrant Jacques Lecompte-Boinet le 1er septembre, non pas en tant qu’ancien membre du CNR, mais en tant que secrétaire général du ministère des Travaux publics, De Gaulle lui déclare : « La Résistance est dépassée. La Résistance est finie. Il faut que la Résistance s’intègre dans la Nation. Parce que, vous comprenez, il y a eu la Résistance, maintenant il y a la Nation »
Rédigé par le Colonel (ER) Claude Franc – Aout 2024