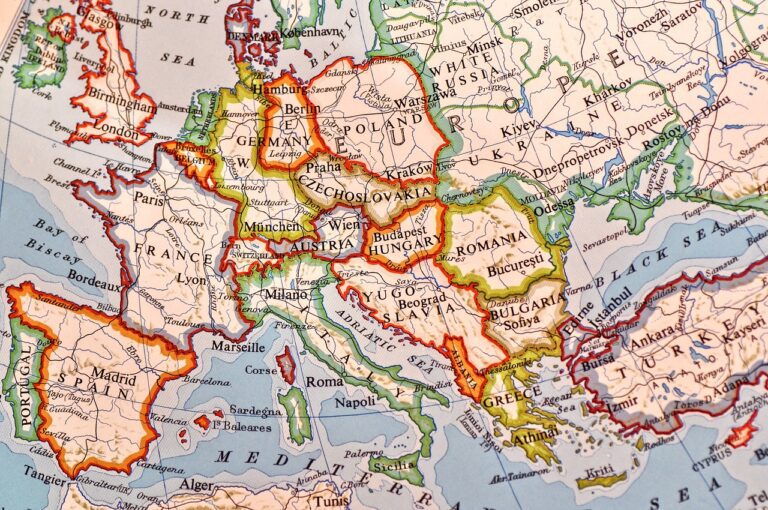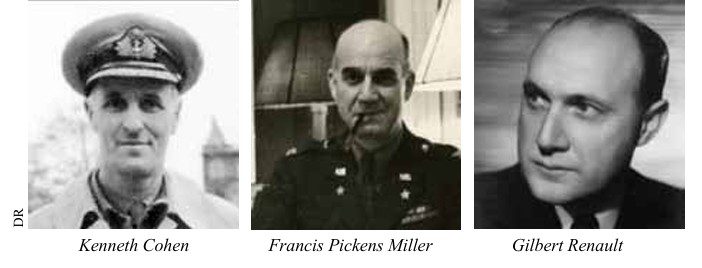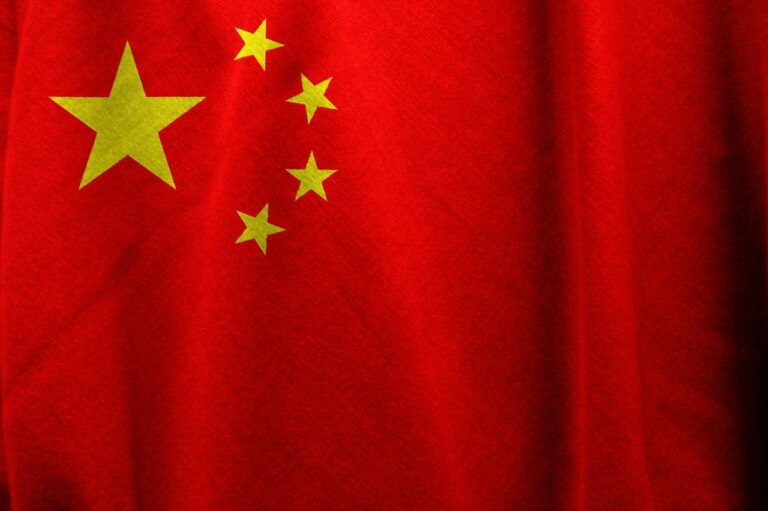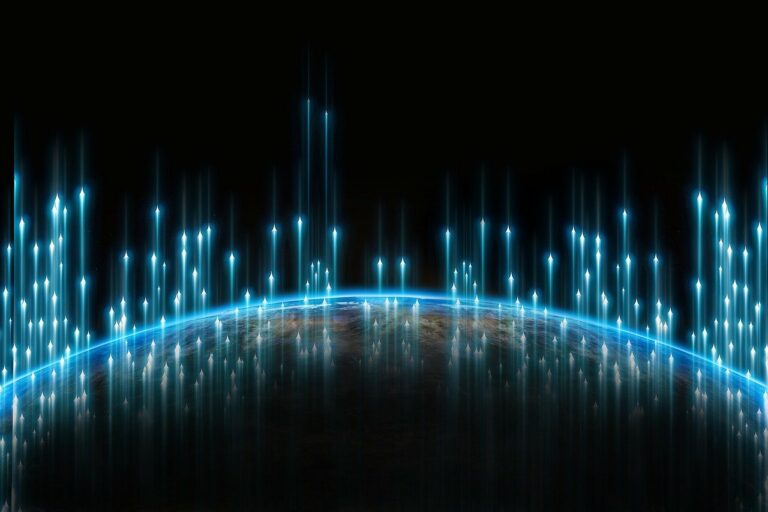Entretien avec le général Jean-Christophe Sintive, commandant la Gendarmerie de la Guyane-Française. Affecté à la tête de la Gendarmerie de la Guyane Française depuis le 1er août 2022, le général Sintive décrit un territoire dont la beauté n’a d’égale que l’exigence de l’engagement des gendarmes qui y servent.
Commentaire AASSDN : Compte tenu de sa situation géographique proche de l’équateur, de ses ressources naturelles et de sa superficie importante (1/6e de la Métropole), la Guyane est un atout pour la France. Mais la très forte immigration étrangère, les trafics et l’insécurité qui atteint des niveaux inconnus en Métropole sont de nature à transformer ce département d’Outre-mer à devenir un boulet pour notre pays, voire une proie pour ses voisins. Il est donc impératif et urgent de restaurer la sécurité et l’intégrité de ce territoire où opèrent de nombreux clandestins, souvent orpailleurs armés venus du Surinam et du Brésil. La Guyane doit constituer notamment avec Kourou, un pôle d’influence français en Amérique du Sud.
Avec ses 84 000 km², la superficie de la Guyane est comparable à 1/6e de l’Hexagone, mais ne compte que 300 000 habitants. Seul outre-mer français à ne pas être une île, ce territoire partage plus de 500 kilomètres de frontière avec le Suriname et 700 kilomètres avec le Brésil (plus précisément avec l’État fédéré de l’Amapá), ce qui en fait ainsi la plus grande frontière terrestre de la France, au cœur de l’Amérique du Sud. La Guyane constitue ainsi une porte d’entrée vers l’Europe, qu’il s’agisse de flux licites ou illicites de personnes et de biens.
Recouvert à 94 % de forêt équatoriale, ce territoire présente une biodiversité exceptionnelle. Celle-ci est néanmoins menacée par la déforestation, par l’orpaillage illégal et la pêche illégale. Terre de convoitises, la Guyane dispose de réserves aurifères et halieutiques importantes.
Passionné par ce territoire, le général Jean-Christophe Sintive s’engage quotidiennement aux côtés des gendarmes servant sous ses ordres. « J’adore la Guyane. J’exerce un commandement hors du commun. La gendarmerie est la force qui compte sur ce territoire, elle y fait face à des enjeux immenses. »
De ses débuts en Guyane jusqu’aux fonctions de Commandant de la gendarmerie de la Guyane Française
« Scientifique de formation, j’ai choisi la gendarmerie après ma scolarité à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. À l’issue de la formation à l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN, nouvellement Académie militaire de la gendarmerie nationale – AMGN), j’ai rejoint l’Escadron de gendarmerie mobile (EGM) 46/2 de Châtellerault, d’abord en tant que commandant d’un peloton blindé, puis à la tête du peloton d’intervention. J’ai participé à plusieurs missions, mais la première s’est déroulée en Guyane, constituant ainsi un véritable marqueur de ma carrière. J’ai également été engagé au Kosovo. J’ai ensuite été affecté à l’École polytechnique en tant qu’instructeur, avant de devenir commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Béziers. Ce temps de commandement s’est révélé particulièrement formateur en raison de l’activité judiciaire soutenue et des nombreux événements d’ordre public. Après un temps à la Direction générale de la gendarmerie nationale et une année de scolarité à l’École de Guerre, j’ai eu l’opportunité d’occuper un poste nouvellement créé au sein de l’Inspection générale de l’administration (IGA), dans le cadre du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur. Cette affectation m’a permis de disposer d’une compréhension des enjeux interministériels et d’obtenir des diplômes d’audit. Dans la continuité de ce poste, j’ai rejoint l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) afin de participer au développement de l’audit interne en gendarmerie. J’ai ensuite servi au sein du Bureau personnel officier, où j’ai pu appréhender les enjeux de l’Institution en matière de ressources humaines. De 2016 à 2019, j’ai commandé le Groupement de gendarmerie départementale de la Gironde, marqué par des enjeux périurbains et estivaux importants. À ce temps de commandement a succédé une nouvelle scolarité au sein du Centre des hautes études militaires (CHEM) et de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Cette formation m’a permis d’approfondir ma compréhension de la décision interministérielle et des enjeux géopolitiques de la France. À l’issue, j’ai occupé le poste de conseiller sécurité intérieure et défense sécurité auprès du ministre des Armées. En 2022, j’ai été affecté comme Commandant de la gendarmerie de la Guyane Française (COMGEND-GF).
Ce poste est exactement celui que je souhaitais obtenir. Je suis revenu en Guyane 23 ans après y avoir servi. Il s’agit d’un territoire exceptionnel, au sein duquel la gendarmerie joue un rôle majeur. Elle agit en effet sur plus de 99 % de ce territoire et assure la sécurité de 80 % de la population. À cela s’ajoutent les spécificités liées à la Lutte contre l’orpaillage illégal (LCOI), qui est une opération qui n’existe nulle part ailleurs, et à la protection du Centre spatial Guyanais (CSG). Pour ces raisons, commander la gendarmerie de Guyane présente un intérêt particulier. »
L’état de la menace
« La Gendarmerie doit faire face à des enjeux de sécurité extrêmement importants. La Guyane est confrontée à toutes les difficultés de l’Amérique du Sud et à des problématiques migratoires conséquentes. Les populations frontalières immigrent en Guyane en quête d’une vie meilleure. Le Produit intérieur brut (PIB) par habitant de ce territoire est deux fois supérieur à celui du Brésil et trois fois supérieur à celui du Suriname. La Guyane est marquée par un haut niveau de violence et par une circulation massive d’armes à feu. Les trafiquants de drogue utilisent la Guyane comme porte d’entrée vers l’Europe. Nous enregistrons 35 % des vols à main armée avec arme à feu et 20 % des tentatives d’homicide constatés par la gendarmerie sur le territoire national. Plusieurs phénomènes criminels sont aujourd’hui notables.
Depuis cinq ans, nous faisons face à l’arrivée de factions armées brésiliennes. Il s’agit de groupes criminels organisés qui ont commencé à se constituer dans les années 80 dans les prisons de ce pays. Ils cherchent désormais à s’étendre dans toute l’Amérique du Sud, voire à l’Europe via le Portugal mais aussi la France, en raison de la situation géographique de la Guyane. Les deux principales factions implantées en Guyane sont la FTA (Familia Terror do Amapá) et le Commando rouge. Ces organisations sont rivales, ce qui explique aussi les nombreux règlements de compte que nous constatons.
La Guyane est également victime de l’orpaillage illégal au cœur de la forêt équatoriale. On estime que 5 tonnes d’or ont été extraites illégalement en 2023. Cette année-là, nous avons saisi 61 millions d’euros d’avoirs criminels liés à l’orpaillage illégal. Actuellement, nous avons déjà atteint 76 millions de saisies et destructions. Ces résultats montrent que nous sommes présents et réactifs, mais cela ne suffit pas pour endiguer l’orpaillage illégal, dont la croissance est largement corrélée à l’augmentation du prix de l’or. Les moyens que nous engageons pour lutter contre ce phénomène doivent être proportionnels, pérennes et renouvelés. L’enjeu est de tenir la forêt équatoriale pour éviter qu’elle ne soit dévastée par des délinquants qui n’ont aucune conscience environnementale.
Le CSG constitue également un véritable enjeu de sécurité. La gendarmerie est chargée de la protection du site dans le cadre d’une convention conclue avec le Centre national d’études spatiales (CNES). Une partie des effectifs dédiés est financée par cette agence. À la suite du lancement réussi d’Ariane 6, l’activité du site va s’intensifier dans les prochaines années. L’ambition commune du CNES et de l’Agence spatiale européenne est de pouvoir réaliser jusqu’à trois lancements par mois. La gendarmerie devra s’adapter à cette accélération et monter en puissance.
Nous sommes également confrontés au défi de l’accroissement démographique. La population augmente de 3 % par an et même de 5 % par an dans certaines communes du territoire. La gendarmerie doit être en mesure de suivre cette évolution en adaptant son dispositif territorial. Le plan de création de 239 brigades lancé par le président de la République prévoit l’implantation de quatre nouvelles unités en Guyane. La première d’entre elles, la brigade fluviale de gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni, a été inaugurée en avril 2024 et est aujourd’hui pleinement opérationnelle. »
Un engagement exigeant
« La gendarmerie a pris en compte le phénomène des factions. En raison de la difficulté à conduire les investigations les concernant, la Section de recherches (S.R.) de Cayenne a été réorganisée. Ses effectifs ont également été augmentés. Alors qu’elle ne comptait que deux divisions en début d’année (une division consacrée aux crimes commis en forêt équatoriale et une division dédiée à ceux commis sur le littoral, c’est-à-dire dans les zones habitées), elle est désormais structurée en quatre divisions (criminalité organisée, criminalité sérielle et complexe, criminalité économique et financière et LCOI). À celles-ci s’ajoute un Groupe appui renseignement (GAR). La division criminalité organisée est spécifiquement chargée de la lutte contre les factions. De nombreuses opérations judiciaires visant les factions ont d’ores et déjà été réalisées afin d’entraver leur développement. Ce travail commence à porter ses fruits.
La LCOI a été organisée autour de l’opération Harpie. Il s’agit d’un dispositif comprenant à la fois un contrôle de zone dans la profondeur, des actions aéroportées d’opportunité et des points de contrôle terrestres et fluviaux en forêt et sur le littoral, afin d’endiguer les flux logistiques. Deux Escadrons de gendarmerie mobile (EGM) sont normalement consacrés à cette mission en plus des unités de gendarmerie départementale de Guyane, de la Brigade fluviale et nautique de Matoury, de la Section de recherches (S.R.) de Cayenne, de la Section aérienne gendarmerie (SAG) et de l’Antenne du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (A-GIGN). Cette opération est coordonnée par le Centre de conduite des opérations (CCO). Rattaché au COMGEND-GF, cet état-major dédié à la LCOI est chargé de planifier, d’organiser et de conduire les opérations menées dans ce domaine, en lien avec les Forces armées en Guyane (FAG). Innovant en permanence, la gendarmerie de Guyane a fusionné son J2 CCO (renseignement) avec celui de l’État-major interarmées des FAG, afin de poursuivre l’amélioration du ciblage des opérations.
Notre action sur le terrain s’est toutefois amoindrie ces derniers mois en raison de l’engagement des EGM sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ainsi qu’en réponse aux crises survenues en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. Nous avons tout mis en œuvre pour compenser la diminution du nombre de gendarmes mobiles par un renforcement de l’activité des gendarmes départementaux et leur déploiement en forêt. Cette manœuvre a également permis de former largement les gendarmes départementaux sur une mission fondamentale pour la Guyane. Cet investissement estival multiplie aujourd’hui nos capacités opérationnelles en la matière. »
La coopération au cœur de l’efficacité opérationnelle
« Nous travaillons étroitement avec les FAG, tant dans le cadre de la LCOI, qu’au CSG. Nos actions et nos moyens sont complémentaires. Nous coopérons également avec de nombreux services étatiques, et notamment avec la police nationale, à Cayenne, à Saint-Laurent du Maroni, à Saint-Georges ou encore à l’aéroport. Le Parc amazonien de Guyane (PAG), l’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Office national des forêts constituent également des partenaires quotidiens dans nos missions de protection de l’environnement.
On ne pourrait pas être efficaces si on ne développait pas des relations privilégiées avec les partenaires internationaux. Nous avons renforcé notre coopération avec la Korps Politie Suriname (KPS), en mettant en place des patrouilles conjointes des deux côtés du Maroni, ainsi qu’avec les polices du Brésil, notamment la police fédérale et les polices de l’État de l’Amapá. L’interpellation très récente par la KPS à Paramaribo, d’une équipe de cinq malfaiteurs chevronnés qui avait fui la Guyane et leur remise immédiate à la gendarmerie constituent la démonstration que nous sommes sur la bonne voie.
Structure prévue par une loi française et brésilienne, le Centre de coopération policière (CCP) de Saint-Georges facilite et fluidifie l’échange d’informations judiciaires et policières. »
Une gendarmerie de proximité
« Il est important que la gendarmerie soit un acteur reconnu de la sécurité des Guyanais. Elle doit être appréciée pour son contact, sa proximité et son intégration dans la vie guyanaise. À cette fin, nous avons développé des missions de Police de sécurité du quotidien (PSQ) permettant de nous rendre dans les villages isolés habités par les populations autochtones. Ce dispositif nous permet de mieux les comprendre et de rencontrer des gens qui ne sont pas en mesure de venir jusqu’à nous.
La proximité passe également par un recrutement local. Depuis deux ans, j’ai développé cet objectif au sein de la réserve et des gendarmes adjoints volontaires, grâce notamment à la montée en puissance du centre régional d’instruction. Nous en constatons les premiers résultats avec une augmentation de notre attractivité. À cette fin, nous avons signé un partenariat avec le Régiment du service militaire adapté (RSMA). »
Des gendarmes passionnés
« La Gendarmerie de Guyane peut vraiment compter sur le dynamisme de ses gendarmes. Ils remplissent des missions passionnantes qui ont du sens. La population apprécie leur action. Ses attentes envers eux sont fortes. Les gendarmes qui travaillent ici sont véritablement passionnés. Ils sont confrontés à un engagement majeur, probablement l’un des plus exigeants de leur carrière, mais celui-ci est particulièrement galvanisant.
Dans le même temps, la Guyane est une terre accueillante. La population est avenante et les gendarmes ont développé une véritable solidarité entre eux, ce qui les aide à se sentir bien dans leur vie professionnelle comme personnelle.
Ils ont la chance de servir sur un territoire d’une beauté extraordinaire. La forêt équatoriale présente une biodiversité incroyable. C’est un émerveillement quotidien, tant pour les gendarmes que pour leurs familles. »
Des enjeux d’avenir
« Les enjeux sont énormes et les possibilités le sont tout autant. La Guyane est une terre d’innovation. Nous avons déployé la Starlink sur le territoire. Au regard des résultats satisfaisants de ce système, nous l’avons expérimenté sur un véhicule pendant le Relais de la Flamme Olympique. Ce premier véhicule équipé du système Starlink permet de procéder à des contrôles en mobilité sur tous les axes du territoire, ce qui n’était pas le cas avant. De nombreuses initiatives sont menées, ce qui est pour moi, comme pour les gendarmes, une véritable source de satisfaction.
Capitaine Tristan MAYSOUNAVE
Article publié sur le site Gendinfo
07 novembre 2024
Crédit photo : © GEND/ SIRPAG/ ADC.BOURDEAU