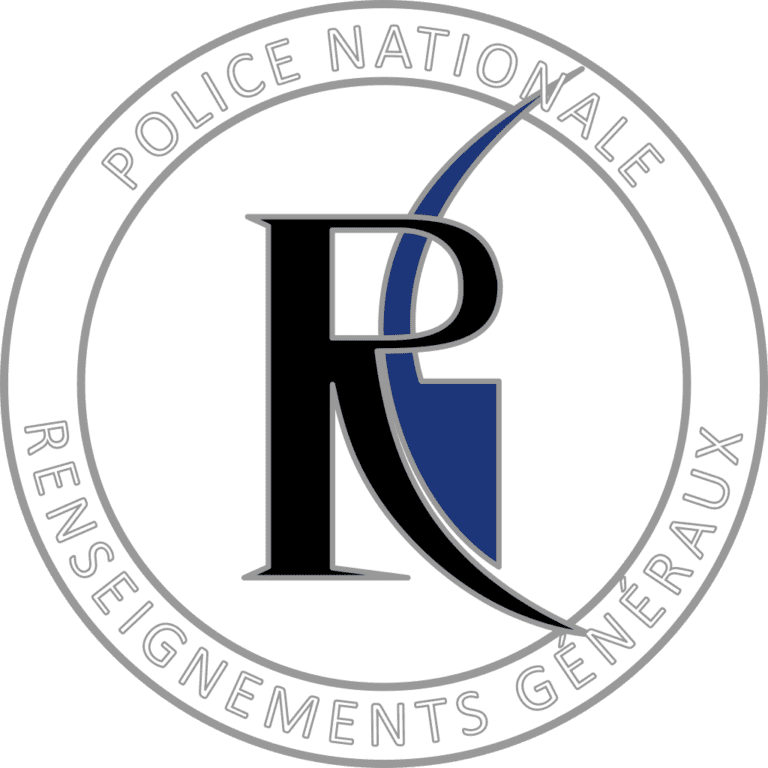Les guerres d’Ukraine : conflits, enjeux et bouleversements géopolitiques

Au-delà de l’invasion du 24 février 2022, les guerres d’Ukraine s’inscrivent dans une trame historique et stratégique plus vaste, où se croisent droit international, rivalités géopolitiques et reconfiguration des alliances mondiales. Entre lectures multiples et réalités du terrain, ce conflit redéfinit les rapports de force et interroge l’avenir de l’ordre international.
Les guerres d’Ukraine sont aussi multiples que leurs lectures. On sait depuis Montaigne que la géographie commande la vérité. La Défaite de l’Occident[1] d’Emmanuel Todd parle d’un affaiblissement sociologique, religieux et moral de l’Occident. C’est une lecture. Nous serons plus court et tenterons de prévoir les conséquences de l’affrontement. Rien ne commence le 24 février 2022. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une conséquence avant d’être une cause. L’Opération Z ne doit pas cacher la forêt qui précède. Ces guerres viennent de loin. Plusieurs grilles d’interprétations décrivent des événements superposés à d’autres évènements. Comme les couches géologiques ces évidences s’accumulent sans s’annuler. Les guerres d’Ukraine interrogent les diplomaties de nos États et de nos entreprises. Des acteurs émergent qui ne pensent pas le monde comme nous.
Le droit international
Le droit international est invoqué par les deux parties. L’Occident dénonce la violation des frontières. L’ONU déplore l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations unies. L’Organisation « exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force contre tout État membre. » On ne peut être plus clair.
La Russie de son côté invoque l’article 51 de la charte des Nations unies qui lui permet après la reconnaissance des Républiques de Donetsk et de Lougansk de répondre à la demande de légitime défense d’États soucieux de mettre fin aux bombardements des populations civiles. En théorie l’argument est recevable. Mais les circonstances sont pour le moins discutables…
Il n’en reste pas moins que le droit international est malmené. Par exemple le non-respect des multiples résolutions de l’ONU dans le conflit israélo palestinien, la contestation par plusieurs pays africains de la justice pénale internationale, les guerres illégales des États-Unis depuis 1945[2] affaiblissent ce même droit international.
Le non-respect des accords de Minsk 1 et Minsk 2 garantis par la France et l’Allemagne conjointement avec l’Ukraine et la Russie dans le format Normandie[3] ne renforce pas le droit international. La chancelière aussi bien que le président français ont reconnu publiquement avoir menti aux Russes pour permettre à l’Ukraine de se réarmer entre 2014 et 2022 afin de reconquérir la Crimée et le Donbass[4].
Savoir que les Russes n’étaient pas dupes, n’oblitère pas l’affaiblissement de la crédibilité occidentale dans le respect des engagements diplomatiques. Le décret présidentiel ukrainien interdisant toute discussion avec le président Poutine ajouté à l’annulation des élections en Ukraine paralysent pour l’instant les solutions diplomatiques.
Les accords d’Istambul[5] signés le 29 mars 2022 grâce aux démarches du gouvernement israélien et de la présidence turque décrivaient sur 32 pages un accord de cessez-le feu. Une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine était prévue sous l’égide des Nations Unies. L’Ukraine reconnaissait des droits linguistiques et administratifs aux minorités russophones de l’Est dont elle conservait les territoires. En échange du retrait militaire russe, déjà entamé, elle s’engageait à ne pas intégrer l’OTAN, seconde exigence de Moscou. L’arrivée à Kiev le 8 avril 2022 de Boris Johnson, Premier ministre britannique, encourage un revirement de la partie ukrainienne soutenue par l’Union européenne et les États-Unis[6]. La guerre va se poursuivre.
Cette paix ratée, confirmée par le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le président turc Recep Erdogan, offrait une porte de sortie au président Zelensky. Celui-ci avait été élu le 20 mai 2019 avec 73,2% des voix à la suite de sa promesse de finir une guerre civile ayant fait 14 000 morts depuis la destitution du président Ianoukovitch en février 2014, après l’insurrection de Maïdan. Les historiens, en Ukraine et aux États-Unis, débattent du déroulement et du financement de cette révolution de couleur, notamment du rôle de la CIA, du MI 6 et de madame Victoria Nuland, alors sous-secrétaire d’État à l’Eurasie dans la conduite des opérations.
Depuis leur arrivée à la Maison Blanche le président Donald Trump et Robert F. Kennedy Jr ont à plusieurs reprises confirmé cette thèse affirmant que la CIA, avec les fonds dE L’USAID (5 milliards de dollars) a programmé le coup d’État de Maïdan et poussé la Russie à intervenir en Ukraine pour secourir les populations russophones.
L’objectif était comme nous allons le démontrer de s’emparer des richesses et matières premières de l’immense Fédération de Russie à la suite de son effondrement économique. L’échec de cette entreprise démocrate conduit les Républicains à se replier sur le Groenland et Panama, et à taxer l’Union européenne le Canada, le Mexique, la Chine.
L’équilibre de la terreur
Le conflit entre la Russie et les États-Unis n’a pas éclaté pour cause de terreur réciproque. En 2022 les deux puissances renoncent à s’affronter directement. En témoigne l’absence d’interdiction aérienne par les États-Unis et à fortiori par l’OTAN. L’Occident laisse l’aviation russe décapiter celle de l’Ukraine. La partie sur le plan militaire est jouée dès le début malgré les discours sur les plateaux de télévision. Plusieurs raisons expliquent la non-intervention américaine.
Le 24 février 2022 la Russie dispose de forces balistiques, aériennes et sous-marines redoutables. Les vecteurs R-28 Sarmate, Avangard, Kinjal, Poséidon, RS-26, R28, Zircon, pour ne citer que ceux-là, sont des armes hypervéloces atteignant des vitesses proches des 30 000 km/h. Ils sont également d’une grande précision. Ces vecteurs utilisent les possibilités offertes par la MHD, magnétohydrodynamique[7] théorisée en France par le physicien Jean-Pierre Petit. Les forces balistiques russes ont accordé de l’importance à ses publications scientifiques.
Le 21 novembre 2024 une attaque conventionnelle à partir de l’un de ces vecteurs l’Oreshnik (noisetier) pouvant transporter quatre bombes atomiques a touché le complexe militaro-industriel Iouzhmash à Dnipropetrovsk. La destruction par armes cinétiques de ces installations n’est pas anodine. Il s’agit d’une réponse politique et personnelle adressée au président Joe Biden qui autorisa l’Ukraine le 16 novembre 2024 à tirer 6 missiles ATACMS dans la profondeur du territoire russe[8].
Pour éviter tout malentendu, le Kremlin prévint les États-Unis avant le lancement du missile en certifiant qu’il ne transporterait pas d’armes nucléaires. Avertissement confirmé le lendemain par la porte-parole du Pentagone. Depuis 1945, les deux puissances n’ont jamais cessé d’utiliser les « canaux de sécurité habituels » afin d’éviter les méprises. Il en fut ainsi lors de la crise des missiles de Cuba en 1962.[9] Il en va de même dans le monde du renseignement où les dirigeants des deux communautés, russes et américaines, se connaissent et gardent le contact.
La « nuit du noisetier » s’adresse à la France et à la Grande-Bretagne autant qu’aux États-Unis. La Russie montre qu’elle peut à partir d’un missile hypersonique de moyenne portée (5 000 km), atteindre le sol ennemi et surtout le sous-sol avec des armes cinétiques.[10] En avertissant l’adversaire, elle montre que ses vecteurs sont à l’abri de toute interception. Elle met en avant un souci des populations civiles destiné à la propagande qui impressionne l’opinion.
En ajoutant un échelon conventionnel en amont de la dissuasion nucléaire, la Russie plonge les états-majors de l’OTAN dans une réflexion qu’ils avaient anticipée. Le Pentagone, bien informé, avait déjà retiré son porte-avions de mer Rouge.[11] La Chine, préoccupée par Taïwan, observe avec envie ce nouvel outil dissuasif. L’Inde, nous le verrons, coopère déjà avec le complexe militaro-industriel russe.
Ironie de l’Histoire, cette dissuasion non-nucléaire d’une portée moyenne a été rendue possible par le président Donald Trump lorsqu’il a dénoncé les traités interdisant ce type de missiles sur le théâtre européen lors de son premier mandat (2019). « La Russie a dû s’adapter » affirme le Kremlin. L’initiative de ces traités et leur dénonciation par les uns ou les autres mérite une étude spécifique tant les propagandes et désinformations entourent le sujet.
Présentée le 13 avril 2018 par le président Poutine devant les députés de la Douma et plusieurs centaines de scientifiques,[12]la panoplie balistique russe dissuade pour l’instant tout belligérant, fussent-ils les États-Unis. Cette technologie intéresse depuis longtemps les BRICS. Le BrahMos est un missile de croisière supersonique pouvant être lancé à partir d’un sous-marin, d’un bâtiment de surface, d’un avion ou d’une station terrestre. Développé conjointement par l’Inde et la Russie – qui ont créé à cette fin une société commune, BrahMos Aerospace Private Limited -, il tire son nom du Brahmapoutre, fleuve indien, et de la Moskova, fleuve russe. Sa vitesse de croisière est d’environ Mach 2,5-2,8, ce qui le rend trois fois et demie plus rapide que le missile subsonique américain Harpoon. Une version hypersonique de ce vecteur est en développement, le BrahMos-II. Cette supériorité aérospatiale se retrouve dans le domaine aéronautique où les performances des derniers Sukoi 57[13] et Mig 41 intéressent les armées de plusieurs nations.
Le champ de bataille
Avant d’aborder les conséquences économiques, culturelles, politiques de cette guerre, il est utile de comparer les deux lectures du champ de bataille.
Les experts occidentaux, à part quelques exceptions, commentent les combats à partir des avancées ou des reculs sur la carte. Ils recensent sur des tableaux les moyens matériels et financiers à la disposition des belligérants. Les experts russes s’expriment sur les médias domestiques et ceux du Sud Global où ils sont écoutés. Le souvenir de l’URSS qui soutint les guerres anticoloniales leur garantit une attention particulière. Les auditeurs et téléspectateurs comparent les spécialistes de la « guerre civile européenne ». Pour l’OTAN, les progrès territoriaux de Moscou ont longtemps paru médiocres, obtenus au prix de « pertes abyssales ».
L’art de la guerre russe, héritier d’une longue tradition[14] ne vise pas prioritairement la conquête ou la conservation des territoires. Les campagnes contre la Suède, la Pologne, l’Allemagne ou la France ont enseigné aux officiers russes que l’essentiel est la destruction de l’armée ennemie. L’espace, le temps et la météo sont pour eux des avantages gratuits. Le silence également.
La foi dans l’industrie financière caractérise l’approche anglo-saxonne. Avec un budget militaire de 916 milliards de dollars – contre 109 pour la Russie -, les États-Unis disposent d’une force écrasante.[15] Cette supériorité justifie la dépréciation de l’ennemi. Madame Ursula Van der Layen déclarait le 14 septembre 2022 à la tribune du Parlement européen que la Russie achetait des machines à laver partout dans le monde pour récupérer des puces électroniques afin de faire voler ses fusées et ses avions. Elle ajoutait que le complexe militaro-industriel russe était en lambeaux…
Selon Karen Kwiatkoswski, sociologue du complexe militaro-industriel, ancien officier, le budget américain entretient une pléthore de généraux. Il produits des armements couteux bénéficiant aux entreprises de la Défense dans lesquelles nombre d’officiers achèveront leur carrière. Cette armée trop grasse est moins efficace que dans le passé. Sur le terrain il s’avère que les matériels occidentaux ne sont pas à la hauteur d’une guerre terrestre de haute intensité. Les armes qui devaient « changer la donne » en faveur de l’Ukraine se révèlent les unes après les autres inefficaces. Seul le Caesar français, dont les tubes chauffent malheureusement plus vite que ses concurrents russes, et nos Rafale pourraient tenir tête à l’armée russe[16].
Les rapports se succèdent sur les échecs répétés du F-35. Fiabilité et furtivité ne sont pas à la hauteur des attentes. Parmi les problèmes figurent des retards fréquents dans la maintenance, des dysfonctionnements de l’armement et des vulnérabilités non résolues en matière de cyberdéfense. Selon Greg Williams, directeur du Project on Government Oversight (POGO) le dernier rapport révèle des failles importantes qui pourraient inciter l’administration Trump II à exiger une révision complète d’un programme dont les coûts immenses ne sont pas à la hauteur du résultat.[17]
Quand on sait que le projet F 35 « séduit » les aviations de l’OTAN, on mesure les défis auxquels nos forces aériennes, hormis la France, seront soumises. On se souviendra à l’occasion des déclarations d’experts militaires, de généraux, d’ambassadeurs, évoquant sur nos médias les faiblesses structurelles, voire congénitales, d’une armée russe démoralisée, sous-équipée, confrontée à des désertions massives, se battant avec des pelles…
Des journalistes de renom complétaient le tableau en évoquant la santé mentale voire physique du président Poutine, isolé dans son pays, paria sur la scène internationale. Ces encouragements repris par les médias ukrainiens galvaniseront une infanterie qui subira des pertes réellement abyssales, en croyant percer le système Sourovikine[18] en particulier à Robotino, Krinki, Uglédar et autres « sacs à feux ».
La très lente avancée des forces russes jusqu’à décembre 2024 n’a pas pour seule cause la stratégie d’attrition chère à Moscou. Une autre raison explique l’absence des grandes chevauchées blindées des années 1944-1945. Elles sont impossibles aujourd’hui car vouées à l’échec. Des deux côtés.
Les drones changent la guerre
Le combattant vit une guerre de plus en plus terrifiante menée des deux côtés par des jeunes gens intégrés dans les unités de première ligne. Ces nouveaux soldats jouent à la vraie guerre comme dans un jeu vidéo. Il n’y a plus de protection, il n’y a plus de tranchée ou d’abri comme à Verdun. « Si tu bouges le drone te repère, il te tue. Si tu es immobile il finit par te repérer, si tu urines contre un arbre, il détecte la chaleur qui sort de toi[19] ». « L’artillerie russe, tu ne la vois jamais mais elle te voit ! ».
Dans les deux camps l’ingéniosité des dronistes est stupéfiante. Le Babayaga ukrainien était à l’origine un drone agricole. Il en existe désormais plusieurs versions larguant des mines ou des grenades sur l’ennemi. Il va sans dire que la mise au point de ces engins est à l’origine d’accidents mortels, d’amputations des bras.
Chez les Russes la famille des Kolibri fait l’objet d’incessantes modifications. Ces appareils volent en essaim. Certains font de la reconnaissance. Ils éclairent le chemin des drones frappeurs. Spécialistes de la guerre électronique les Russes mettent au point une nouvelle génération de drones. Ils sautent d’une fréquence à une autre afin d’échapper aux tentatives de brouillage. Les drones deviennent compacts. Les Hummingbirds sont pliables. Ils tiennent dans un petit boîtier. Ils ne pèsent pas plus de quatre kilos. Des championnats internationaux de guerre des robots ont lieu dans les pays appartenant aux BRICS.
La guerre des drones augure d’un avenir inquiétant pour l’Europe. Les compétences du champ de bataille seront le bras armé de groupes radicaux ou mafieux. Ils mèneront des guerres dévastatrices contre leurs concurrents. Les spécialistes se forment sur place, in vivo. Le combattant de demain sera jeune, manipulable. Il opérera depuis le trottoir d’en face. Nos services de renseignement extérieurs et intérieurs pensent déjà aux contre-mesures. Comme en 1946, l’après-guerre risque d’être violent.
Les drones comme les satellites qui peuvent en coordonner les essaims sont par ailleurs un enjeu de la guerre économique comme nous le verrons plus loin.[20] En décembre 2024, la Chine réduit le volume de ses exportations de métaux précieux comme le gallium, l’antimoine ou le germanium vers les États-Unis. Pékin d’attire l’attention de la Maison Blanche sur le rapport de force des deux géants dans le domaine des technologies à double usage, militaire et civil. En cette occasion, le ministère du Commerce annonce que les livraisons de graphite à usage civil, notamment dans les batteries, feront l’objet de contrôles stricts.
Le renseignement, arme déterminante
Dans un article du New York Times paru le 25 février, 2024 on apprend ce que l’on savait déjà. La CIA est largement impliquée en Ukraine. Après plus de 200 entretiens avec d’actuels ou anciens fonctionnaires ukrainiens, américains et européens, deux journalistes dressent le tableau d’une collaboration des agences de renseignement ukrainiennes et américaines depuis la révolution de Maïdan en février 2014.
La « Compagnie » compte officiellement 12 bases le long de la frontière russe, et elle n’est pas le seul service de renseignement américain. On sait que la NSA est venu « durcir » les communications ukrainiennes avant le 24 février 2024, dans l’optique d’une reconquête de la Crimée et du Dombass.
La cohabitation des services occidentaux avec leurs homologues ukrainiens n’a jamais été un fleuve tranquille. Des complications surviendront lorsque le président Donald Trump demandera à son homologue Zelensky une enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, lors de son premier mandat. Il n’en reste pas moins que le renseignement occidental fournit à l’Ukraine de précieuses informations permettant la réalisation de frappes dans une profondeur limitée…
A la suite de l’invasion russe, Joe Biden autorise les agences américaines à abandonner les anciennes règles. Elles sont autorisées à soutenir des opérations létales visant les troupes russes présentes sur le territoire ukrainien. La CIA avertit ses alliés d’un couloir humanitaire déployé à Marioupol risquant de se transformer en piège mortel. Elle permet de déjouer un complot qui menaçait le président ukrainien. Les services américains ne sont pas les seuls sur place. Tous les pays membres de l’Union européenne ont leurs « observateurs ».
La collaboration n’exclut pas la méfiance. Jusqu’à la destitution par le parlement du président Viktor Ianoukovytch les services de Kiev collaboraient avec leurs homologues russes civils et militaires. Il reste des sympathies inavouées au sein de l’appareil ukrainien pour le grand frère russe. Cela explique les ciblages, les attentats contre les sergents recruteurs,[21] les sabotages sur les lignes logistiques, et les dépôts d’armes. Emerge à l’ouest du Dniepr une résistance qui ne peut survivre sans la complicité d’une partie du renseignement ukrainien.
Les entreprises occidentales impliquées dans les guerres d’Ukraine disposent de compétences en matière de renseignement privé. Les cellules bien équipées sont animées par des anciens des services officiels. Les investisseurs céréaliers ou miniers animent des réseaux qui s’étendent bien au-delà des frontières ukrainiennes. Depuis le Moyen-Âge et la Ligue hanséatique, l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas ont des intérêts en Ukraine et en Russie. Leurs entreprises, banques et compagnies d’assurance sont en mesure d’éclairer le gouvernement de Kiev à partir d’entrelacements commerciaux, philanthropiques, philosophiques, religieux. Bien des ONG sont les avatars de ces traditions. Il en va de même d’Israël dont les services civils et militaires, les start-ups dans le domaine de la cybersécurité ont des clients des deux côtés de la frontière.
Rien cependant ne laissait prévoir le rôle prépondérant de Starlink. « Sans lui nous aurions perdu la guerre » commentent les officiers ukrainiens. Sur le front, le système de satellites d’Elon Musk est un outil-clé pour Kiev. Il permet des liaisons en principe sécurisées et joue un rôle dans le pilotage des drones. Une entreprise privée devient belligérante, pèse sur le cours des opérations militaires.[22] La médaille a cependant son revers. Le propriétaire de SpaceX a empêché son utilisation pour frapper une base de la marine russe afin d’éviter, dit-il, un « mini Pearl Harbor. »
Le diable, se situe dans les détails. La couverture de l’Ukraine en septembre 2023, selon la carte officielle sur le site web de Starlink « oublie » les zones situées le long des frontières biélorusses et russes. La Crimée et certaines parties du Donbass ne sont pas protégées. Elon Musk sait dès le 24 février 2022 que les États-Unis ne combattront pas. La guerre économique suffira à faire tomber le gouvernement russe. Par la même occasion, il montre à la Chine où il possède des intérêts et qu’il n’est pas un jusqu’au-boutiste. Inutile d’insulter l’avenir. La participation du réseau privé de communication ouvre un chapitre peu connu des guerres d’Ukraine : la cyberguerre.
La cyberguerre au centre de toutes les autres
L’interception du signal, le brouillage des fréquences, l’interprétation des captations par le cerveau humain ou l’intelligence artificielle atteignent des niveaux de sophistication jamais vus auparavant. Les drones dont nous venons de voir l’efficacité sont désormais pilotés par fibre optique, tel autrefois le célèbre Milan, arme antichar française filoguidée. Les images en direct des impacts transforment le conflit en « spectacle ». Dans les deux camps, chaque unité se déplace avec ses brouilleurs et ses dronistes. Les groupes d’assaut, de plus en plus petits pour limiter les pertes, « reniflent » l’ennemi, le rendent visibles à l’artillerie, aux bombes planantes, aux lance-flammes.
Les belligérants développent des politiques de souveraineté numérique. Celles-ci se déclinent en trois chapitres, la maîtrise du hardware, les installations lourdes, le software, les logiciels et le cloud, la maîtrise des données. L’Europe et la Russie cherchent par tous les moyens à bâtir une industrie du cyber avec l’aide de nombreux partenaires de manière à anticiper les risques et saisir les opportunités d’affaires.
A Moscou, les semaines de la cybersécurité ressemblent à des écosystèmes rassemblant des milliers de participants à l’échelle des BRICS. Des administrations, des entreprises privées chinoises ou indiennes y côtoient des militaires mais aussi les directeurs de système d’information de grandes entreprises.
Il en va de même dans l’Union européenne. Le NIS2[23] qui fait suite au règlement général sur la protection des données (RGPD) prépare nos administrations et organismes d’intérêts vitaux à toutes les éventualités. La vulnérabilité du système Internet, notamment les câbles par lesquels transitent 99% des données, préoccupe nos services qui disposent d’un département cyberguerre important. L’ANSSI[24] anime un écosystème de souveraineté numérique à l’image de celui de Moscou. Des rencontres de praticiens telles que les « Lundi de la cybersécurité », ou des associations comme l’ARCSI[25] sont des lieux d’échanges entre spécialistes. Comme les autres, la cyberguerre a besoin d’idées.
Sur le champ de bataille elle brouille les vecteurs de l’ennemi. C’est ainsi que la guerre électronique rend aveugle certains missiles de croisière qui n’atteignent plus leurs cibles. L’obus de 155 mm Excalibur guidé par GPS n’est plus aussi performant qu’au début du conflit. Des corsaires ou mercenaires apparaissent dans le cyberespace. Ils traversent les frontières, menacent les souverainetés des États. A l’Est comme à l’Ouest des groupes informels tels que Conti[26] en Russie ou IT Ukrainian Army, préfigurent des guerres étonnantes, inattendues.
Encore limitée, la cyberguerre peut devenir cataclysmique. Entre la dissuasion nucléaire et la dissuasion conventionnelle existe désormais une dissuasion informatique tout aussi terrifiante. Après « la nuit du noisetier » celle de Chronos menace tous les belligérants.
Au XXIe siècles, avoir l’heure exacte est critique pour de grands pans de l’industrie et des transports. En mer Baltique, notamment depuis l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, la navigation commerciale est rendue plus difficile. L’heure est diffusée de plusieurs façons : par des émetteurs radio, par les satellites GNSS (GPS, Galileo, etc.), par Internet avec le protocole NTP, par des fibres optiques dédiées, etc.
Toutes les méthodes actuelles posent de gros problème de sécurité : les GNSS, très précis, utilisés absolument partout, sont très sensibles au brouillage, qui empêche la localisation, et au leurrage, qui vous transporte n’importe où. Or le brouillage, nous l’avons vu est une spécialité russe. Le protocole NTP, qui distribue l’heure sur Internet avec une précision bien moins grande, est facilement attaquable. Et les conséquences des attaques de plus en plus nombreuses peuvent être très graves[27].
En cas d’aggravation du conflit, des pirates pourraient modifier l’heure affichée sur des serveurs de temps, entraînant des désynchronisations massives et des dysfonctionnements dans les systèmes qui s’y réfèrent. Des attaques par déni de service pourraient rendre inaccessibles les serveurs de temps, paralysant les systèmes qui en dépendent. Les conséquences de la cyberguerre pourraient être catastrophiques. Les systèmes d’exploitation, les bases de données et leurs applications dépendent d’une horloge précise pour fonctionner correctement. Une heure erronée pourrait entraîner des pertes de données, des plantages et des dysfonctionnements généralisés.
Les réseaux de télécommunications s’appuient sur la synchronisation horaire pour router les paquets de données de manière efficace. Une heure inexacte pourrait entraîner des retards, des pertes de paquets et une dégradation de la qualité des communications. Les marchés financiers fonctionnent en temps réel et s’appuient sur des horloges précises pour exécuter les transactions. Une heure erronée pourrait entraîner des erreurs de calcul, des pertes financières et une perte de confiance dans les marchés. Les réseaux électriques, les systèmes de transport et les systèmes de contrôle industriels dépendent tous d’une synchronisation horaire précise. Une heure erronée pourrait entraîner des pannes, des accidents et des perturbations majeures. Le professeur Gérard Berry auteur de L’Hyperpuissance de l’informatique, Algorithmes, données, machines,réseaux[28] trace les grandes lignes d’un conflit généralisé.
La cyberguerre ne se limite pas au terrain militaire. Elle facilite le développement de technologies qui contournent les sanctions, bâtissent une souveraineté numérique partagée entre les BRICS. C’est sur elles que s’appuieront les réponses russes à la guerre économique occidentale.
La guerre économique occidentale
La guerre économique devait vaincre la Russie grâce aux sanctions économiques et financières. Il était inutile et risqué comme nous venons de le voir d’engager l’OTAN le 24 février 2022. L’Ukraine, forte d’une armée rééquipée, aux effectifs trois fois supérieurs à ceux de la force d’invasion russe, devait obliger cette dernière à l’envahir pour éviter la reconquête de la Crimée et du Donbass. Excellent prétexte pour lancer les sanctions finales. Tout était prêt, rien n’était caché puisque visible, écouté, par les service de renseignement des uns et des autres.
Le projet de guerre économique contre la Russie est une vielle idée anglo-saxonne qui prend ses racines après le congrès de Vienne de 1815. L’Angleterre ne pardonne pas au Tsar d’avoir ménagé la France. Tout au long du XIXe siècle, ce sont les milieux libéraux britanniques pour des motifs coloniaux qui inventeront le terme russophobie. Celui-ci ne fera pas toujours l’unanimité au sein de cette famille de pensée. Les États-Unis prennent le relais avec des géopoliticiens tels que Alfred Mahan, qui développe le concept de puissance maritime, John Mackinder[29], qui voit dans le Heartland eurasiatique une menace existentielle pour l’Amérique, ou Nicolas Spikman, qui, avec la théorie de l’anneau, est à l’origine de la politique de Containment de la Russie soviétique puis de la Chine.
C’est dans la continuité de ces auteurs que se situe Le Grand échiquier de Zbigniew Brzezinski et l’émergence des néo-conservateurs américains au sein du Parti démocrate et de son concurrent républicain. Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d’Etat à l’Eurasies en sera l’une des figures politiques. On remarquera la filiation « polonaise » de cette école jusqu’au président Duda qui, en juin 2024, parlait de la nécessaire décolonisation de la Russie. Bien avant le 24 février, un axe Washington-Varsovie émerge. Il joue maintenant un rôle diplomatique et militaire au sein même de l’Union européenne…
En 2019, un rapport intitulé Overextending and Unbalancing Russia de la Rand Corporation[30], sous l’administration Trump I, décrit les mesures à prendre pour ruiner la Russie. Sont abordés les chapitres suivants : Economie – Géopolitique – Système informationnel et idéologique – Dimension aérienne et spatiale – Dimension maritime – Dimension terrestre et multi-domaines. Ce rapport s’inscrit dans le contexte des sanctions communes aux États-Unis et à l’Union européenne qui depuis la sécession des oblasts russophones sont censées affaiblir la Russie. On notera que les rédacteurs envisageaient déjà la possibilité d’une victoire militaire russe.
L’attaque économique décisive est déclenchée au lendemain du 24 février 2024. Bruno Le Maire déclare le 3 mars 2022 : « Nous allons mettre l’économie russe à genoux ». Le 23 mars au sommet de l’OTAN, le président Macron annonce : « Au moment où je vous parle la Russie est en état de cessation de paiement. Nous allons l’isoler sur la scène mondiale ». La déclaration de guerre de la France s’inscrit dans celle plus globale de l’Occident. Les banques russes, exceptions faites de certaines qui négocient les hydrocarbures, sont déconnectées du système SWIFT. La Russie plie, le rouble chute lourdement, mais le pays résiste.
Le 26 septembre 2022, en mer Baltique, deux explosions occasionnent d’importantes fuites de gaz. La première, sur Nord Stream 2 est découverte au sud-est de l’île danoise de Bornholm. Plusieurs heures plus tard, deux autres fuites sont décelées sur Nord Stream 1 au nord-est de l’île. Ces actes de guerre sanctionnent les économies allemandes et françaises. On mesure mieux aujourd’hui le désastre subi. Engie, partenaire de Gazprom avec des sociétés allemandes et hollandaises, perd 900 millions d’euros d’investissement[31]. Le gaz revendu en Europe ne peut plus l’être.
Trois pays bénéficient de cette agression. La Russie libère des stocks importants qu’elle peut écouler en direction des BRICS. Elle profite de l’affaiblissement européen. Les États- Unis rentabilisent leur industrie des gaz de schiste. Ils le vendent aux Européens qui le boudaient pour des raisons environnementales. Un troisième pays tire son épingle du jeu : la Norvège[32] qui vend son gaz plus cher elle aussi. La question demeure de savoir qui a commis cette destruction stratégique, mais il est évident que le grand perdant demeure l’Union européenne.
En septembre 2024, le rapport Draghi tire un bilan provisoire des conséquences de la guerre économique. Il annonce un lent appauvrissement de l’Europe occidentale. Selon le FMI (octobre 2024) la croissance est plus forte dans les BRICS qu’au G7. En termes de pouvoir d’achat du consommateur, la Russie dépasse l’Allemagne et la France. Après la défaite militaire, l’Europe enregistre une défaite économique. Comment la Russie a-t-elle surmonté les sanctions ? Comment les a-t-elle utilisées ?
La guerre économique russe
L’échec des sanctions occidentales a pour cause première leur publicité. Bien avant 2014, les « trains » de sanctions commentés, discutés dans les assemblées et les chancelleries, décrivent par le menu toutes les attaques dont l’économie russe sera la cible. La discrétion n’est pas une arme occidentale. Depuis longtemps, la Russie maîtrise l’art de se taire. Cet avantage nous est étranger. Souffrant d’un climat rude, d’un espace immense, de conditions de vie difficiles, le peuple russe développe des capacités de résilience étonnantes. Judoka dans l’âme, le président Poutine a profité des sanctions pour « secouer » l’intelligence économique et technologique de ses concitoyens.
Comme aurait dit le général de Gaulle, la paresse et le renoncement menacent les Russes autant que les autres. Les sanctions occidentales renforcent l’idée d’encerclement autant que les Léopard dans les plaines d’Ukraine ou les bases de l’OTAN autour de la Rodina. La Russie est le pays de la TRIZ (acronyme de Théorie de Résolution des Problèmes Inventifs[33]). Chaque sanction, chaque retrait de fournisseur, chaque rupture d’approvisionnement de pièce détachée devient un problème appelant une innovation, souvent par simplification ou alliance iconoclaste de technologies séparées par des préjugés[34]. La démarche est une approche heuristique destinée à résoudre des problèmes d’inventivité technique. Comme lors du siège de Leningrad, l’intelligence russe collective va retourner les sanctions contre l’ennemi.
Dotée d’une mémoire séculaire, la diplomatie russe puise des idées dans l’histoire de l’URSS. Celle-ci commerçait en rouble et en roupies avec l’Inde dans le domaine des hydrocarbures. L’expérience cessa avec le régime communiste. Avant même les guerres d’Ukraine, la vielle idée reprend du service. Lorsque les BRICS apparaissent, l’envie d’échapper à de nouvelles sanctions se confond avec celle d’ajouter aux FMI et à la Banque mondiales des institutions financières plus souples, mieux adaptées au désir du Sud de commercer avec le Sud, sans risquer l’extraterritorialité judiciaire du dollar.
Pour madame Anuradha Chenoy analyste financière indienne, le programme des BRICS pour une dédollarisation prendra du temps. Le dollar représente encore 80% des échanges mondiaux, l’euro 16%, devant les monnaies chinoises et indiennes. La monnaie de remplacement n’existe pas encore. Cependant le manque de crédibilité militaire et diplomatique de l’Union européenne pourrait entraîner la chute de l’euro avant celle du dollar, qui a encore de beaux jours devant lui.
Lors du 16e forum de Kazan[35] les BRICS se définissent comme un club d’affaires non occidental mais pas anti-occidental. La plupart des pays membres, y compris la Russie, souhaitent entretenir des relations commerciales voire culturelles avec l’Occident. Cependant les BRICS opposent la notion d’état civilisationnel à celle d’universalisme occidental. Beau sujet de thèse pour nos étudiants en géopolitique.
Malgré la domination du dollar, le forum de Kazan réaffirme les fondements d’un projet financier calqué sur les institutions de Bretton Woods, mais plus souples, plus « technologiques ». Les BRICS envisagent la création d’une unité de compte commune basée sur la blockchain.[36] L’exercice est ardu car il faut concilier une technologie par essence décentralisée avec une nécessaire centralisation. La nouvelle unité de compte pourrait intégrer des devises mais aussi de l’or ou des matières premières.
Un système d’assurance mondial pourrait compléter le tableau de façon classique. Il est encore au stade des idées. La création d’une agence de notation mondiale indépendante posera des problèmes politiques. La Banque de développement de Shanghai, faiblement dotée (100 milliards en dollars), reste un nain. En revanche l’idée d’un dépositaire de règlement, chambre de compensation, est stratégique. Une grande partie du commerce mondial échappera aux regards des statistiques occidentales. Le monde commercera sans nous.
Les BRICS sont un animal diplomatique qui interroge les ministres des Affaires étrangères occidentaux. Le forum de Kazan acte la fin de l’anthropocène à l’instar d’un nombre croissant de scientifiques, géologues, physiciens ou climatologues. La transition climatique est ajournée. Les conclusions du GIEC sur le CO2 sont soupçonnées de favoriser les études accusant le dioxyde de carbone au détriment de celles qui relient le changement climatique à des phénomènes complexes, voire aux nanoparticules de plastique, aux évolutions du système solaire. Une telle politique remet en cause les réglementations européennes. L’industrie du Vieux continent, basée sur la « protection de la planète », est prise à revers.
Outre l’extraterritorialité juridique du dollar, les BRICS dénoncent les sanctions unilatérales. Selon Anuradha Chenoy, 15 entreprises indiennes ont récemment été sanctionnées par les États-Unis. Ce qui ulcère New Delhi. La politique du genre et l’étude de la transsexualité à l’école primaire choquent ses valeurs de société qui reconnaissent le masculin et le féminin. Les BRICS ont permis un gel du conflit frontalier de l’Himalaya entre la Chine et l’Inde. Ces deux pays ont reculé leurs troupes. L’Iran et l’Arabie saoudite mènent des manœuvres militaires conjointes. Pour les spécialistes du Moyen-Orient, la chose était inconcevable.
Ces développements diplomatiques sont pour la Russie une source d’influence. Ils sont dus à la compétence de fonctionnaires travaillant depuis plusieurs décennies sous les ordres du même ministre. Sergueï Viktorovitch Lavrov associe son pays à un regroupement planétaire dont le PIB dépasse celui du G7. Ce diplomate est en passe d’isoler l’Union européenne. Celle-ci, confrontée à la signature le 6 décembre 2024 du traité de libre-échange avec le Mercosur[37], doit gérer le mécontentement d’agriculteurs hostiles à l’importation de produit alimentaires et céréaliers ukrainiens ne respectant pas nos normes sanitaires.
Le souvenir, du bombardement de la Serbie en 1999 par les États-Unis hante les guerres d’Ukraine. L’annulation du premier tour des élections présidentielle en Roumanie[38] le 6 décembre 2024 par la Cour constitutionnelle empêche M Calin Georgescu, pro-russe opposé au maintien de la Roumanie dans l’OTAN, d’accéder au second tour. La condamnation par son challenger, madame Elena Lasconi, de cette décision constitutionnelle ouvre une crise politique. Dans les derniers sondages, Georgescu était crédité de 63% des voix le 8 décembre 2024. Ce séisme politique concerne la France qui dispose de troupes[39]au camp de Cincu.
La Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie – pays frontaliers de l’Ukraine – et la Serbie sont le théâtre d’évolutions hostiles au gouvernement de Kiev. La Moldavie, grâce à l’apport controversé des Moldaves de l’étranger, échappe de justesse à un gouvernement pro-russe. En Allemagne les élections partielles et la crise économique favorisent à droite comme à gauche un courant hostile à l’OTAN et à Kiev. La Géorgie souhaite une politique d’apaisement avec Moscou.
Le retrait partiel des États-Unis, renforce la tendance. Dans une Ukraine en paix, rien ne garantit un résultat électoral favorable à l’Union européenne. Le ressentiment gagne du terrain parmi la population. L’Occident est accusé de ne pas avoir été à la hauteur des promesses. L’image de la Russie s’améliore, malgré les cimetières qui s’étendent à perte de vue. La langue russe se parle à nouveau dans certains milieux. L’opposition à la guerre en France[40] affaiblit notre « soutien indéfectible » au gouvernement de Kiev. Pourquoi envoyer des jeunes Français mourir à la place des Ukrainiens, accueillis chez nous ?
Le 7 décembre 2024, à l’occasion de la réouverture de Notre Dame, Ursula Van der Layen était absente. C’est plus qu’un symbole. C’est un avertissement. L’Union européenne incapable de gagner la guerre commence à perdre une paix qu’elle n’a pas anticipée[41]. Sa dislocation devient une possibilité.
Intelligence économique et stratégique
Les guerres d’Ukraine obligent la France à voir le monde tel qu’il est. La proposition de loi du Sénat[42] du 25 mars 2021 portant sur une politique d’intelligence économique et stratégique, est une réponse à la hauteur de la menace. Il faut féliciter les sénateurs qui ont conçu un système innovant inspiré des actions de monsieur Alain Juillet, premier Haut responsable à l’Intelligence économique de 2003 à 2009. Les fondements doctrinaux, législatifs, réglementaires, existent. Il est inutile de refaire un énième rapport. Il faut passer à l’acte…Difficulté française.
Sans intelligence nationale il est impossible de lire et conduire la guerre économique[43] qui ne s’arrêtera jamais. Cette ambition, source de cohérence nationale, mobilise les élus, les chefs d’entreprises, les territoires, les métiers, les ingénieurs et les scientifiques. Elle nécessite une formation des dirigeants et des cadres aux éléments fondamentaux de la discipline.[44] Elle nous oblige à une réflexion sur les temps qui viennent. Des milliers de questions nécessiteront des réponses. En voici quelques-unes parmi une immensité :
– La Russie voudra-t-elle nous envahir ? En a-t-elle les moyens ? Le veut-elle ?
– Sommes-nous si appétissants ? Qu’avons-nous à part du charbon, du granit et de la neige l’hiver ? L’Europe occidentale a toujours été un continent pauvre…
– Quid de la Roumanie après l’annulation de la présidentielle ?
– Qui assumera la dette ukrainienne ?
– Quid de l’Ukraine dans l’Union européenne ?
– Quid des terrorismes nés de l’après-guerre ?
– Nos intérêts sont-ils compatibles avec ceux de l’Union européenne ?
– Une défense européenne est-elle crédible ?
– Nos « alliés » sont-ils nos alliés, nos « ennemis » sont-ils nos ennemis ?
– Comment rétablir nos positions en Afrique ?
– Quelles énergies pour demain ?
– Quelles valeurs compatibles avec celles des autres ?
– Pourquoi les autres ne pensent-ils pas comme nous ?
– Interactions entre le conflit ukrainien et celui du Moyen Orient ?
– Le Sud Global est déjà parmi nous, quelle approche ?
L’intelligence économique nationale travaille en collaboration avec les entreprises, car celles-ci sont déjà des intelligences économiques. La fiabilité des sources et la véracité de l’information sont prioritaires. Le présent article s’inspire à 90% de sources ouvertes facilement accessibles dont on trouvera une liste non exhaustive ci-dessous.
Beaucoup de médias ont traité le sujet conformément à la charte de Munich régissant la profession de journaliste et dont l’article premier stipule : « Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité ».
Bernard BESSON*
Cf2R
TRIBUNE LIBRE N°172 / mars 2025
*Contrôleur général honoraire de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
Ancien chef de cabinet du directeur central des Renseignements Généraux (DCRG) et du directeur de la Surveillance du territoire (DST), il a été chargé de mission auprès du Haut responsable pour l’intelligence économique (HRIE).
Bernard Besson est également directeur scientifique du Comité intelligence économique des Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), membre de la Commission intelligence économique du MEDEF Ile-de-France et auteur de nombreux ouvrages consacré à l’intelligence économique et de thrillers géopolitiques dont l’un a obtenu le prix Edmond-Locard 2000 du roman noir en langue française.
…
Nota
Les analystes et les media dont les noms suivent ont été validés par les faits, la pertinence des commentaires, malgré des divergences d’opinions. Utiles pour comprendre la guerre, ils le sont pour anticiper l’après-guerre.
Idriss Aberkane, essayiste, Agence internationale de l’énergie, Frédéric Aigouy, journaliste, Brainlesspartisans X, Jacques Baud, analyste militaire, Espoir et Dignité, George Beebe, analyste, Bloomberg News, BFMTV.Cyril Gloagen, militaire-géopoliticien. Karine Bechet-Golovko, juriste, Anne-Laure Bonnel, journaliste, Fabien Bouglé, énergéticien. André Bercoff journaliste. Hervé Carresse analyste militaire, Tucker Carlson, journaliste, Régis de Castelnau, avocat. Consortium international des journalistes d’investigation, Eric Denécé, analyste, CF2R, CNEWS, Grillard Eric X. Dialogue franco-russe, Glenn Diesen, universitaire, Donbass insider, Diploweb, Sylvain Ferreira, historien, Chas W Freeman, analyste, JacquesFrèreX. Vladimir Fédorovski, écrivain, The Economist. FMI news, Fulguradvenit, Caroline Galactéros, géopolitologue, Géopolitique profonde, Géopragma, Charles Gave, économiste, Jacques Hogard, militaire, François Hollande ex-président. Intelligence online, Jean-Loup Izambert, écrivain, Alain Juillet, Sergueï Alexandrovitch Karaganov, politique, Olivier Kempf, militaire, Kyiv Post, Régis Le Sommier, journaliste. Le courrier des stratèges, Pascal Lottaz, universitaire, LCI, Ligne droite, Thierry Mariani, député, Dimitri Marckenko, militaire, Jack Matlock, diplomate, Le nouveau Conservateur. Mediazona, Viktor Medvedchuk, politicien, Alexander Mercouris, avocat, Angela Merkel, ex-chancelière. Military Summary Chanel. Nikola Mirkovic, écrivain, Arta Moeini, analyste Xavier Moreau, entrepreneur, Camille Moscow blogueuse, Omerta, Vasyl Muravytskyi, journaliste.Christelle Néant, journaliste, Open Box TV, New York Times, Victoria Nuland, ministre, Renard Paty, Jean-Pierre Petit, scientifique, Jean Bernard Pinatel, général, Politico, Piotr Olegovitch Tolstoï, député. Markus Reisner, universitaire, Jeff Rich, analyste, Fabrice Ribère, analyste. Rand Corporation Scott Ritter analyste, Alexandre Robert analyste, Henri Roure, analyste militaire, RussiaToday Jeffrey Sachs, économiste, Jacques Sapir économiste, Sputnik, Sud Radio. TerciosdelsolX, Sanevox, Stratpol, Tocsin, Emmanuel Todd essayiste, SitRepInternational Reporter, TVlibertés, Veille stratégique, Dominique de Villepin, politique.
[1] La Défaite de l’Occident Emmanuel Todd, Gallimard janvier 2024. L’auteur qui avait prévu de manière détaillée et documentée la fin de l’empire communiste réitère l’exercice avec l’Occident et en particulier l’OTAN.
[2] CF. Liste des guerres des États-Unis (Wikipédia). Le bombardement de l’OTAN sur la Serbie en 1999 pendant 78 jours a marqué les esprits en Europe balkanique. Voir plus loin.
[3] Le Format Normandie est une discussion diplomatique impliquant quatre pays : Russie, Ukraine, Allemagne et France, visant à régler la guerre du Donbass. Cette configuration des rencontres diplomatiques à quatre pays a été adoptée pendant la guerre civile opposant de 2014 à 2022 l’armée ukrainienne aux deux républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk
[4] Dans un entretien au Kyiv Independent (12 décembre 2022), François Hollande a revendiqué que les accords de Minsk avaient amené la Russie sur le terrain diplomatique, laissant à l’armée de Kiev le temps de se renforcer. Un aveu contredisant les déclarations pacifiques d’alors.
[5] Guerre en Ukraine : après des pourparlers « substantiels » à Istanbul, Moscou promet de « réduire radicalement » son offensive vers Kiev (Le Monde 29 mars 20).
[6] Poutine et Zelensky “voulaient un cessez-le-feu” mais les négociations ont été rompues par les pays occidentaux a expliqu » Naftali Bennett (France soir, 6 février 2023).
[7] Site de Jean Pierre Petit. Le missile tiré le 21 novembre 2024 était un MRBM Oreshnik volant à Mach 10 (3km/s). Sur ce sujet on se réfèrera aux explications de Cyril Gloagen cité plus loin. Quant à Jean Pierre Petit sa connaissance intime du milieu scientifique russe en fait un expert également très écouté. Spécialiste des problèmes liés à l’hypervélocité, il traite de l’apparition de ces technologies dans l’industrie aérospatiale.
[8] La paternité de cette décision n’est pour l’instant pas clairement établie. La » profondeur » toute relative n’excède pas 300 km. Le tir fut d’une efficacité réduite : 5 missiles abattus, le 6edestabilisé. On peut dire que l’OTAN malgré ses fermes déclarations soutient l’Ukraine comme la corde soutient le pendu.
[9] 1962, roman de Bernard Besson, Odile Jacob, 2015. A cette époque déjà (crise des missiles de Cuba), les ambassadeurs des deux puissances jouèrent un rôle stratégique de premier plan. Aujourd’hui encore, des personnalités comme William Burns et Serguei Naryshkin qui se connaissent bien, reproduisent le dialogue de 1962, équilibre de la terreur oblige.
[10] Cyril Gloagen, « Portrait possible du missile russe Oreshnik », Diploweb, 8 décembre 2024. Ce spécialiste détaille longuement les défauts et qualités du missile, son histoire technologique.
[11] Les États-Unis retirent le porte-avions Eisenhower de la mer Rouge en raison de l’intensification des attaques des Houthis (Jade, 24 juin 2024).
[12] Site de Jean Pierre Petit.
[13] Le Russie revendique une première vente à l’export pour son nouveau chasseur Sukhoi Su-57. Le pays acheteur n’a pas été nommé mais il pourrait s’agir de l’Algérie ou de l’Iran (Frédéric Lert, Aéro Buzz, 18 novembre 2024). On écoutera avec intérêt l’analyse d’Hervé Carresse le 24 novembre 2024 sur TVL.
[14] Jacques Baud, L’Art de la guerre russe, Max Milo, 2023. Ancien expert militaire de l’ONU, r ex officier de renseignement suisse, il a travaillé en Ukraine et en Russie dans le cadre du Format Normandie. Ses analyses de terrain ont été confirmées par les faits à de nombreuses reprises.
[15] Statista 202,3 Statista Research Department, 21 mai 2024.
[16] Dès 2026, la version F4 du Rafale de Dassault va utiliser l’IA pour désigner des cibles au sol
Après huit ans de travaux de recherche, Thales est parvenu à injecter une dose d’intelligence artificielle dans le pod Talios de la nouvelle version du Rafale. Cet équipement sert à la reconnaissance des objets et à la désignation laser. Cette innovation va équiper la future version F4 du chasseur-bombardier français, prévue pour 2026 (L’Usine Digitale, IA Insider, 10 décembre 2026)
[17] Yves Pagot, « Les déboires du programme F-35 ou le paradoxe de Zénon », Aviation militaire, août 2018.
[18] Sergueï Vladimirovitch Sourovikine concepteur et réalisateur d’une « défense active », un des vainqueurs de cette guerre.
[19] Confidence d’un engagé français dans la Légioni ayant combattu du côté ukrainien. Cette relation est confirmée par le grand reporter Régis le Sommier sur la chaîne Omerta. Celui-ci a passé plusieurs semaines des deux côtés du front notamment dans le saillant de Soudja. Où il a fréquenté les « dronistes ».
[20] Harold Thibault, Le Monde,4 décembre 2024 La Chine a annoncé, mardi 3 décembre, bloquer ses exportations de certains métaux stratégiques vers les États-Unis, au lendemain de nouvelles restrictions américaines à son encontre, dans une accélération de la guerre technologique entre les deux premières puissances de la planète. Le ministère du commerce chinois, accusant Washington d’avoir « politisé les questions commerciales et technologiques », explique dans un communiqué qu’il ne délivrera plus de licences d’exportation de gallium, de germanium, d’antimoine et d’autres matériaux vers les États-Unis dès lors qu’ils peuvent avoir un double usage civil et militaire.
[21] Des centaines de milliers de jeunes ukrainiens ont fui leur pays dès 2014 pour rejoindre les États-Unis, l’Union européenne ou la Russie. L’armée de Kiev manque cruellement d’hommes. L’argument, repris par des officiers américains, pèse dans la politique de retrait des États-Unis. Côté russe, des centaines de volontaires affluent chaque jour, motivés par des primes, de bons salaires et un patriotisme évident.
[22] Elise Vincent, Alexandre Piquard et Cédric Pietralunga Le Monde, 15 décembre 2022
[23] Securityhttps://waterfall-security.com/guides/nis2 NIS2 Directive Guide NIS2 Compliance Guide
[24] Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (https://cyber.gouv.fr). Clé de voute de la souveraineté numérique française, l’Agence mettra en œuvre les recommandations de NIS2. Les esprits critiques pour ne pas dire chagrins, remarqueront que l’Europe réglemente, la Fédération de Russie agit, les États-Unis achètent…
[25] Association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l’information (https://www.arcsi.fr). La cybersécurité est également enseignée à l’Ecole européenne d’intelligence économique de Versailles (EEIE).
[26] « Ransomware : le groupe pro-russe Conti pratique volontiers un terrorisme numérique », Le Monde Informatique(https://www.lemondeinformatique.fr/ac).
[27] Gérard Berry, ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur général du corps des Mines, membre de l’Académie des sciences, de l’Académie des technologies est titulaire de la médaille d’or du CNRS qu’il a reçue en 2014. Il est professeur émérite (au mérite) au Collège de France, ex-chaire Algorithmes, machines et langages (Gérard Berry Le Temps vu autrement, Odile jacob, 2025).
[28] Odile Jacob, 2017.
[29] D’après sa théorie du Heartland, il estime que pour dominer le monde, il faut tenir la plaine s’étendant de l’Europe centrale à la Sibérie occidentale, qui rayonne sur la mer Méditerranée, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et la Chine.
[30] « Le rapport de la Rand Corporation pour déstabiliser la Russie », 31 octobre 2022 (https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-rapport-de-la-rand). La Rand Corporation semble quelque peu embarrassée par ces preuves qui montrent que les États-Unis ont cherché à déstabiliser la Russie.
[31] Alors que l’enquête de la police allemande avance à petits pas, le flou demeure sur les commanditaires du sabotage des gazoducs Nord Stream survenu il y a deux ans. Les actionnaires européens et leur partenaire russe Gazprom restent dans le noir (Intelligence online, 05/12/2024). Ce média laisse clairement entendre que tout est fait pour masquer les preuves…Cette affaire marque les esprits en Allemagne ; elle jouera un rôle dans les évolutions politiques du pays.
[32] Seymour Hersh, “How America Took Out The Nord Stream Pipeline”, (https://seymourhersh.substack.com/p/how-amer). L’auteur très connu outre-Atlantique pour son sérieux, avoue ne pas apporter de preuve évidente. Mais la thèse qui accuse les Russes ou les Ukrainiens ne prouve rien non plus.
[33] Teorija Reshenija Izobretateliskih Zadatch (Теория Решения Изобретательских Задач – ТРИЗ).
[34] L’utilisation de GPS sur de vielles bombes héritées de la Seconde Guerre mondiale en est un exemple.
[35] Sommet des BRICS : 24 dirigeants étrangers et le secrétaire général de l’ONU attendus en Russie. Ce sommet revêt une importance particulière pour la Russie, qui y voit l’opportunité de briser son isolement diplomatique consécutif au conflit en Ukraine (i24News, Kazan Russian Federation, 23 october 2024).
[36] La blockchain est une technologie numérique de stockage et de transmission d’informations sans autorité centrale. Elle fonctionne comme une base de données sécurisée par des moyens cryptographiques, répertoriant les transactions dans un ordre chronologique. La validation et l’authentification des transactions se font par un réseau décentralisé et de pair à pair, sans intermédiaire ou tiers de confiance. La blockchain permet de minimiser les coûts et les retards liés à l’utilisation d’intermédiaires tiers pour les transactions financières.
[37] « L’UE et le Mercosur annoncent avoir conclu les négociations pour un accord de libre-échange », Africanews.
[38] https://www.lemonde.fr/international/article/2024/12/06/roumanie.
[39] Ministère des Armées, 12 juillet 2022. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 800 soldats français sont déployés en Roumanie pour consolider la défense du flanc Est de l’Europe.
[40] « Sondage : 68% des Français opposés à une intervention militaire » (www.cnews.fr/france/2024-11-28).
[41]« L’ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans une interview au journal El Diario le 11 décembre 2024, reconnait que les sanctions économiques de l’Union européenne ont été rendues inefficaces du fait de la solidarité des BRICS. Il s’interroge également sur la capacité de l’Union européenne à remplacer l’effort militaire américain si celui-ci s’arrête.
[42] Proposition de loi, Texte n° 489 (2020-2021) de Mme Marie-Noëlle Lienemann, M. Fabien Gay et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 25 mars 2021
[43] Bernard Besson,4 mai 2022 (https://www.diploweb.com/Ukraine-Comment-lire-et-conduire-la-guerre). L’auteur du présent article approuvait la nécessité d’arrêter cette guerre par la négociation comme lors des rencontres diplomatiques du format Normandie. La nation ukrainienne a été brisée par ce conflit. Lorsque les pertes humaines seront comptabilisées de part et d’autre, l’Europe et la Russie prendront conscience d’une faillite morale et politique sans précédent depuis 1945.
[44] https://www.iesf.fr/752_p_43175/comite-intelligence-economique. Le MOOC-IESF-UNIT sur l’intelligence économique propose des outils pédagogiques, une certification des personnels, une évaluation de l’intelligence économique déjà présente à partir du TEST 1000 et un Questionnement stratégique. Cet enseignement en ligne s’appuie sur les retours d’expérience en France et dans le monde de nos ingénieurs confrontés à la concurrence loyale autant qu’à la guerre économique. Ce programme est supporté par L’Université numérique ingénierie et technologie (UNIT) qui est l’une des sept universités numériques thématiques nationales (UNT) créées à l’initiative d’universités, de grandes écoles et du ministère chargé de l’Enseignement supérieur. Le badge IESF-MOOC -UNIT certifie les compétences de celui ou celle qui obtient une moyenne de 14/20 en répondant au Quiz du MOOC intelligence économique. Il n’est d’ailleurs pas interdit d’obtenir 20/20…