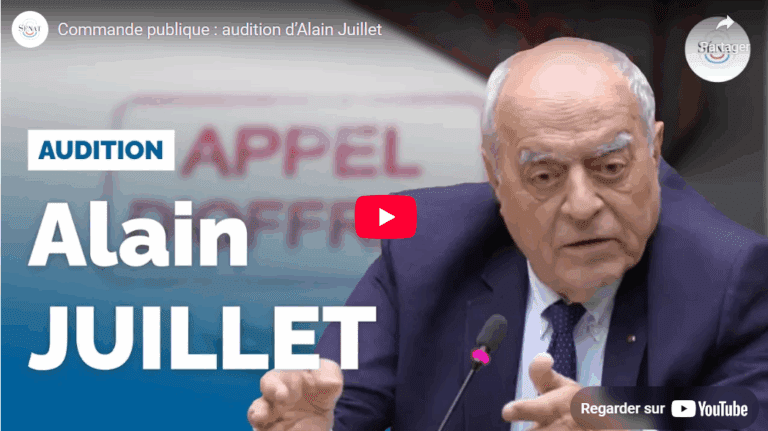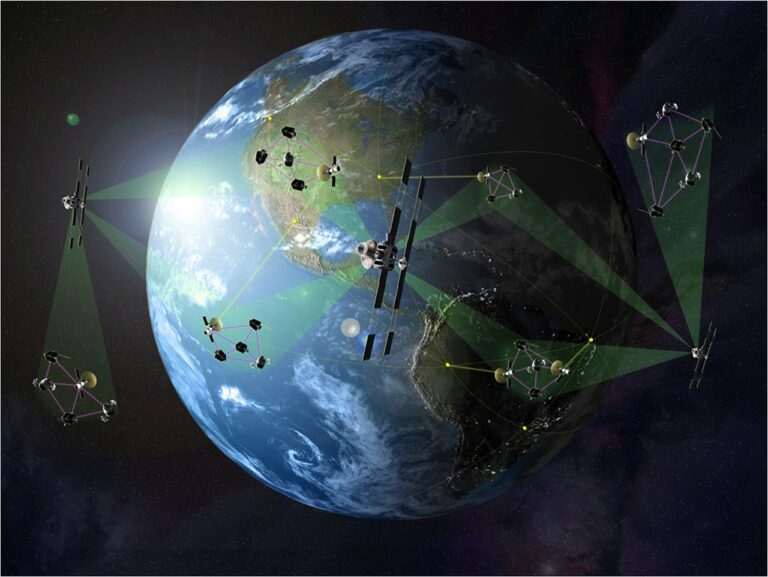Depuis trente ans, l’aviation occidentale règne en maître incontesté sur le ciel. Mais le conflit en Ukraine a brutalement mis fin à cette certitude. Pour la France, conserver sa liberté d’action aérienne exige désormais une véritable révolution stratégique et technologique. Comment adapter ses doctrines, repenser ses choix technologiques et industriels, et trouver les compromis nécessaires à une autonomie stratégique durable ?
Depuis la guerre du Golfe en 1991, les forces aériennes occidentales ont fait du ciel un territoire conquis d’avance. En Irak, en Afghanistan ou en Libye, les avions de l’OTAN volaient sans réelle opposition, appuyant au sol des troupes à l’abri de toute menace aérienne. Cette suprématie, construite sur la destruction rapide des défenses ennemies et sur une supériorité technologique incontestable, a façonné les doctrines militaires occidentales. « L’ennemi ne volera pas. » Cela relevait de l’évidence.
Mais l’invasion russe en Ukraine a marqué la fin de cette époque. Depuis deux ans, ni Moscou ni Kiev ne sont capables d’établir une supériorité aérienne durable. Défenses sol-air sophistiquées, drones par centaines, brouillage électronique permanent : l’espace aérien s’est transformé en champ d’affrontement complexe, saturé et dangereux. Comme le souligne Adrien Gorremans dans une récente étude de l’Ifri[1], l’espace aérien devient un espace de plus en plus fermé. Face à cette réalité, la France doit réagir vite. Son modèle aérien, performant mais limité, ne suffit plus à garantir son autonomie stratégique.
La fin de la supériorité aérienne occidentale
La supériorité aérienne a longtemps été une évidence stratégique pour l’Occident. Dès les années 1920, Giulio Douhet posait une idée fondamentale : « Conquérir la maîtrise de l’air, c’est assurer la victoire ; être battu dans les airs, c’est accepter la défaite et se soumettre aux conditions que l’ennemi voudra bien imposer. ».
Cette conception a structuré l’ensemble des doctrines militaires aériennes pendant un siècle. Durant la guerre du Golfe en 1991, elle s’est concrétisée de manière spectaculaire : en quelques jours, les forces aériennes occidentales ont anéanti les défenses irakiennes, paralysant toute capacité de riposte de l’adversaire. La coalition menée par les États-Unis avait alors démontré qu’une guerre pouvait être gagnée d’abord et avant tout dans les airs. Depuis, les opérations aériennes occidentales, que ce soit au Kosovo, en Afghanistan ou en Libye, ont systématiquement suivi ce modèle : établir une maîtrise absolue de l’espace aérien avant d’engager des troupes au sol. L’aviation est devenue un préalable à toute opération militaire sérieuse, un multiplicateur de force incontestable.
Mais aujourd’hui ce modèle est obsolète. La guerre en Ukraine a démontré qu’une supériorité aérienne totale n’est plus garantie face à des adversaires disposant de technologies modernes. On lit ainsi, dans le rapport de l’Ifri : « En deux ans et demi de guerre, les armées de l’air russes comme ukrainiennes se sont retrouvées réciproquement neutralisées par la densité et la performance des systèmes intégrés de défense aérienne ». Face à la saturation des défenses anti-aériennes, à l’omniprésence des drones et à la guerre électronique permanente, le ciel redevient un espace contesté, dangereux et opaque.
Nouvelles menaces
La supériorité aérienne, longtemps assurée par l’avance technologique occidentale, est aujourd’hui confrontée à des menaces diversifiées et complexes. Les adversaires potentiels, comme la Russie, la Chine ou l’Iran, ont développé des stratégies et technologies capables de neutraliser ou d’épuiser les capacités aériennes occidentales.
Ainsi, les systèmes IADS (défense sol-air intégrée) combinent radars, missiles sol-air et guerre électronique pour créer des zones d’interdiction aérienne efficaces. La Russie avec ses systèmes S-400 et S-500, la Chine avec ses missiles HQ-9 et HQ-22, ou encore l’Iran avec les batteries Bavar-373, illustrent cette capacité à restreindre drastiquement la liberté d’action aérienne des forces occidentales. Ces systèmes obligent les avions à adopter des tactiques spécifiques telles que la furtivité et la suppression des défenses ennemies (SEAD).
Les missiles hypersoniques, capables d’atteindre des vitesses supérieures à Mach 5, représentent une autre menace stratégique majeure. La Russie a ainsi déployé les missiles hypersoniques Kinzhal et Avangard, tandis que la Chine a rendu opérationnel son missile DF-17, équipé d’un planeur hypersonique. Ces armes réduisent considérablement le temps de réaction des défenses aériennes et augmentent la vulnérabilité des bases militaires occidentales, imposant ainsi le développement rapide de systèmes d’interception sophistiqués et de nouvelles stratégies de dissuasion.
L’utilisation généralisée des drones transforme radicalement le champ de bataille aérien. Dans le conflit ukrainien, les drones kamikazes comme les Shahed-136 (de conception iranienne) ou les drones ISR tels que le Bayraktar TB2 (de conception turque) ont démontré leur efficacité, saturant et épuisant les défenses adverses. De leur côté, les États-Unis développent le concept de « Loyal Wingman », des drones collaborant directement avec des avions habités. Face à ces nouvelles menaces, les systèmes de défense traditionnels deviennent vite dépassés, obligeant à repenser entièrement les stratégies défensives.
La guerre électronique constitue une menace invisible mais redoutable. Les systèmes comme le Krasukha-4 russe peuvent brouiller radars et satellites, perturbant profondément les opérations aériennes ennemies. De même, les cyberattaques menées par des pays comme l’Iran ou la Chine ciblent directement les infrastructures militaires. Cette dimension électronique impose aux forces occidentales d’investir massivement dans des contre-mesures sophistiquées pour préserver leurs capacités opérationnelles.
Enfin, la très haute altitude devient un espace stratégique crucial. Les récentes incursions de ballons de surveillance chinois aux États-Unis ou le développement de drones stratosphériques comme le Zephyr d’Airbus démontrent l’importance croissante de cette nouvelle frontière aérienne. Ces capacités offrent des possibilités inédites en matière de renseignement mais créent également des vulnérabilités pour les nations qui négligeraient ce nouvel espace opérationnel.
Face à ces menaces émergentes, il est impératif pour les forces aériennes occidentales d’adapter rapidement leurs doctrines, leurs tactiques et leurs technologies afin de maintenir ou de reconquérir leur supériorité dans les airs.
Les limites de l’aviation française
L’aviation française dispose d’un outil militaire performant : le mythique Rafale. Avion polyvalent, il est mondialement reconnu pour ses capacités techniques et opérationnelles. Pourtant, à l’épreuve d’un conflit de haute intensité, ce modèle montre ses limites.
Sa première faiblesse est d’ordre stratégique : la France ne possède pas de capacités dédiées à la suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD). Contrairement aux États-Unis, elle dépendrait en cas de conflit de haute intensité des moyens d’alliés pour ouvrir et sécuriser le ciel. Cette lacune limite fortement son autonomie stratégique.
La deuxième vulnérabilité est technologique. Le Rafale, malgré ses nombreuses qualités, n’est pas furtif face aux radars modernes. En conséquence, les aéronefs français se retrouveraient particulièrement exposés dans des environnements saturés de systèmes anti-aériens avancés. Le programme SCAF (Système de Combat Aérien du Futur), prévu pour combler ce déficit, ne verra pas le jour avant plusieurs années. D’ici là, l’armée française devra évoluer dans des conditions très contraignantes.
Enfin, la troisième limite concerne le volume et la logistique. La flotte aérienne française, qui a un objectif à 185 Rafale en 2030, manque de profondeur pour soutenir une guerre prolongée face à un adversaire bien équipé. Les stocks de munitions sont insuffisants pour soutenir un rythme opérationnel soutenu comme observé récemment dans des conflits prolongés. La disponibilité opérationnelle et le nombre limité de pilotes qualifiés aggravent encore ce problème, réduisant considérablement la capacité d’endurance des forces aériennes françaises.
Ces contraintes placent la France dans une position ambiguë : elle dispose d’une aviation efficace mais insuffisamment robuste pour faire face seule aux nouveaux défis du combat aérien. Il est donc urgent de repenser le modèle français, en intégrant de nouvelles approches pour renforcer durablement sa résilience technologique et capacitaire.
De la qualité à la quantité
Depuis plusieurs décennies, la France, comme la plupart des puissances occidentales, mise sur des plateformes militaires toujours plus sophistiquées mais toujours plus rares et coûteuses. Cette logique, décrite par Adrien Gorremans comme la « spirale augustinienne », consiste à concentrer un maximum de capacités sur un nombre limité d’appareils très performants. Ce modèle est aujourd’hui remis en question par la réalité des conflits modernes, où la masse et la résilience redeviennent indispensables.
Le conflit ukrainien montre clairement les limites d’un tel modèle. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement la qualité d’une plateforme qui importe, mais le nombre d’appareils disponibles, leur capacité à être sacrifiés si nécessaire, et leur intégration dans des réseaux complexes et flexibles. On le voit en Ukraine : les drones occidentaux sont parfois trop coûteux pour être sacrifiés, et ne sont donc pas engagés.
Une voie stratégique s’impose donc à la France : adopter une logique de mix. Celle-ci implique une complémentarité entre des plateformes de haute valeur (comme les chasseurs Rafale et les futurs appareils du programme SCAF) et une multitude d’appareils moins coûteux, spécialisés, faciles à produire et à déployer en nombre. Cette approche permettrait à l’armée française de saturer les défenses adverses tout en préservant ses vecteurs précieux pour des missions décisives. Par ailleurs, il s’agit également d’intégrer une multitude de systèmes plus simples, connectés et capables de collaborer en réseau. En multipliant les points d’action et en répartissant les capacités offensives et défensives, cette stratégie accroît considérablement la résilience et la flexibilité des opérations aériennes, tout en réduisant la dépendance à l’égard de plateformes uniques, coûteuses et aisément ciblées par l’ennemi. Ce revirement stratégique doit se faire dans l’optique d’un regain de masse, et non de performance individuelle de chaque système d’arme.
Le développement massif de drones peu coûteux, capables de reconnaissance, d’attaque et de brouillage, apparaît comme une solution pragmatique et réaliste. Ces drones, utilisés en essaims, pourraient saturer les systèmes anti-aériens adverses, protégeant ainsi les aéronefs habités, plus coûteux et stratégiquement critiques. Aussi la France doit-elle repenser son industrie de défense afin de favoriser la production en grande série, en rupture avec le modèle actuel basé sur des productions limitées et extrêmement sophistiquées. L’enjeu est stratégique autant qu’industriel : accepter une certaine rusticité technologique pour regagner en masse, en flexibilité et en autonomie stratégique.
Quels scénarios envisageables ?
Scénario 1 : Une force aérienne hybride et progressive
Ce premier scénario consiste à maintenir le Rafale, en continuant son amélioration progressive vers une version F5, tout en développant rapidement des drones de combat autonomes et des essaims de drones. Cette approche privilégie une aviation distribuée, où avions habités, drones autonomes et missiles à longue portée collaborent étroitement. Ce modèle offre une grande flexibilité opérationnelle, réduit les risques technologiques, et renforce rapidement la masse et la résilience des forces aériennes européennes.
Scénario 2 : Tout miser sur le SCAF avec le risque du retard
Le second scénario privilégie l’investissement massif dans le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF), un projet européen d’un ensemble de systèmes d’armes aériens interconnectés. Cette option mise sur une rupture technologique majeure pour assurer la supériorité aérienne à long terme. Toutefois, cette stratégie ne prévoit aucune alternative en cas de retard ou d’échec technologique, créant ainsi un risque sérieux de décrochage face aux progrès rapides des États-Unis et de la Chine. Par ailleurs, Adrien Gorremans* préconise de « sortir l’aviation de chasse de la spirale augustinienne en ne payant le prix de la furtivité que là où elle est indispensable ».
Scénario 3 : Complémentarité avec le F-35 et limitation du SCAF
Enfin, le troisième scénario, déjà adopté par des pays comme l’Allemagne et l’Italie, consiste à acheter des avions américains F-35 pour garantir une compatibilité maximale avec l’OTAN tout en réduisant les ambitions initiales du SCAF. Si ce choix permet de maintenir une capacité opérationnelle immédiate, il implique cependant un risque significatif en termes de dépendance technologique et de perte d’indépendance stratégique face aux États-Unis.
Conclusion
La maîtrise du ciel n’est plus acquise : elle doit désormais être conquise à nouveau, avec détermination et pragmatisme. L’expérience ukrainienne rappelle à la France et à l’Europe que leur supériorité aérienne repose aujourd’hui sur un équilibre fragile, menacé par la montée en puissance de technologies adverses toujours plus performantes. Face à ces nouvelles réalités, il est urgent d’opérer des choix stratégiques forts : diversifier les capacités aériennes, investir dans des plateformes à la fois robustes et sacrifiables, et construire une industrie de défense capable de produire rapidement et en grand nombre. À défaut d’adopter rapidement une stratégie claire et ambitieuse, la France risque de perdre définitivement sa liberté d’action aérienne, avec des conséquences lourdes pour son autonomie stratégique et son influence internationale. Le temps des compromis et des choix est venu, car dominer le ciel demeure une nécessité absolue dans un monde qui voit le retour des conflits de haute intensité.
Paulin de ROSNY
Revue Conflits
31 mars 2025
*Adrien Gorremans, « L’avenir de la supériorité aérienne : maîtriser le ciel en haute intensité », Ifri – Focus stratégique n°122 – janvier 2025.